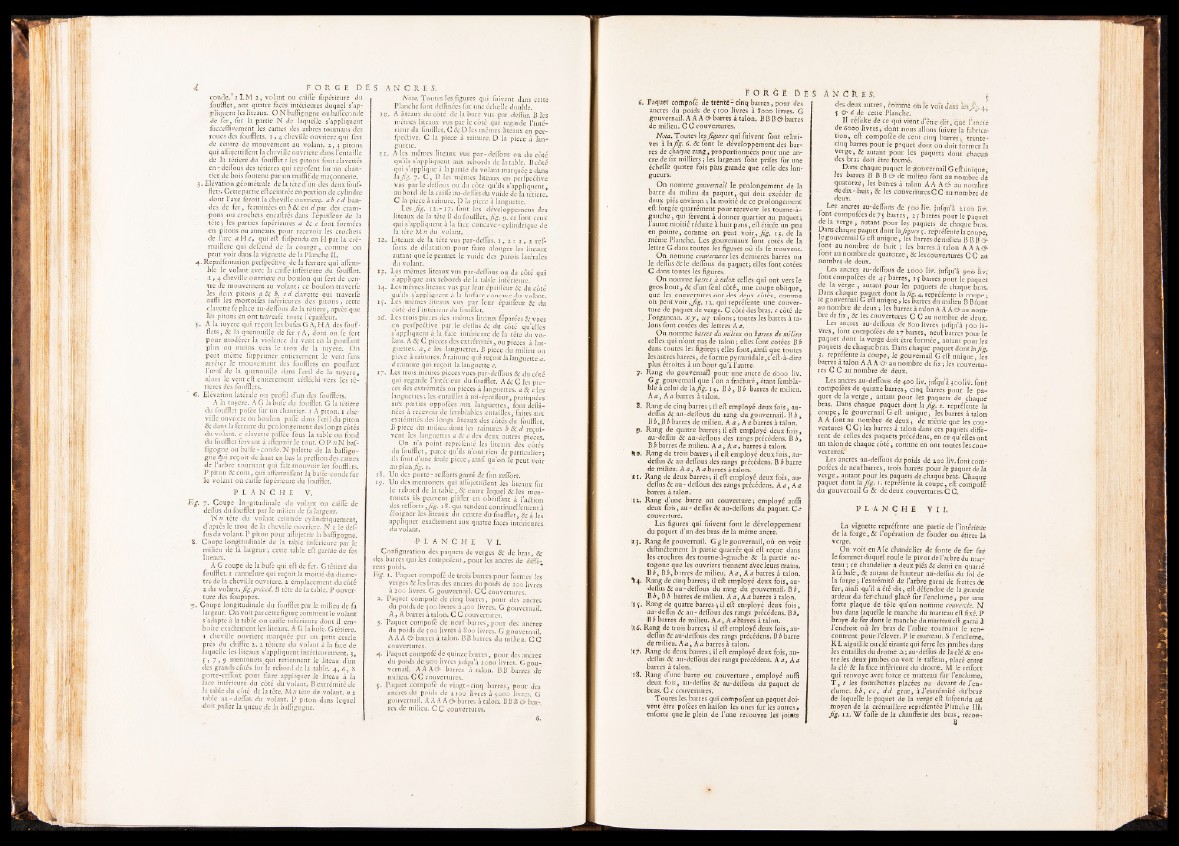
-conde.' -z LM 2 , volant ou caille fupérieure du
foufflet, aux quatre faces intérieures duquel s’appliquent
les liteaux. O N baffigogne ou.baflècoride
de fer, fur la partie N de laquelle s’appliquent
fucceffivement les cames des arbres tournans des
roues des foufflets. 1 , 4 cheville ouvrière qui fert
de centre de mouvement au volant, z , 3 pitons
qui aflujettiflènt la cheville ouvrière dans l’entaille
de la têtiere' du foufflet : les pitons font clavettes
en 7 deflous des têtieres qui repofent fur un .chantier
de bois foutenu par un malTif de maçonnerie.
-3. Elévation géométrale de la tête d’un des deuxfouf-
flets. Cette partie eft ceintrée en portion de cylindre
dont Taxe feroit la cheville ouvrière, ab c d ban-
des.'de fe r, fermiaées en b 8c en d par des crampons,
oucroçhets encaftrés dans lepai fleur de la
tête ; des .parties fupérieures a 8c c font formées
en pitons ou anneaux pour recevoir les crochets
de l’arc a H c , qui eft fufpendu en H par la .crémaillère
qui .defeend de la courge, comme on
peut voir dans la vignette de la Planche II.
-4. Repréfentation perfpective de la ferrure qui aliénable
le volant avec la caifle inférieure du foufflet.
. 1 , 4 cheville ouvrière ou boulon qui fert de centre
de mouvement au volant; ce boulon traverfe
les deux pitons a 8c b. c d clavette qui traverfe
auffi les mortoifes inférieures des pitons , cette
•clavette fe place au-deflous de la têtiere,, après que
les pitons en ont traverfé toute l’épaiflèur.
y. A la tuyere qui reçoit les bufes G A, H A des fouf-
flets, 8c la quenouille de fer y A , dont on fe fert
pour modérer la violence du vent en la pouflànt
plus ou moins vers le trou de la tuyere. On
peut 'même fupprimer entièrement le vent fans
arrêter Je mouvement des foufflets en pouflànt
l ’oe uf de la quenouille dans l’oeil de la tuyere,
alors le vent eft entièrement réfléchi vers les têtieres
des fouffli êts.
C. Elévation latérale ou profil d’un des foufflets.
A la tuyere. A G la bufo du foufflet. G la têtiere
du foufflet pofée fur un chantier. 1 A piton. 1 cheville
ouvrière ou boulon pafle dans l’oeil du piton
& dans laferrure du prolongement des longs côtés -
du volant, c clavette paflee fous la table ou fond
•du foufflet Yèrvant à affermir le tout. O P n N baf-
îîgogne ou baflè-conde.TJ palette de la baffigo-
gne^ui reçoit de haut en bas la prefiîon des cames ;
de l’arbre tournant qui fait .mou voir les foufflets. ;
P piton 8c coin, qui affermiflent Ja'baflè-condefur ■
le volant ou caiflè fupérieure du foufflet.
P L A N C H E V.
Fig. 7. Coupe longitudinale du volant ou caiflè de
deflus du foufflet par le milieu de fà largeur.
'Nra tête du volant ceintrée cyündriquement,
d’ après le trou.de la cheville ouvrière. N 2 le d e f
fus du volant. P piton pour affujetrir la baffigogne,
S. Coupe longitudinale de la table inférieure par le
milieu dé fa largëur ; cette table eft garnie de Ces
liteaux.
A G coupe de la biife qui eft de fer. G têtiere du
foufflet.vi cannelure qui reçoit la moitiédu diamètre
de la cheville ouvrière, z emplacement du côté
1 du volam,fig.preced. B tête de la table. P ouverture
des foupapes.
9. Coupe longitudinale du foufflet par le milieu de fà
largeur. On voit par cette figure comment le volant
s’adapteà la table ou caifle inférieure dont il emboîte
exactement les liteaux. A G labufe. G têtiere.
1 chevillé ouvrière marquée par un petit cercle I
près du chiffre z. z têtiere du volant à la face de
laquelle les liteaux s’appliquent intérieurement. 3,
y » 7 , 9 mrentonets^qüi retiennent le liteau d’un
des grands côtés fur le rébord.de la table. 4 , 6,t V
porte-reflort pour faire appliquer ,1e liteau à la
face intérieure du côté du volant. B extrémité de
-la table du côté de la tête. Mn tête du volant, n z
table au - deflus, du volant. P piton dans lequel
«doit paflèr la queue de la baffigogne.
Nom. Toutes les figures qui fuivent dans cette
Planche font deffinées fur une échelle double.
10 . A liteaux du côté de la bure vus par deflus. B les
mêmes liteaux vus par le côté qui regarde l’intérieur
du foufflet. C & D les mêmes liteaux en per-
fpèclive. C la piece à rainure. D la piece à languette.
m i. A ie s mêmes liteaux vus par-deflous ou du côté
qu’ ils s’appliquent aux rebords de la table. Beôté
qui.s applique à la partie du volant marquée z dans
Ja_y?g. 7. C , D les mêmes^liteaux en perfpeétive
vus par le deflous ou du côte qu’ils s’appliquent,
au bord de la caifle au-deflüs du vuide de la têtiere.
C la piece à rainure. D la piece à languette.
Les fig . 1Z . - 1 7 , font les' développemens des
liteaux de la tête B.du foufflet, fig . p.:ce font ceux
•qui s’appliquent à la face concave- cylindrique de
la tête M n du volant.-, •. .
iz . Liteaux de la têtevus par-defliis, 1 , z :, r , z ref*
forts de dilatation pour faire alongèr les liteaux
autant que le permet le vuide des parois latérales
du volant.
1.3. Les mêmes liteaux vus par-deflous ou du côté qui
s’applique aux rebords de la table inférieure.
14. Les mêmes liteaux vus par leur épaillèur & du côté
qu’ils s’appliquent à ia furface.conçave.du volant.
i $ . Les mêmes liteaux vus par leur épaiflèur 8c du
côté de j ’jmérieur du foufflet.
U). Les trois pièces des mêmes liteaux feparées& vues
en perfpeétive par le deflus 8c du côté qu’elles
s’appliquent à la. face intérieure de la tête du vo.-
lant. A & C pièces des extrémités, ou pièces à languettes.
a.y c les languettes. B piece du milieu ou
piece à rainures, é rainure qui reçoit la languette a.
d rainure qui reçoit la languette c.
17 . Les trois mêmes pièces vues par-deflous 8c dû côté
qui -regarde^ l’intérieur du foufflet. A & C lés pièces
des extrémités ou pièces à languettes, a8c c ïes
languettes; les entailles à mi-cpaiflèur,, pratiquées
au'x parties oppofées aux languettes, font defti-
nées à recevoir de feniblables entailles., faites aux
extrémités des longs liteaux des côtés du foufflet. •
B piece du milieu dont les rainures b 8c d reçoivent
les languettes a 8c c des deux autres pièces.
On n’a point >repréfenté les liteaux des côtés
«du foufflet, parce qu’ils n’ont rien de particulier;
ils font d’une feule piece., ainfî qu’on Je peut .voir
au plan fig. i .
18. Un des porte - reflorts garni de Ton reflort.
19. Un des mentonets qui aflujettiflent les liteaux finie
rebord de la table , 8c entre lequel 8c les mentonets
ils peuvent gliflèr en obéiflànt .à l’aétion
des reflorts 3fig . 18. qui tendent continuellement à
éloigner les liteaux du centre du foufflet, & à' les
appliquer exaétement aux quatre faces intérieures
du volant.
•P L A N C H E V I.
Configuration des paquets de verges & de bras , 8c des barres qui les compofent,.pour rens poids. les ancres de diffé-
Fig. 1. Paquet compôfe detrois barres pour former les
verges 8c les bras des ancres du poids de 100 livres
à zoo livres. G gouvernail. C C couvertures.
z. Paquet compofé de cinq barres, pour des ancres
du poids de 3 00 livres 34 00 livres. G gouvernail.
A , A barres à talon. C C couvertures.
3. Paquet compofé de neuf barres, pour des ancres
du poids de,y 00 livres à 800 livres. «G gouvernail.
A A A d ’ barres à talon. B B barres du milieu. C G
couvertures.
4 . Paquet-compofé de quinzefoarres, pour des ancres
du poids de 900 livres jufqu a 2000 livres. G gou-,
vernail. A A A & barres à « Io n . B B barres de
milieu. C C couvertures.
f . Paquet compofé de vingt - cinq barres, pour des
ancres du poids de ziQp'livres à yoôo livres. G
gouvernail. A A A A & barres à talon. B B B & barres
de milieu. C C couvertures.
6. Paquet compofé de trétifcê = émq barres, pour des
ancres du poids de y 100 livres à 8000 livres. G
gouvernail. A A A & barres à talon. B B B & barres
de milieu. G C couvertures.
Nota. Toutes les figures qüi foiirent font relatives
à Izfig- 6. 8c font le développement des barres
de chaque rang , proportionnées pour une ancre
de fix milliers; les largeurs font pirifes fur une
échelle quatre Fois plus grande que celle des longueurs.
On nômme gouvernail lé pfolortgement dé la
barre du milieu du paquet, qui doit excéder de
deux piés environ ; la moitié de ce prolongement
ëft forgée quarrément pour recevoir les tourne-à-
gauclie, qui fervent à donner quartier au paquet ;
l ’autre moitié réduite à huit pans, eft étirée un peu
en pointe, comme on peut vo ir * fig.. 13 . de la
même Planche. Les gouvemaux font cotés de la
lettre G dans toutes les figures où ils fe trouvent.
On nomme couvertures les dernieres barres ou
lé deflus & le deflous du paquet; elles font cotées
C dans toutes les figures.
On nomme barres à talon cellés qui ont vërs lé
gros bout, & d’un foui côté, une coupe oblique,
que les couvertures ont des deux côtés, comme ,
oh peut voir ,fig . iz . qui répréfente Une couverture
de paquet de verge. C côté dès bras, c côté de
, l’organeau. x y 3 u [ talons; toutes les barres à talons
font cotées des lettres A a-.
On nomme barres du milieu ou barres de milieu
celles qui n’ont pas de talon ; elles font cotées B b
dans toutes lés figures; elles font,ainfi que toutes
les autres barres, de forme pyramidale,c’eft-à-dire
plus étroites à un bout qu’à l’autre.
7. Rang du gouverna?! pour une ancre de <>000 Iiv.
G g gouvernail que l’on a fraéluré, étant fembla-
ble à celui de là fig. 13 . B b , B é barres de milieu.
A a , A d barres à talon.
8. Rang de cinq barres ; il eft employé deux fo is , au-
deflus 8c aii-deffous du rang dü gouvernail. B b ,
B b y jib barres de milieu. A a , A a barres à talon.
p. Rang de quatre barres ; il eft employé deux fois *
au-deflus 8c au-deflous des rangs précédehs. B b ,
Bé barres de milieu. A a , A a , barrés à talonr.
fc®. Rang de trois barïes ; il eft employé deux fois, àu-
defliis 8c au-deflous des rangs précédens. B b barre
de milieu. A a , A a barres à talon.
i l . Rang de deux barres ; il eft employé deux fo is, au-
deflus 8c au - deflous des rangs précédens. A a t Aa
barres à talon.
:n . Rang d’une barre oü couverture; employé auffi
deux fois, au-deflus & au-deflous du paquet. C e
couverture.
Les figures qui fuivent font le développement
du paquet d’un des bras de la même ancre.
(13. Rang de gouvernail. G g le gouvernail, où on voit
diftinétemént la partie quarrée qui eft reçue dans
les crochets des tourne-à-gauche & la partie octogone
que les ouvriers tiennent a’vec leurs mains.
B é , B é , barres de milieu. A a , A a barres à talon.
^4. Rang de cinq barres ; il eft employé deux fois, au-
deflùs & au-deflous du rang du gouvernail. B é ,
B b y B b barfes de milieu. A a 3Aa barres à talon.
Il f . Rang de quatre barres ; il eft employé deux fo is ,
au-deflus 8c au-deflous des rangs précédens. B b,
B b barres dé milieu. A a , A a barres à talon.
lt(». Rang de trois barres; il eft employé deux fois, au-
deflus &-aù-deflbus des rangs précédens. B é barre
de milieu. A a , A a barres à talon.
117. Rang de deux barres ; il eft employé deux fois,, au-
deflus 8c au-deflous des rangs précédens. A a , A a
barres à talon.
;J8. Rang d’une barre ou couverture , employé auffi
deux fois, au-deflus & au-dëffous du paquet de
bras. C c couvertures.
Toutes les barres qui compofent urt paquet doi-
. vent être pofées en liaifon les unes fut les autres,
enforte que le plein de l’une recouvre les joints
des deux autres, comme on le Voit dan b l ê s j k Ai
f & 6 de cette Planche.
Il réfulte de ce qur vient d^tre dit, que fancré
dé 6000 livres; dont nous allons fuivre la fabrication,
eft compoféc de cént cinq barres; trènté-
cinq barres pour le paquet dont on doit former là
R P & autant pour les paquets dont chacun
des bras doit être formé.
Dans chaqiiepaqtiêt le géovéï-n«! Gélfliri&liiéï
les barres B B B O* dé milieu font au nombre dé
quatorze; les barres à talon A A A & au nombré
de dix - huit ; & les couvertures G C au nombre dé
deux.
Les ancres àu-deflbüs de jo ô Iiv. {uiqü'à z iô b Hv;
font compofées de7 y barres, z f barres pour le paquet
de la verge ; autant pour les paqüets de chaque brasi
Dans chaque paquet dont h figure j . repréfenté la cOupé;
le gouvernail G eft unique, les barres de milieu B B B &
font au nombré de huit ; les barres à talon A A Ad*
font au nombre de quatorze, 8c les Couvertures C C ait
nombre de deux.
_ Les ancrés au-deflbiis de zôôq liv.;fufqüa 900 îiv;'
font compofées de 4 y barres, 1 y barrés pour le paquefc
de la verge , autant pour lés paquets de chaque braS;
Dans chaque paquet dont la fig . 4. repréfenre la coupe,
: le gouvernail G eft unique ; les barres du milieu B B font
au nombre de deux ; les barrés à talon A A A d 1 du nombre
de fix , & les couvertures C C au nombre, de deuXi
Les ancres au-deflous de 800 livrés julqu’a y 00 livres
, font compofées dé Z7 barres, neuf barres pour lé
paquet dont la vergé doit être formée, autant pour les
paquets de chaque bras. Dans chaque paquet dont la f ig .
y. repréfente la coupe, lé gouvernail G eft unique,' les
barres à talon A A A d 1 au nombre de fix ; les couvertures
C C au nombre de deux.
Les anefes au-deflous de 406 Iiv. juiqu’à 30ÔHV. font
, compofées de quinze barres, cinq barres pour le paquet
de la ve rg e , alitant pour lés paqüets de chaqué
bras. Dans chaque paquet ddnt la fig . %. repréfente la
| coupe, le gouvernail G eft unique ; les barres à talon
A A font au nombre de deux, de mêffle que les couvertures
C C ; lés barres à talon dans ces paquets diffe-
; rent de celles des paquéts précédens, en ce qu’elles ont
| un tâloi^le chaque côté, comme en ont toutes les cou*
■ vertures;
Les àncrës aü-deffous du poids dé 206 liV. font compofées
de neuf barres, trois barrés pour lfe paquet de là
v e rg e , autant pour les paquets de chaque braS. Chaqué
paquet dont la fig . 1. repréfente la coupe, eft compofé
du gouvernail G & de deux couvërturés C G.
P L A N C H E V I L
La vignette repréfenre une partie de i’intêriéiir
de la fo rg e ,& l’opération de fouder ou étirer là
verge.
On voit eh A lé chandelier de fonte de fer fur
le fommet duquel roule le pivot dè l’arbre du marteau
; cé chandelier a deux piés & demi en quarré
a fa bafe, & autant de hauteur aii-défllls du fol de
la forge ; l’extrémité de l’arbre garni de frettes de
fe r, àinfi qu’il à été dit, eft défendue de la grande
ardeur du fe#* chaud placé fut l’ertclüme, par une
forte plaqué dé tôle qü’on noffime couvercle. N
hus dans laquelle le manche dü marteau eft fixé. P
braye de fer dont le manche du rtiarteaüeft garni à
l’endroit où les bras de l’arbrë tournant le ren*
contrent pour l’élever. P le marteau. S l'enclume;
K L aiguilllc ou clé tirante qüi ferre lés jambes dans
les entailles du drotne A ; au-deflus dé là clé & en*
tre les deüx jambes on Voit lé tafléau, placé entré
la clé 8c la face inférieure du dromè. M Je reflort
qüi renvoyé avec force ce matteaü fur l’enclume;
T , t les foürchettés placées au devant de l’en-
Clume. bby c e , d d grüe, à il’extrémité dii'bras
de laquelle le paquét de la verge' èft fufpendu aii
moyen de la crémaillère repréfentée Planche III.-
fig t 1 1 . W foffe de la chaufferie des bras, réeou*
B