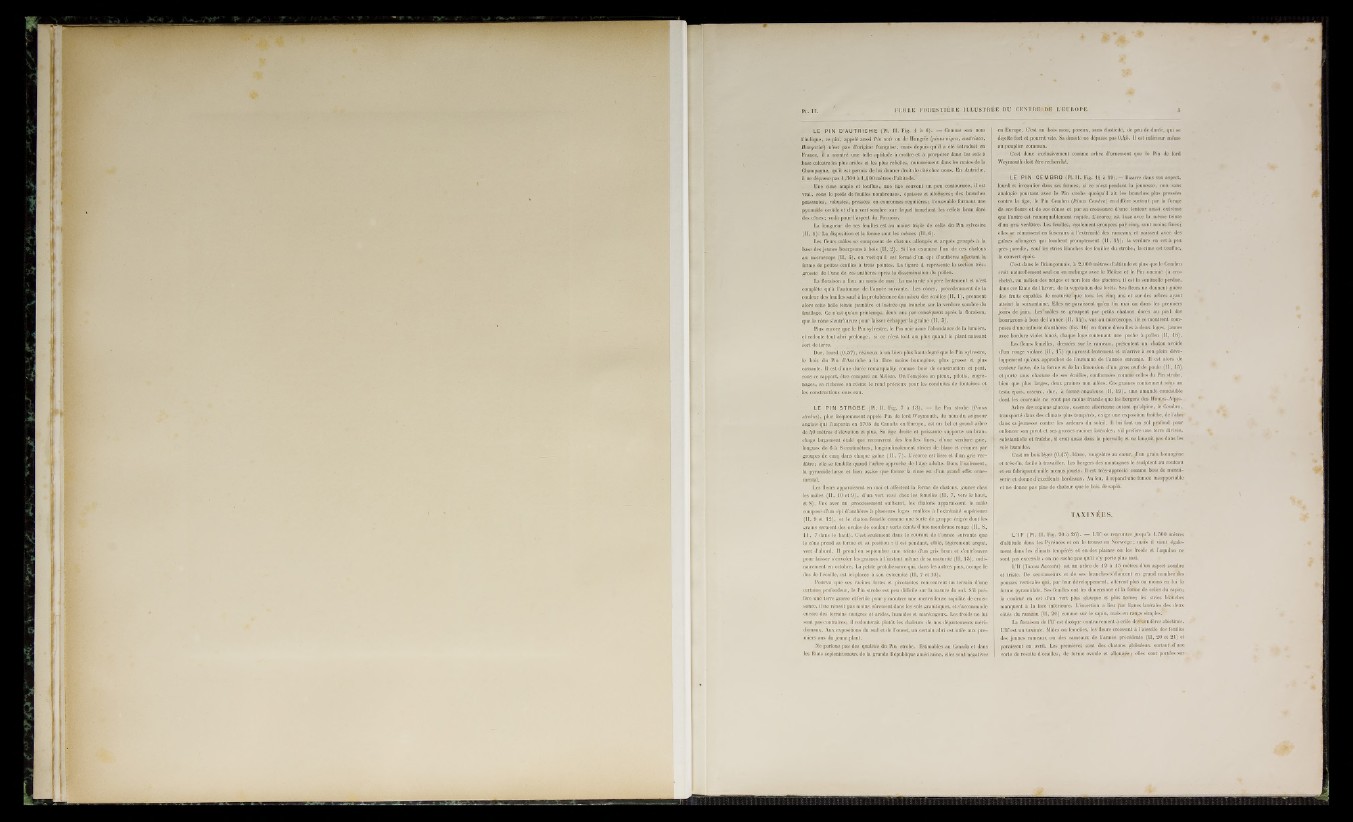
i:3s LE-;PIN D'AUTRICHE (Pl. II. Fig. A h 6):i ,— Comme son nom
l’indique, ce pin', appelé aussi Pin noir ou de Hongrie (pinusnigra, auslriaca,
Ilungarioe) n’est pas 'd’origine française, mais depuis qu'il a été introduit en
France, Il a montré une telle aptitude h croître et à prospérer dans les sols à
base calcaire les plus arides et les plus rebelles, nommément dans les craies de la
Champagne, qu'il-est permis de lui donner droit de cité chez nous. En Autriche,
il ne dépasse pas 1 ,300 àl.AOO mètres d’altitude.
. . Une cime , ample et toulTue; une tige souvent un peu contournée, il est
yrai, sous le poids de feuilles nombreuses, épaisses et allongées.; des branches
puissantes, robustes, pressées en couronnes régulières ; l’ensemble formant une
pyramide ovoïde et d’un vert sombre sur lequel tranchent les reflets brun dqré
des cènes ; voilà pour l’aspect du Pin noiiv, --
La longueur de ses feuilles est au moins triple de celle du Pin sylvestre
(II, i ) i La disposition et la forme sont les mêmes (11,0).
Les fleurs mâles se composent de chatons allongés et. arqués groupés h la
base des jeunes bourgeons à bois (II, 2). Si l'on examine l’un de 'ces chatons
au microscope (II, 3), on voit qu'il est formé d'un épi d'anthères affectant la
forme de petites écailles à trois pointes. La Ggure A représente la section très—
■ grossie de l’une de ces anthères après la dissémination du pollen.
La floraison a lieu au mois de mai. La maturité s’ôpère lentement et n'est
complète qu’à l’automne de l'année suivante. Les cènes, précédemment de la
couleur des feuilles sauf à la protubérance du milieu des écailles (II, 1), prennent
alors celle belle teinte jaunâtre et lustrée qui tranche sur la verdure sombre du
feuillage. Ce n'est qu'au printemps, deux ans par conséquent après la floraison,
que le cône s'entr’ouvre pour laisser échapper la graine (II, 5).
Plus encore que le Pin sylvestre, le Pin noir aime l’abondance dé la lumière,
et redoute tou.t abri prolongé, si ce n'est tout au plus quand le plant naissant
sort de terre.
Dur, lourd (0,57), résineux à un bien plus haut-degré que le Pin sylvestre,
le bois du Pin d'Autriche a la'fibre- moins homogène, plus grosse et plus
cassante. 11 est d’une durée remarquable comme bois de construction et peut,
sous ce rapport, être comparé au Mélèze. On l'emploie en pieux, pilotis, engrenages
; sa richesse en résine le rend précieux pour les conduites de fontaines cl
les constructions sous eau.
LE PIN STROBE, (PI, II. Fig. 7 à 13). — Le Pin slrobe {Pinus
slrobus), plus fréquemment appelé Pin de lord Woymoulh, du nom du seigneur
anglais qui l'importa en 1705 du Canada en Europe, est un bel et grand arbre
de A0 mètres d'élévation et plus. Sa tige droite et puissante supporte un branchage
largement étalé que recouvrent des feuilles fines, d'une verdure gaie,
longues de 6 à 8 centimètres, longitudinalement striées do blanc et réunies par
groupes de cinq dans chaque gaine ( II, 7 ). L’écorce est lisse et d'un gris verdâtre;
elle se fendille quand l'arbre approche de l'âge adulte. Dans l’isolement,
la pyramide large et bien assise que forme' la cime est d’un grand effet ornemental.
Les fleurs apparaissent en mai et affectent la forme de chatons, jaunes chez
les mâles (II, 10 et 9 ) , d’un vert rosé chez les femelles (II, 7, vers le haut,
et: 8). Vus avec un grossissement suffisant, les chatons apparaissent le mâle
composé d’un épi d'anthères à plusieurs loges renflées à l’extrémité supérieure
(II, 9: et 12), et le chaton femelle comme une sorte de grappe érigée dont les
grains seraient des ovules de couleur verte ceints d'une membrane rouge (II, 8,
11, 7 dans le haut). C’est seulement dans le courant de l'année suivante que
le cône prend sa forme et sa position ; il est pendant, eflilé, légèrement arqué,
vert d’abord. 11 prend en septembre une teinte d’un gris brun et s’entr’ouvre
pour laisser s’envoler les graines à l’instant même de sa maturité (II, 13), ordinairement
en octobre. La petite protubérance qui, dans les autres pins, occupe le
Pourvu que ses racines fortes et pivotantes rencontrent un terrain d'une
certaine profondeur, le Pin slrobe est peu difficile sur la nature du sol. S’il préfère
une terre grasse et fertile pour y montrer une merveilleuse rapidité de croissance,
il ne réussit pas moins sûrement dans les sols granitiques, et s’accommode
encore des terrains maigres et arides, humides et marécageux. Les froids ne lui
sont pas contraires; il redouterait plutôt les chaleurs de nos départements méridionaux.
Aux expositions du sud et do l’ouest, un certain abri est utile aux pre-
No parlons pas des qualités du Pin slrobe. Estimables au Canada et dans
les États septentrionaux do la grande République américaine, elles sont négatives
en Europe. C’est un bois mou; poreux, sans élasticité, de peu de durée, qui se
déjette fort et pourrit vite. Sa densité ne dépasse pas 0,A5.11 est inférieur même
au peuplier commun.
C'est donc exclusivement comme arbre d’ornement que le Pin de lord
Wcymoulh doit être recherché.
LE P.l N CE M BRO (Pl. II. Fig. 1A à 19). — Bizarre dans son aspect,
lourd et -irrégulier dans ses formes., si ce n’est pendant la jeunesse, non sans
analogie pourtant avec le Pin slrobe quoiqu’il ait les branches plus pressées
contre la tige, le Pin Cembro (Pinus Cembra) en diflere surtout par la forme
de ses fleurs cl de ses cènes et par sa croissance d’une lenteur aussi extrême
que l’autre est remarquablement rapide. L'écorce, est lisse avec la même teinte
d'un gris verdâtre. Les feuilles, également groupées par cinq, sont moins fines ;
elles se réunissent en faisceaux à l'extrémité des rameaux et naissent avec des
gaines allongées qui tombent promptement (II, 1A); la verdure en est à peu
près pareille, sauf les stries blanches des feuilles du slrobe; la-cime est touffue,
le couvert épais;
C’est dans le Briançonnais, à 2,000 mètres d’altitude et plus que le Cembro
croit naturellement seul ou en mélange avec le Mélèze et le Pin oncinié (à crochets),
au'milieu des neiges et'non loin des glaciers; 11 est la sentinelle perdue,
dans ces États de l'hiver, de la végétation des forêts. Scs fleurs ne donnent guère
des fruits capables de maturité^que tous les cinq ans et sur des arbres ayant
atteint la . soixantaine. Elles ne paraissent qu’en fin mai ou dans 'lès premiers
jours de juin. Les* mâles se groupent par petits chatons dorés au pied des
bourgeons à bois del’année-(II, 1A) ; vus au microscope, ils se montrent composés
d'une inGnité d'anthères (fig. -16) en forme d'écailles à deux loges, jaunes
avec bordure violet foncé, chaque loge contenant une poche à pollen (II, 18).
Les fleurs femelles, dressées sur le rameau, présentent un chaton ovoïde
d’un rouge violacé (II, 17): qui grossit lentement et n’arrive à son plein développement
qu’aux approches do l'automne de l'année suivante. Il' est alors de
couleur fauve, de la forme et de. la dimension d’un gros oeuf de poule (II, 15).
et porte sous chacune de ses écailles, conformées comiile celles du Pin slrobe,
bien que plus larges, deux graines non ailées. Ces graines contiennent sous un
testa épais, osseux, dur, à forme anguleuse (II, 19), une amande comestible
dont les écureuils ne sont pas moins friands que les bergers des Haules-AIpes.
Arbre des régions glacées, essence sibérienne autant qu'alpine, le Cembro,
transporté dans des climats plus tempérés, exige une exposition fraîche, de l'abri*"
dans sa jeunesse contre les ardeurs du soleil. Il lui faut un sol profond pour
enfoncer son pivot et scs grosses racines latérales ; s’il préfère une terre divisée,
substantielle et fraîche, il croit aussi dans la pierraille et ne languit pas dans les
sols humides. s
C’est un bois léger (0,A5)> blanc, rougeâtre au coeur, d’un grain homogène
et très-lin, facile à travailler. Les bergers des montagnes lé sculptent au couteau
et en fabriquent mille menus jouets. Il est très-apprécié comme bois de menuiserie
et donne d’excellents bardeaux. Au feu, il répand une fumée insupportable
et ne donne pas plus de chaleur que le bois de sapin.'
r. 20 à L 'IF (Pl. 2 ■ L’If si [u’à 1.500 n
d’altitude dans les Pyrénées et on le trouve en Norwége ; mais il vient également
dans les climats tempérés et en des plaines où les froids et l'aquilon ne
sont pas excessifs : on ne sache pas qu'il s'y porte plus mal.
L'If (Taaw Baccata) est un arbre de 12 à 15 mètres d'un aspect sombre
et triste. De ses-rameaux et de ses branches’s'élancent en grand nómbrenles
pousses verticales qui, par leur développement, altèrent plus ou moins en lui la
forme pyramidale. Ses feuilles ont les dimensions et la forme de celles du sapin;
la couleur en est d'un vert plus glauque e.l plus terne; les stries blanches
manquent à la face inférieure. L’insertion a lieu par lignes latérales des deux
cétés du rameau (II, 20) comme sur le sapin, mais en rangs simples.
La floraison de l’If est dioïque contrairement a celle dçstcônifères abiélinés. ¡
L’If est un tasmée. Mâles ou femelles, les fleurs croissent à l'aisselle des feuilles
des jeunes rameaux ou des rameaux de l’année précédente (II, 20 et 21) et
paraissent en avril. Les premières sont des chatons globuleux sortant .d’une
sorte de rosette d'écailles, de forme ovoïde et allongée; elles sont portées sur