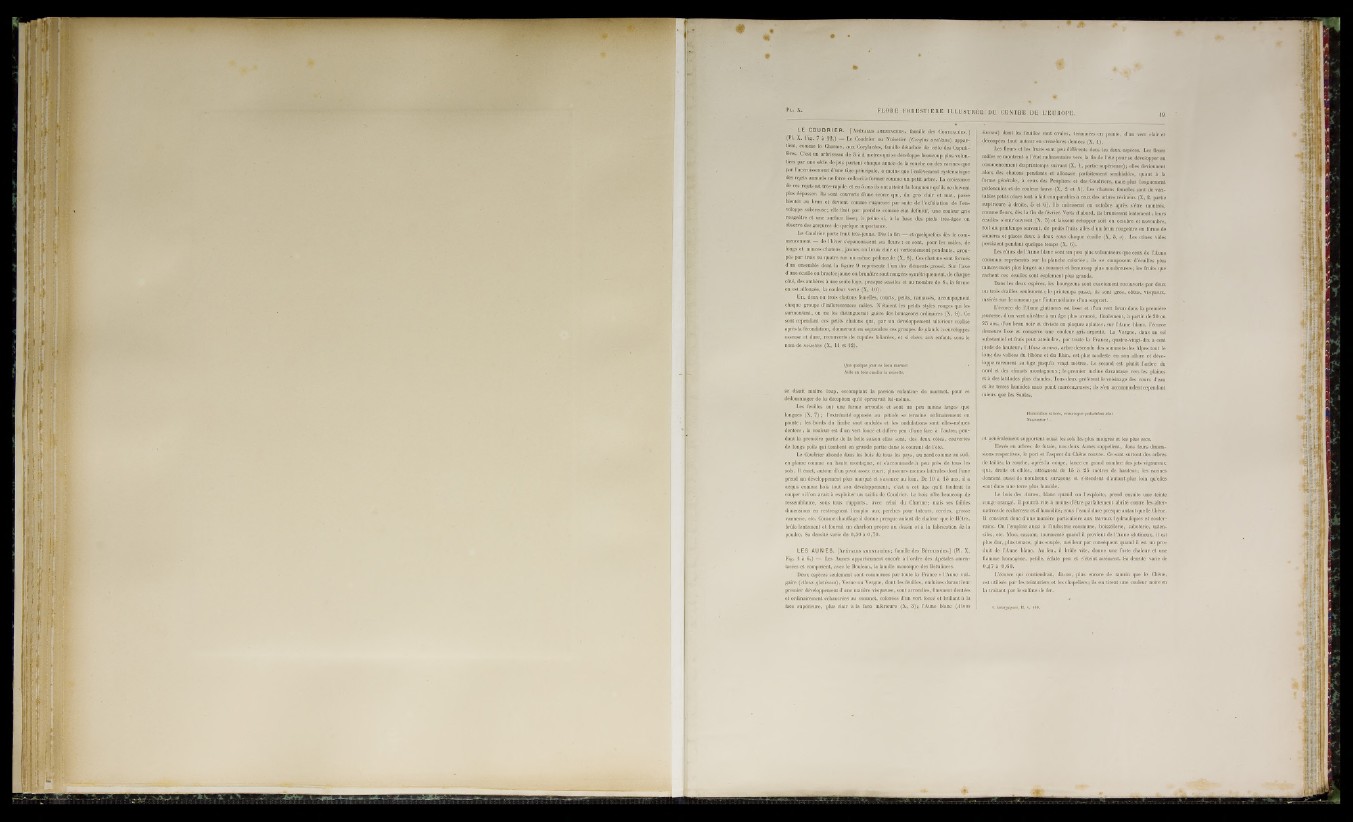
i l » ®
1
a
v Ih!
| LE'COUjDRIER. [Apîtales aubntacées; famille des Cobïlacéks.]
(Pl. X. Fig. 7 à 12.) — Le Coudrièr ou Noisetier (Corylus ayeltàna). appan-,
tient, comme le Cbarme, aux Corylacées, famille détachée de celle'dés Ctipuli-
lères. C’est un arbrisseau de 3 h ft. mètres qui se développe beaucoup phis volontiers
par une série de jets partant chaque année de la souche ou des racines que
par l’accroissement d’une tige principale, à moins que l’enlèvement systématique
des rejets annuels ne force celle-ci à former comme un petit arbre. La croissance
de ces rejels.est très-rapide et en 5 ans ils ont atteint la longueur qu’ils ne doivent
plus dépasser. Ils sont couverts d’une écorce qui, du gris clair et mat, passe
bientôt au brun et devient comme rugueuse par suite cle'l’exfoliation de l’eh-
veloppe subéreuse; elle Gnit par prendre commè étal définitif,'une couleur gris
rougeâtre et une surface lisse; h peine si, à la base des pieds très-âgés on
observe des gerçures de quelque importance.
Le Coudrier porte fruit très-jeune. Dès la Gn — et quelquefois dès le commencement
— de l’hiver s’épanouissent ses Geurs : ce sont, pour les mâles, de
longs et minces chatons, jaunes ou brun clair et verticalement pendants, groupés
par trois ou quatre sur un même pédoncule (Xj.iï); Ces chatons sont formés
«Fun ensemble dont la Ggure 9 représente l’un des éléments grossi. Sur' l'axe
d’une écaille ou bractée jaune ou brunâtre sont rangées symétriquement, de chaque
côté, des anthères h une seule loge, presque sessiles et au nombre de 8 ; la forme
en est allongée, la couleur verte (X, 10).
Un, deux ou trois chatons femelles, courts, petits, ramassés, accompagnent
chaque groupe d'inGorescences mâles. N'étaient les petits styles rouges qui les
surmontent, on ne les distinguerait guère des bourgeons ordinaires (X, 8). Ce
sont cependant ces petits chatons qui, par un développement ultérieur réalisé
après la fécondation, donneront en septembre ces groupes de glands à enveloppes
osseuse et dure, recouverts de cupules foliacées, et si chers aux enfants sous le
nom de noisettes (X, 11 et 12).
se disait maître loup, escomptant la passion enfantine du marmot, pour se
dédommager de la déception qu'il éprouvait lui-même.
Les feuilles ont une forme arrondie et sont un peu moins larges que
longues (X, 7) ; l'extrémité opposée au pétiole se termine ordinairement en
pointe; les bords du limbe sont ondulés et les ondulations sont elles-mêmes
dentées; la couleur est d'un vert foncé et diffère peu d’une face à l'autre; pendant
la première partie de la belle saison elles sont, des deux côtés, couvertes
de longs poils qui tombent en grande partie dans le courant de l’été.
Le Coudrier abonde dans les bois de tous les pays, au nord comme au sud,
en plaine comme en haute montagne, et s'accommode h peu près de tous les
sols. Il émet, autour d’un pivot assez court, plusieurs racines latérales dont l’une
prend un développement plus marqué et s'avance au loin. De 10 à 15 ans, il a
acquis comme bois tout son développement; c’est a cet âge qu’il faudrait le
couper si l’on avait à exploiter un taillis de Coudrier. Le bois oRre beaucoup de
ressemblance, sous tous rapports, avec celui du Charme; mais ses faibles
dimensions en restreignent l'emploi aux perches pour tuteurs, cercles, grosse
vannerie, etc. Comme chauffage il donne presque autant de chaleur que le Hêtre,
brûle lentement et fournil un charbon propre au dessin et à la fabrication do la
poudre. Sa densité varie de 0,50 h 0,70.
LES AU N ES. [Apûtalbs amenïacébs-, famille des BéTUUNées.] (Pl. X.
Fig. i h 6.) —■ Les Aunes appartiennent encofe h l'ordre des Apétales amen-
lacées et composent, avec le Bouleau, la famille monoïque des Bétulinées.
Doux espèces seulement sont communes par toute la France : l’Aune vulgaire
(Mnus glutinosa), Verne ou Vergne, dont les feuilles, enduites durant leur
premier développement d’une matière visqueuse, sont arrondies, Gncment dentées
et ordinairement échancrées au sommet, colorées d'un vert foncé et brillant à la
faco supérieure, plus clair à lu face inférieure (X, 3); l'Aune blanc (Alnus
incana) dont les feuilles sont ovales, terminées en pointe, d'un vert clair et
découpées tout autour en crénelures dentées (X, 1).
Les Geurs et les fruits sont peu différents dans les deux espèces. Les Geurs
mâles se montrent à l'état rudimentaire vers, la Gn de l'été pour se développer au
commencement du printemps suivant (X, 1, partie supérieure); elles deviennent
alors des chatons pendants et allongés, parfaitement semblables, quant h la
fqrme générale, à ceux des Peupliers et des:Coudriers, mais plus longuement
pédonculés et de couleur fauve (Xi 2 et A). Les chatons femelles sont de véritables
petits cônes tout h fait comparables h ceux des arbres résineux (X, 2, partie
supérieure h droite, 5 et 6).' Ils mûrissent en octobre après s’être montrés,
comme fleurs, dès la Gn de février. Verts d’abord, ils brunissent lentement ; leurs
écailles s’entr’ouvrent (X, 5) et laissent échapper soit en octobre et novembre,
soit au printemps suivant, de petits fruits ailés d’un brun rougeâtre en forme de
samares et placés deux à deux sous chaque écaille (X, 5, o). Les cônes vides
persistent pendant quelque temps (X, 6).
Les cônes de l’Aune blanc sont un peu plus volumineux que ceux de l’Aune
commun représentés sur la planche coloriée ; ils se composent d’écailles plus
minces mais plus larges au sommet et beaucoup plus nombreuses; les fruits que
cachent ces écailles sont également plus grands.
Dans les deux espèces, les bourgeons sont exactement recouverts par deux
ou trois écailles seulement ; le printemps passé, ils sont gros, obtus, visqueux,
insérés sur le rameau par l’intermédiaire d’un support. .
L’écorcc de l’Aune glutineux est lisse et d’un vert brun dans la première
jeunesse, d’un vert olivâtre h un âge plus avancé, finalement, à partir de 20 ou
25 ans, d’un brun noir et divisée en plaques aplaties; sur l’Aune blanc, l’écorce
demeure lisse et conserve une couleur gris argenté. La Vergne, dans un sol
substantiel et (rais peut atteindre, par toute la France, quatre-vingt-dix à cent
pieds de hauteur; l’/Unus incana, arbre descendu des sommets des Alpes tout le
long des vallées du Rhône et du Rhin, est plus modeste en son allure et développe
rarement sa tige jusqu’à vingt mètres. Le second est plutôt l’arbre du
nord et des climats montagneux ; le premier incline davantage vers les plaines
et à des latitudes plus chaudes. Tous deux préfèrent le voisinage des cours d’eau
et les terres humides mais point marécageuses; ils s’en accommodent cependant
mieux que les Saules,
et généralement supportent aussi les sols les plus maigres et les plus secs.
Élevés en arbres de futaie, nos deux Aunes rappellent, dans leurs dimensions
respectives, le port et l’aspect du Chêne rouvre. Ce sont surtout des arbres
de taillis; la souche, après la coupe, lance en grand nombre des jets vigoureux
qui, droits et effilés, atteignent de 15 à 25 mètres de hauteur; les racines
donnent aussi de nombreux surgeons et s'étendent d'aulanl plus loin qu’elles
sont dans une terre plus humide.
Le bois des Aunes, blanc quand on l’exploite, prend ensuite une teinte
rouge orangé. Il pourrit vite à moins d’être parfaitement abrité contre les alternatives
de sécheresse cl d'humidité; sous l'eau il dure presque autant que le Chêne.
11 convient donc d'une manière particulière aux travaux hydrauliques et souterrains.
On l’emploie aussi à l'industrie commune, boissellerie, saboterie, ustensiles,
etc. Mou, cassant, tourmenté quand il provient de l’Aune glutineux, il est
plus dur, plus tenace, plus souple, meilleur par conséquent quand il est un produit
de l’Aune blanc. Au feu, il brûle vile, donne une forte chaleur et une
flamme homogène, pétillé, éclate peu et s'éleinl aisément. Sa densité varie de
0.A7 à 0,60,
L'écorce qui contiendrait, dit-on, plus encore de tannin que le Chêne,
est utilisée par les teinturiers et les chapeliers ; ils en tirent une couleur noire en
la traitant par le sulfate de fer.
P l i
Ü il
-* ti
M | | | i II
A
WMi
l 'M m i
f i l
p l i ill
fil
1#
1 1
i■l1i