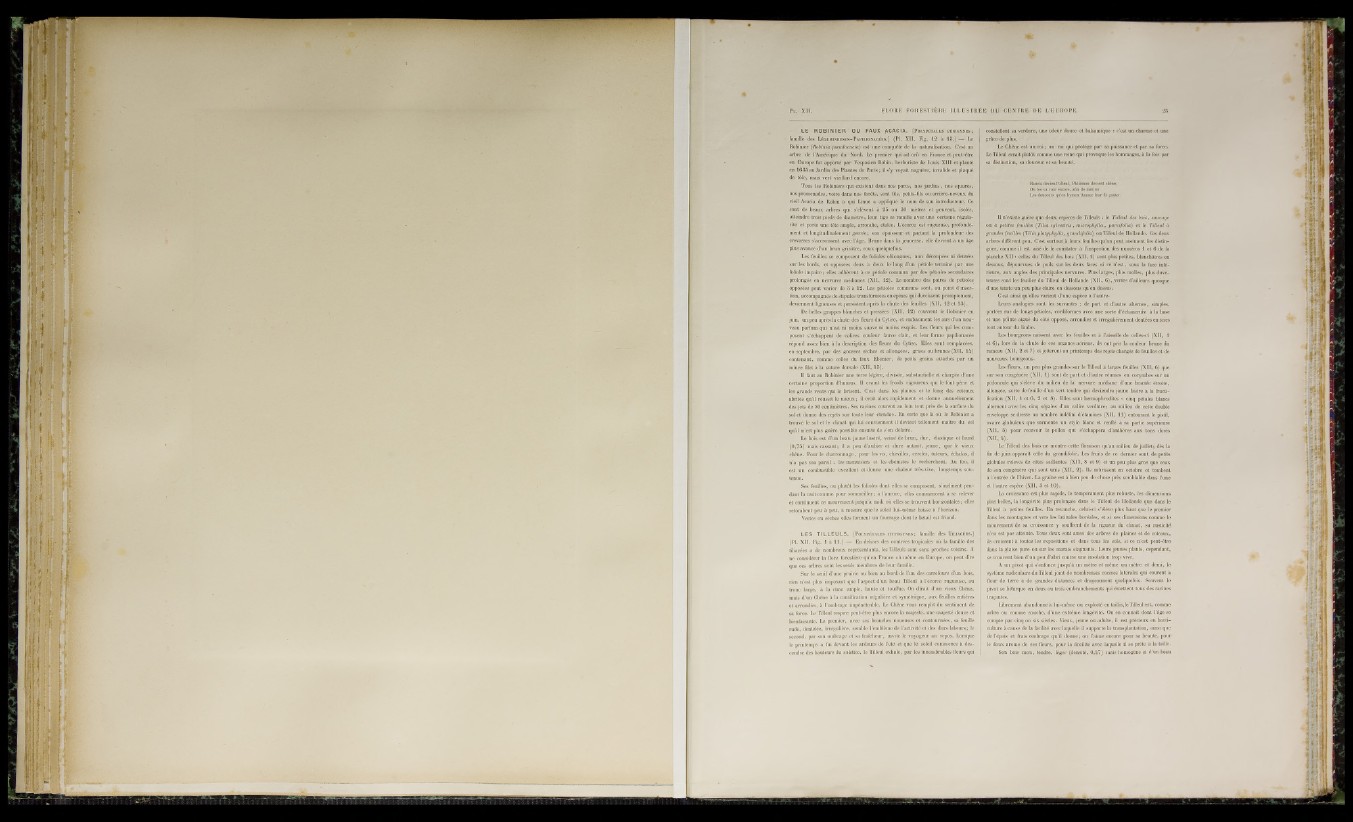
il
- LE ROBINIER- OU FAUX ACACIA.. [Polïpéïales pébigynes;
• famille des Légumineuses-Papilionacées.] (Pl. XII. Fig. 12 à 15.)— Le
Robinier (Itobinia pseudacacia) est une conquête de la naturalisation. C'est un
arbre de l’Amérique du Word. Le premier qui ait cru en France et peut-être
en Europe fut apporté par Vespasien Robin, herboriste de Louis XIII et planté
en 1635 au Jardin des Plantes de Paris ; il s’y voyait naguère, invalide et plaqué
- de tôle, mais vert vieiüard encore.
Tous les Robiniers qui existent dans nos parcs, nos jardins, nos squares,
nos promenades, voire dans nos forêts, sont Gis, pelils-GIs ou arrière-neveux du
vieil Acacia de Robin à qui Linné a appliqué le nom de son introducteur. Ce
sont de beaux arbres qui s'élèvent à 25 ou 30 mètres et peuvent, isolés,
atteindre trois pieds de diamètre-; leur tige se rami&e avec une certaine régularité
et porte une tête ample, arrondie; étalée. L’écorce est rugueuse, profondément
et longitudinalement gercée ; son épaisseur et partant la profondeur des
crevasses s'accroissent avec l’âge. Brune dans la jeunesse, elle devient a un âge
plus avancé d’un brun grisâtre, roux quelquefois.
Les feuilles se composent de folioles oblongues, non découpées ni dentées
sur les bords, et opposées deux à deux le long 'd’un pétiole terminé par une
foliole impaire ; elles adhèrent à ce pétiole commun par des pétioles secondaires
prolongés en nervures médianes (XII, 12). Le nombre des paires de pétioles
opposées peut varier de 3 à 12. Les pétioles communs sont, au point d’insertion,
accompagnés de stipules transformées en épines qui durcissent promptement,
deviennent ligneuses et persistent après la chute des feuilles (XII, 12 et 13).
De belles grappes blanches et pressées (XII, 12) couvrent le Robinier en
juin, un peu après la chute des fleurs du Cytise, et embaument les airs d’un nouveau
parfum qui n’est ni moins suave ni moins exquis. Les fleurs qui les composent
s’échappent de calices couleur fauve clair, et leur forme papilionacée
répond assez bien à la description des fleurs du Cytise. Elles sont remplacées,
en septembre, par des gousses sèches et allongées, grises ou brunes (XII, 14)
contenant, comme celles du faux Ébénier, de petits grains attachés par un
mince Blet à la suture dorsale (XII, 15).
Il faut au Robinier une terre légère, divisée, substantielle-et chargée d’une
certaine proportion d’humus. Il craint les froids rigoureux qui le font périr et
les grands vents qui le brisent. C’est dans les plaines et le long des coteaux
abrités qu’il réussit le mieux ; il croit alors rapidement et donne annuellement
des jets de 50 centimètres. Ses racines courent au loin tout près de la surface du
sol et donne des rejets sur toute leur étendue. En sorte que lit où le Robinier a
trouvé le sol et le climat qui lui conviennent il devient tellement maître du sol
qu’il n’est plus guère possible ensuite de s’en défaire.
Le bois est d’un beau jaune lustré, veiné de brun, dur, élastique et lourd
(0,75) mais cassant; il a peu d’aubier et dure autant, jeune, que le vieux
chêne. Pour le charronnage, pour les vis, chevilles, cercles, tuteurs, échalas, il
n’a pas son pareil : les menuisiers et les ébénistes le recherchent. Au feu, il
est un combustible excellent et donne une chaleur très-vive, longtemps sou-
Ses feuilles, ou plutôt les folioles dont elles se composent, s'inclinent pendant
la nuit comme pour sommeillor ; h l'aurore, elles commencent ù se relever
et continuent ce mouvement jusqu'il midi où elles se trouvent horizontales ; elles
retombent peu à peu, à mesure que le soleil lui-même baisse ù l'horizon.
Vertes ou sèches elles forment un fourrage dont le bétail est friand.
L ES TILLEULS. [Polypétaebs hypogynes; famille des Tiuacébs.]
(Pl. XII. Fig. 1 h 11.) — En dehors des contrées tropicales où la famille des
tiliacées a de nombreux représentants, les Tilleuls sont sans proches voisins. A
ne considérer la flore forestière qu’en France où même en Europe, on peut dire
que ces arbres sont les seuls membres de leur famille.
Sur le seuil d'une prairie ou bien au bord do l’un des carrefours d’un bois,
rien n’est plus imposant que l'aspect d'un beau Tilleul ii l'écorce rugueuse, au
tronc large, il la cime ample, liante et toufliie. On dirait d'un- vieux Chêne,
mais d’un Chêne It la ramification régulière et symétrique, aux feuilles entières
et arrondies, il l'ombrago impénétrable. Le Chêne vous remplit du sentiment de
sa forep. Le Tilleul respire peut-être plus encore la majesté, une majesté douce et
bienfaisante. Le premier, avec ses branches noueuses et contournées, sa feuille
rude, dentelée, irrégulière, semble l'emblèmode l'activité et des durs labeurs;, le
second, par son ombrage et sa fraîcheur, invite le voyageur au repos. Lorsque
lo printemps a fui devant les ardeurs dé l'été et que le soleil commence ù descendre
des hauteurs du solstice, lo Tilleul exhale, par les innombrables fleurs qui
constellent sa verdure, une odeur douce et balsamique : c'est un charme et une
grâce de .plus.
Le Chêne est un roi; un roi qui protège par sa puissance et par sa force.
Le Tilleul serait plutôt comme Une reine qui provoque les hommages, h la fois par
sa distinction, sa douceur et sa beauté.
Il n’existe guère que deux espèces do Tilleuls : le Tilleul des bois, sauvage
ou à petiles feuilles (Tilia sylvestris, micropkiglla, paroi folia) et le Tilleul à
grandes feuilles (Tilia platypliylla, grandifolia) ou Tilleul de Hollande. Ces deux
arbres, diffèrent peu. C'est surtout à leurs feuilles qu’on peut aisément les distinguer,
comme il est aisé de le constater ù l'inspection des numéros 1 et 6 de la
planche XII : celles du Tilleul des bois (XII, 1) sont plus petites, blanchâtres en
dessous, dépourvues de poils sur les deux faces si ce n'est, sous la face inférieure,
aux angles des principales nervures. Plus larges, plus molles, plus duveteuses
sont les feuilles du Tilleul de Hollande (XII, 6 ),.vertes d'ailleurs quoique
d'une teinte un peu plus claire en dessous qu'en dessus.
‘ C’est ainsi qu'elles varient d’une espèce ù l’autre.
Leurs analogies sont les suivantes : de part et d'autre alternes, simples,
portées sur de longs pétioles, cordiformes avec une sorte d'échancrure à la base
et Une-pointe aiguë du côté opposé, arrondies et irrégulièrement dentées en scies
tout autour du limbe.
Les bourgeons naissent avec les feuilles et à l'aisselle de celles-ci (XII, 1
et 6); lors de la chute de ces organes aériens, ils ont pris la couleur brune du
rameau (XII, 2 et 7) et jetteront au printemps des rejets chargés de feuilles et de
Les fleurs, un peu plus grandes sur le Tilleul à larges feuilles (XII, 6) que
sur son congénère (XII, 1) sont de part et d’autre réunies en corymbcs sur un
pédoncule qui s'élève du milieu de là nervure médiane d'une bractée étroite,
allongée, sorte de feuille d'un vert tendre qui deviendra jaune bistre à la fructification
(XII, 1 et 6, 2 et S). Elles sont hermaphrodites : cinq pétales blancs
alternent avec les cinq sépales d’un calice verdâtre; au milieu de cette double
enveloppe se dresse un nombre indéfini d'étamines (XII, 11) entourant le pistil,
ovaire globuleux que surmonte un style blanc et renflé à sa partie supérieure
(XII, 5) pour recevoir le pollen qui s’échappera d’anthères aux tons dorés
(XII, A).
Le Tilleul des bois ne montre cette floraison qu'au milieu de juillet; dès la
fin de juin apparaît celle du grandifolié. Les fruits de ce dernier sont de petits
globules relevés de côtes saillantes (XII, 8 et 9) et un peu plus gros que ceux
de son congénère qui sont unis (XII, 2). Ils mûrissent en octobre et tombent
ù l’entrée de l'hiver. La graine est à bien peu de chose près semblable dans l'une
et l'autre espèce (XII, 3 e t 10).
La croissance est plus rapide, le tempérament plus robuste, les dimensions
plus belles, la longévité plus prolongée dans le Tilleul de Hollande que dans le
Tilleul h petites feuilles. En revanche, celui-ci s'élève plus haut que le premier
dans les montagnes et vers les latitudes boréales, et si ses dimensions comme le
mouvement de sa croissance y souffrent de la rigueur du climat, sa rusticité
n'en est pas atteinte. Tous deux sont aussi des arbres de plaines et de coteaux,
ils croissent à toutes les expositions et dans tous les sols, si ce n'est peut-être
dans la glaise pure ou sur les marais stagnants. Leurs jeunes plants, cependant,
se trouvent bien d'un peu d’abri contre une insolation trop vive.
A un pivot qui s’enfonce jusqu’à un mètre et même un mètre et demi, le
système radiculaire du Tilleul joint de nombreuses racines latérales qui courent à
fleur de lërre à de grandes distances et drageonnent quelquefois. Souvent le
pivot se bifurque en deux ou trois embranchements qui émettent tous des racines
traçantes.
Librement abandonné à lui-même ou exploité en taillis,le Tilleul est, comme
arbre ou comme souche, d’une extrême longévité. On en connaît dont l'âge se
compte par cinq ou six siècles. Vieux, jeune ou adulte, il est précieux en horticulture
à cause de la facilité avec laquelle il supporte la transplantation, ainsi que
de l'épais et frais ombrage qu'il donne; on l'aime encore pour sa beauté, pour
le doux arôme de ses fleurs, pour la docilité avec laquelle il se prête à la taille.
Son bois mou, tendre, léger (densité, 0,47) mais homogène et d’un beau
r1
Ml iI ff , fji1ni
i1I
II!
W> { « a il
i¡jfj iwl l
j l i If!
f | |
? I
4fff
Î Ü ï i l
i l i a
MKS® I
i l