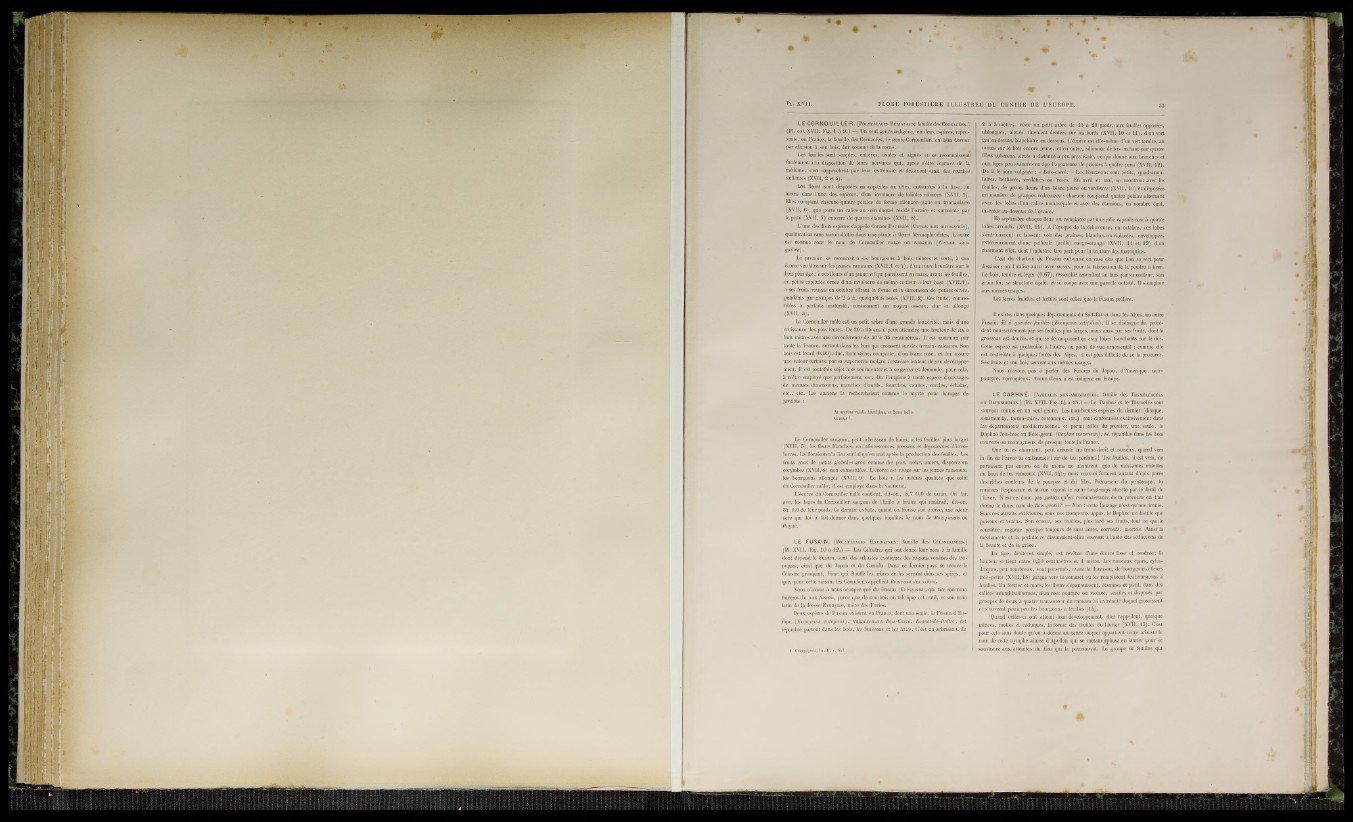
[H; W '
I H i t
LE .CORNO UIL LE R. [Polwétales Pébigynes; famille des Sonruc
(PL col. XVII. Fig..1 à 9.) — Un seul genre indigène, en deux espèces, reprér
sente, en France, la famille des Cornacées, le genre Cornouiller, en latin Comui
par allusion à son bois, dur comme de la corne.
Les feuilles sont simples, entières, ovales et aiguës et se reconnaissent^
facilement h la disposition de leurs nervures qui, après s'étre écartées do la
médiane, s'en rapprochent par leur extrémité et dessinent ainsi des courbes
saillantes (XVII, 2 et 5). •
Les fleurs sont disposées en capitules ou têtes, entourées h la base, au
moins dans l’une des espèces, d’un involucre de folioles colorées (XVII, 1).
Elles comptent chacune quatre pétales de forme allongëe-aigûe ou triangulaire
(XVII, 6), que porte un calice au sein duquel réside l'ovaire et surmonté par
le pistil (XVII, 7) entouré de quatre étamines (XVII, 8).
L’une des deux espèces s'appelle Cornouiller mâle (Cornus mas ou mascula),
qualification sans raison d'être dans une plante à fleurs hermaphrodites. L’ai
est connue sous le nom de Cornouiller rouge ou sanguin (Cornus &
guinea).
Le p r em i e r . a H
3 reconnaît à ses bourgeons h bois minces et verls, à son
ir les jeunes rameaux (XVII,1 et ft), d’un roux brunâtre sur le
3S fleurs d’un jaune vif qui paraissent en mars, avant les feuilles,
écorce verdâtdHH
bois plus âgé; à se
[capitules on
t involucre de même couleur à leur base (XVII,i);
h ses fruits rouges en octobre offrant la forme et la dimension de petites olives,
pendants par groupes de 2 h fi, quelquefois isolés (XVII, 2 ). Ces fruits, comestibles
à parfaite maturité, contiennent un noyau osseux, dur et allongé
n blanc rosé, et lui assure
ie lenteur de son développeur
et demande, pour cela,
(XVII, 3). ' v
Le Cornouiller mâle est un petit arbre d’une grande longévité, mais d’une
croissance des plus lentes. De 20 à 25 ans il peut atteindre une hauteur de six à ~
huit mètres avec une circonférence de 30 h 35 centimètres. U est commun par
toute la France, surtout dans les bois qui croissent sur des terrains calcaires. Son
bois est lourd (0,99), dur, homogène, compacte, d’un
une valeur certaine par sa supériorité malgré l’extrêmi
ment. U est toutefois sujet h se tourmenter ef
h n’être employé que parfaitement sec. On l'emploie h toute espèce d'oi
de menues dimensions, manches d'outils, fourches, cannes, cercles, échalas,
etc., etc. Les anciens le recherchaient comme le myrte pour hampes de
javelots :
Le Cornouiller sanguin, petit arbrisseau de haies, a les feuilles plus larges
(XVII, 5), les fleurs blanches, en inflorescences pressées et dépourvues d’ïnvo-
lucres. La floraison n’a lieu sur lui qu’en mai après la production des feuilles. Les
fruits sont de petits globules gros comme des pois, noirs, amers, disposés en
corymbes (XVII, 8) non comestibles. L'écorce est rouge sur les jeunes rameaux,
les bourgeons allongés (XVII, 9). Le bois a les mêmes qualités que celui-
du Cornouiller mâle; il est employé dans la vannerie.
L’écorce du Cornouiller mâle contient, dit-on, 8,7 0/0 de tanin. On fait
avec les baies du Cornouiller sanguin de l’huile à brûler qui rendrait, dit-on,
3/i 0/0 do leur poids. Ce dernier exhale, quand on froisse son écorce, une odeur
âcre qui lui a fait donner dans quelques localités le nom de Bois punais ou
Puyna.
LE FUSAIN i livre ï .nbs ; famille des Célastbinées.]
(Pl. XVII. Fig 10 ù 12.) — Les Cola très qui ont donné leur nom à la famille
dont dépend le Fusain, sont des arbus es exotiques des régions vois nés des tropiques,
ainsi que du Japon et du Ca ada. Dans ce dernier pays e trouve le
Célastro grimpant, liane qui étouffe les arbres en les serrant dans se spires, et
que, pour celte raison, les Canadiens a| »lient Bourreau des arbres.
Nous n’av ns h nous occuper que lu Fusain (Evonymus), qui t re son nom
français du mot fuseau, parce que de s n bois on fabrique cet outil, et son nom
latin do la déess Evonymc, mère des 1tories.
Deux espèces do Fusain existent en France, dont une seule, le F isain d’Europe
(Evonymt europwus), vulgaire nenl Bois-Carré, Bonnet-de-Prétre, est
répandue parlout dans les bois, les bui sons et les haies. C'est un arbrisseau de
¡ P 3 mètres, voire un petit arbre de 15 à 20 pieds, aux feuilles opposées,
oblopgues, aiguës, finement dentées sur les bords (XVII, 10 et 11), d'un vert
gai en dessus, blanchâtre en dessous. L’écorce est elle-même d'un vert tendre, au
moins sur le- bois encore jeune, et en outre, sillonnée de bas en haut par quatre
filets Subéreux situés à distance à peu près égale, ce qui donne aux branches et
aux tiges peu avancées en âge l'apparence de prismes h quatre pans (XVII, 12).
De lit le nom vulgaire : « Bois-carré. » Les bourgeons sont petits, quadrangu-
laires, herbacés, verdâtres ou rosés. En avril et mai, se montrent avec les
feuilles, de petites fleurs d’un, blanc jaune ou verdâtres (XVII, 10) et disposées
en manière do grappes redressées : chacune comprend quatre pétales alternant
avec les lobes d'un calice monosépalc et avec des étamines, en nombre égal,
insérées au-dessous de l’ovaire.
En septembre chaque fleur est remplacée par une jolie capsule rose à quatre
lobes arrondis (XVII, 11). A l'époque de la déhiscence, en octobre, ces lobes
s’entr'ouvrenl et laissent voir des graines, blanches ou violacées, enveloppées
extérieurement d'une pellicule (ariUe) rouge-orangé (XVII, 11 et 12) d’un
charmant effet, dont l'industrie lire parti pour la teinture des maroquins.
C’est du charbon du Fusain carbonisé en vase clos que l’on se sert pour
dessiner; on l’utilise aussi avec succès pour la fabrication de la poudre h tirer.
Le bois, tendre et léger (0,67), ressemble cependant au buis par sa couleur, son
grain lin, sa structure égale, et se coupe avec une pareille netteté. Il s'emploie
aux mêmes usages.
Les terres fraîches et fertiles sont celles que le Fusain préfère.
Il existe, dans quelques départements du Sud-Est et dans les Alpes, un autre
Fusain, dit à grandes feuilles (Evonymus satifolius). Il se distingue du précédent
non-seulement par ses feuilles plus larges, mais aussi par scs fruits, dont la
grosseur est double, et qui se décomposent eh cinq lobes tranchants sur le dos.
Cette espèce est préférable à l'autre, au point de vue ornemental : comme elle
est restreinte à quelques forêls des Alpes, il est plus difficile de se la procurer. ■
Ses fruits et son bois servent aux mêmes usages.
Nous n’avons pas h parler des Fusains du Japon, d’Amérique, noir-
pourpre, verruqueux. Aucun d’eux n’est indigène en France.
LE DAPHNÉ- [Apétales non-ambntaçées; famille des Tuyuéléacées
ou DaphnoIdées.] (Pl. XVII. Fig. 1A à 18.) — Le Daphné et le Thymélée sont
souvent réunis en un seul genre. Les nombreuses espèces du dernier (diolque,
sanamunda, tarton-raire, cotonneux, etc.) sont cantonnées exclusivement dans
les départements méditerranéens; et parmi celles du premier, une seule, le
Daphné Joli-bois ou Bois-gentil (Daphné mezereum), est répandue dans les bois
couverts ou montagneux de presque toute la France.
Que tu es charmant, petit arbuste au tronc droit et rame'ux, quand vers
la 6n de l'hiver tu embaumes l’air de tes parfums ! Tes feuilles, il est vrai, ne
paraissent pas encore ou du moins ne montrent que de naissantes rosettes
au bout de tes rameaux (XVII, l/t) ; mais ceux-ci forment autant d’épis parés
des riches couleurs de la pourpre et du lilas. Précurseur du printemps, tu
ranimes l’espérance et ta vue réjouit le coeur longtemps attristé par le deuil do
l’hiver. N’est-ce donc pas justice qu’en reconnaissance de ta précocité on t’ait
donné le doux nom de Bois-gentil? — Non : cette louange n’est qu’une ironie.
Sous ces attraits extérieurs, sous ces trompeurs appas, le Daphné ne distille que
poisons et venins. Son écorce, ses feuilles, plus tard ses fruits, tout ce qui le
constitue, regorge presque toujours de sucs âcres, corrosifs, mortels. Ainsi la
méchanceté et la perfidie se dissimulent-elles souvent % l’aide des séductions de
la beauté et de la grâce.
La tige, droite et simple, est revêtue d'une écorce lisse et cendrée; la
hauteur se tient entre 0,50 centimètres et 1 mètre. Les rameaux épars, cylindriques,
peu nombreux, sont parsemés, avant la floraison, de bourgeons à fleurs
très-petils (XVII, 18) jusque vers le sommet où les remplacent des bourgeons à
feuilles. En février et mars, les fleurs s’épanouissent, étamines et pistil, dans des
calices infundibuliformes, d’un rose pourpre ou violacé, sessiles et disposés par
groupes de deux h quatre tout autour du rameau à l’extrémité duquel grossissent
et s'ouvrent peu h peu les bourgeons à feuilles (l/t)- .
Quand celles-ci ont atteint leur développement, elles rappellent, quoique
minces, molles et caduques, la forme des feuilles du laurier (XVII, 15). C'est
pour cela sans doute qu’on a donné au genre auquel appartient notre arbuste le
nom de cette nymphe aimée d'Apollon qui se métamorphosa en laurier pour se
soustraire aux atteintes du dieu qui la poursuivait. Le groupe de feuilles qui
1 !