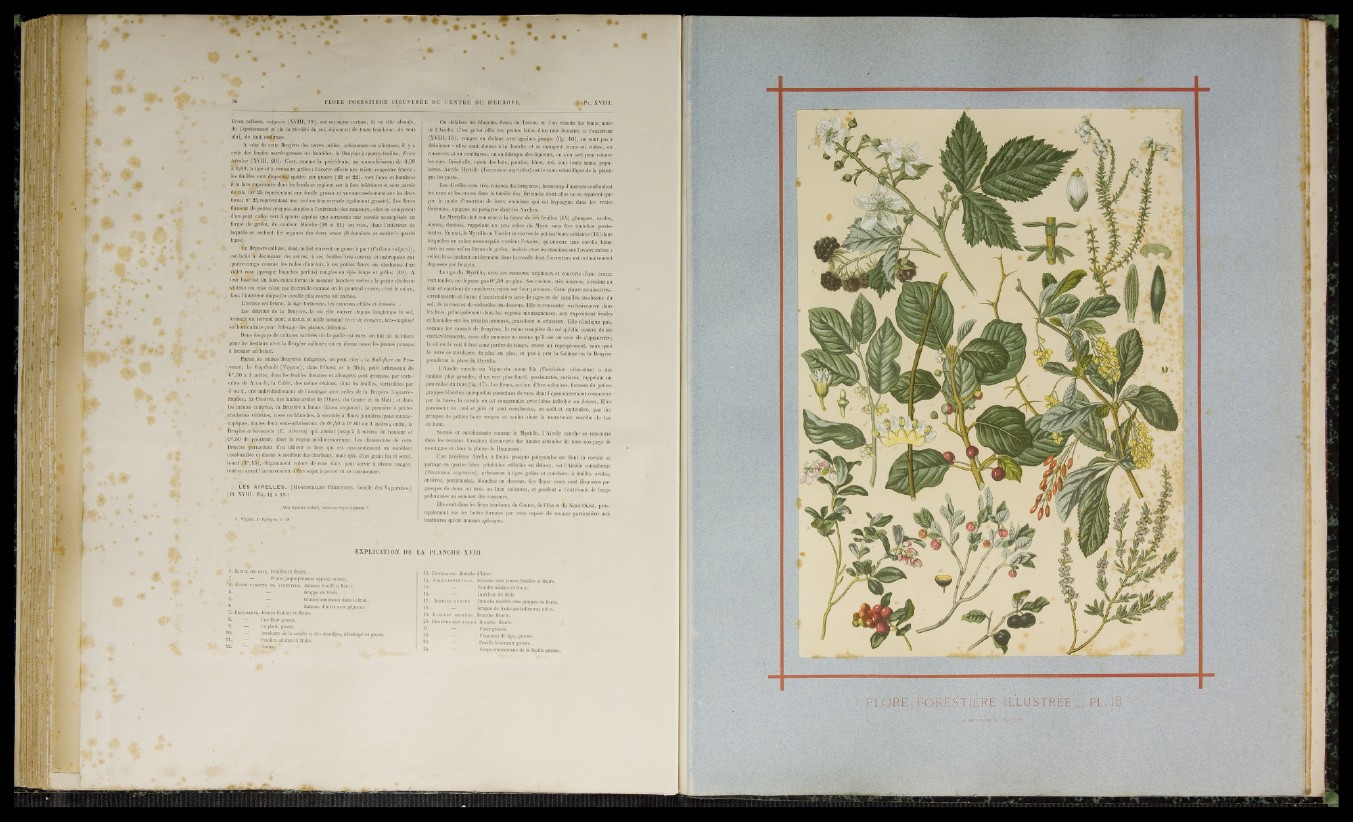
■ > * -
# » < # *
* * .,
I1 Hw re .
F# #
III
i t
if
B n p i fH i §6 . * j j , & ♦ \ 1 Æ -* ? X#
* * * * * *
m * * - # • *
f * 4
EmÉ #
• m
FLORE FORESTIÈRE ILLUSTRÉE DU CENTRE DE »EUROPE.
Erica calluna, vulgaris (XVIII, 19), est un signe certain, Ih où elle abonde,
de l'épuisement e t de la stérilité du sol, dépourvu de toute fraîcheur, de tout
-abri, do tout ombrage.
A côté de cclto Bruyère des terres arides, schisteuses ou siliceuses, il y a
• celle des laudes marécageuses ou humides, la Bruyère à quatre-feuilles, Erica
Mraliiv (XVIII, 20). C’est, comme la précédente, un sous-abrïsseau de 0,20
ù*0,60, à tige et ù rameaux grêles : l'ccorce affecte une teinte rougeâtre foncée ;
les feuilles sont,disposées quatre par quatre (20 cl 22), vert foncé et bombées
ù- la face supérieure dont les bords se replient sur la face inférieure et sont garnis
deicils (n*23 représentant une feuille grossie et vue successivement sur les deux
faces; n* 24 représentant une section transversale également grossie). Les fleurs
forment de petites grappes simples ù l'extrémité des rameaux; elles se composent
d’un petit calice vert à quatre sépales que surmonte une corolle monopétale en
forme de grelot, de couleur blanche (20 et 2 1) ou rose, dans l'intérieur do
laquelle se cachent les organes des deux sexes (8 étamines et ovaire ù quatre
loges).
# a Brpyère callune, dont on fait souvent un genre h part (Calluna vulgaris) ,
est facile ^ distinguer des autres, h ses feuilles ‘très-courtes et imbriquées sur
quatre rangs comme les tuiles d’un toit, à ses petites fleurs en clochettes d’un
violet rosé (quoique blanches parfois) rangées en épis longs et grêles (19). A
leur base est un faux calice formé do menues bractées vertes ; la petite clochette
yioletlc ou rose n'est pas la corolle comme on le pourrait croire, c'est le calice,
. dans l'intérieur duquel la corolle plus courte est cachée.
L'écorce est brune, la lige tortueuse, les rameaux eflilés et dressés.
Les détritus de la Bruyère, là où elle couvre depuis longtemps le sol,
formen t un terreau noir, siliceux et acide nommé terre de bruyère, très-employé
en'hdrticulture pour l’élevage des plantes délicates.
Dans les pays de cultures sarclées où la paille est rare, on fait de la litière
pour les bestiaux avec la Bruyère callune; on en donne aussi les jeunes pousses
à brouter an bétail.
Parmi les autres Bruyères indigènes, on peut citer : la Mulliflore en Provence;
la Vagabonde ( Vagans) , dans l’Ouest et lé Midi, petit arbrisseau de
0“,50 à i mètre, dont les feuilles linéaires et allongées sont groupées par verti-
cilles de 4 ou 5 ; la Ciliée, des même régions, dont les feuilles, verticillées par
3 ou 4 , ont individuellement de l’analogie avec celles de la Bruyère à quatre-
feuilles; la Cendrée, des landes arides de l’Ouest, du Centre et du Midi ; et dans
les mêmes contées, la Bruyère à balais (Erica scoparia), la première à petites
clochettes violettes, roses ou blanches, la seconde à fleurs jaunâtres quasi microscopiques,
toutes deux sous-arbrisseaux do 0*,40 à 0“,60 ou 1 mètre ; enGn, la
Bruyère arborescente (E. Arborea) qui atteint jusqu’à 4 mètres de hauteur et
. 0";50 de ^pourtour, dans la région méditerranéenne. Les dimensions de cette
Bruyère permettent d’en utiliser le bois qui est non-seulement un excellent
combustible et donne le meilleur des charbons, mais qui, d’un grain lin et serré
lourd ;(a/*, 15), élégamment coloré de rose clair, peut servir à divers usages,
tout en ayant l’inconvénient d'Ilre sujet à gercer et se tourmenter.
> LES AIR EL L ES . [Moxopétal
(Pl. XVIII. Fig. 14 à 18.)
PéaiGYNES ; famille des Vaççisées.]
On délaisse les blanches fleurs du Troène'et l’on récolte les fruits noirs
de l'Airelle. C’est qu’en effet ces petites baies d’un noir bleuâtre à l’extérieur
(XVIII, 15), rouges en dedans avec ¡gi'.aihes jaunes (Gg. 16), ne sont pas à
dédaigner : elles sont douces à la bouche et se mangent crues ou cuites, en
conserves et en conGturcs ; on en fabrique des liqueurs, on s’en sert pour colorer
les vins. Brimbellc, raisin des bois, pouriot, bluct, tels sont leurs noms populaires.
Airelle Myrtille (Foccimum myrtillus) est le nom scientiflque de la plante
qui les porte.
Les Airelles sont très-voisines des bruyères ; beaucoup d’auteurs confondent
les unes et les autres dans la famille des Éricinées dont elles ne se séparent que
par le mode d’insertion de leurs étamines qui est hypogyne dans les vraies
Éricinées, épigyne ou périgyne dans les Airelles.
Le Myrtylle doit son nom à la forme de ses feuilles (14) glauques, ovales,
aiguës, dentées, rappelant un peu celles du Myrte sans être toutefois persistantes.
En mai, le Myrtille ou Vacciet se couvre do petites fleurs solitaires (14) dans
lesquelles un calice monosépale contient l’ovaire, qu’entoure une corolle blanc
rosé ou rose vif en forme de grelot, insérée avec les étamines sur l’ovaire même :
celles-là se cachent entièrement dans la corolle dont l’ouverture est ordinairement
dépassée par le style.
La tige du Myrtille, avec ses rameaux anguleux et couverts d’une écorce
vert tendre, ne dépasse pàsû-,50 au plus. Ses racines, très-longues, s’étalent au
loin et émettent de nombreux rejets sur leur parcours. Cette plante est ainsi très-
envahissante et forme d’inextricables lacis de liges et de ramilles au-dessus du
sol, de racines et de radicelles au-dessous. Elle se rencontre exclusivement dans
les bois, principalement dans les régions montagneuses, aux expositions froides
et humides sur les terrains arénacés, graveleux et schisteux. Elle n’indique pas,
comme les massifs de bruyères, la ruine complète du sol qu’elle couvre de ses
enchevêtrements, mais elle annonce au moins qu’il est on voie de s’appauvrir ;
là où on la voit il faut sans perdre de temps, aviser au repeuplement, sans quoi
la terre se stérilisera do plus en plus, et peu à peu la Callune ou la Bruyère
prendront la place du Myrtille.
L’Airelle canche ou Vigne du mont Ida (Vaccinium vilts-idoea) a des
feuilles plus grandes, d’un vert plus foncé, persistantes, coriaces, rappelant un
peu celles du buis (Gg. 17). Les Qeurs, au lieu d’être solitaires, forment de petites
grappes blanches quelquefois panachées de rose, dont l’épanouissement commence
par la base; la corolle en est campanulée avec lobés infléchis en dehors. Elles
paraissent en mai et juin et sont remplacées, en août et septembre, par des
groupes de petites baies rouges et acides dont la maturation marche de bas
en haut.
Sociale et envahissante comme le Myrtille, l’Airelle canche se rencontre
dans les terrains forestiers découverts des hautes altitudes de tous nos pays de
montagne et dans la plaine de Haguenau.
Une troisième Airelle, à fleurs presque polypétales ou dont la corolle se
partage en quatre lobes pétaloïdes réfléchis en dehors, est l’Airelle canneberge
(Vaccinium omjcoccos), arbrisseau à tiges grêles et couchées, à fouilles ovales,
entières, persistantes, blanches en dessous. Ses fleurs roses sont disposées par
groupes de deux ou trois ou bien solitaires, et pendent à l’extrémité de longs
pédoncules au sommet des rameaux.
Elle croit dans les lieux tourbeux du Centre, de l’Est et du Nord-Ouest, principalement
sur les bulles formées par cette espèce de mousse particulière aux
tourbières qu’on nomme sphaigne.
EXPLICATION DE LA PLANCHE XVIII
a Baie. Feuilles et fleurs.
Fruits (improprement appelés mûre
ibette ou ViHETTiEn. Rameau feuillé et 11
— Grappe de fruits.
10; — Involucre de la corolle et des étamines, développé et grossi.
11- — Feuilles adultes et fruits.
17. Aibe
18.
10. Cali
Feuilles adultes et fruits.
Intérieur du fruit.
Branche feuillée avec grappes do fleurs.
Grappe de fruits partiellement mûrs.
. Branche fleurie,
ts. Branche fleurie.
Fleur grossie.
Feuille fortement grossie.
FLORE FORESTIÈRE ILLUSTRÉE _ PL 18
« 1ROTHbCHIU)..EDITEUR ’