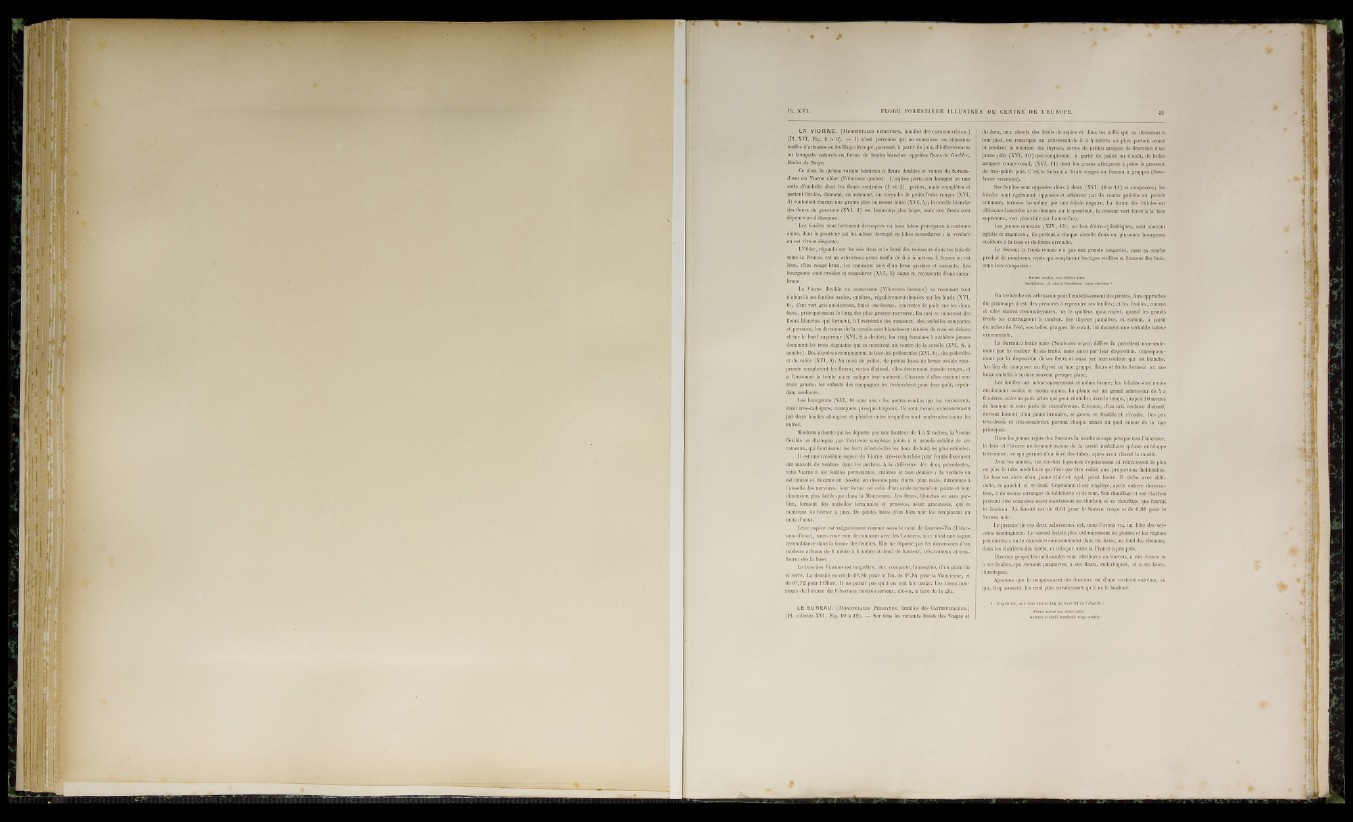
LA VIORNE. [MoNOPéTALBS pbbigyxes, familles descaprifolia£ées.J
(Pl. XVI. Fig. 1 à 9 ) .— Il n'est personne qui ne connaisse ces élégantes
touffes d'arbustes au feuillage découpé, parsemé, à partir de juin, d'infloresèencés
ou bouquets naturels en forme de boules blanches appelées Roses de Gueldre,
Boules de Neige.
Ce n'est là qu’une variété horticole à fleurs doubles et vaines du Sureau-
d’eau ou Viorne obier (Vibumum opulus). L'espèce porte son bouquet en une
sorte d’ombelle dont les fleurs centrales (1 et 2 ), petites, mais complètes et
partant fertiles, donnent, en automne, un corymbo de petits fruits rouges (XVI,
3) contenant chacun une graine plus ou moins lobée (XVI, A); la corolle blanche
des fleurs du pourtour (XVI, 1) est beaucoup plus large, mais ces fleurs sont
dépourvues d’étamines.
Les reuilles sont fortement découpées en trois lobes principaux à contours
aigus, dont le pourtour est lui-m£me découpé en lobes secondaires : la verdure
en est vive et élégante. -
L'Obier, répandu sur les sols frais et le bord des ruisseaux dans les bois de
toute la France, est un arbrisseau assez touffu de 3 à 5 mètres. L’écorce en
lisse, d’un rouge brun, les rameaux unis d'un brun grisâtre et cassants. Les
bourgeons sont ovoïdes et rougeâtres (XVI, 5) aigus et recouverts d'une mem-
La Viorne flexible ou mancienne ( Vibumum lantdna) se reconnaît tout
d’abord à ses feuilles ovales, entières, régulièrement dentées sur les bords (XVI,
6), d’un vert gris au-dessous, foncé au-dessus, couvertes de poils sur les deux
faces, principalement le long des plus grosses nervures. En mai se montrent des
fleurs blanches qui forment, à l’extrémité des rameaux, des ombelles compactes
et pressées; les divisions de la corolle sont blanches et teintées de rose en dehors
et sur le bord supérieur (XVI, 8 à droite) ; les cinq étamines à anthères jaunes
dominent les trois stigmates qui se montrent au centre de la corolle (XVI, 8, à
gauche). Des stipules accompagnent labasedes pédoncules (XVI, 6), des pédicclles
et du calice (XVI, 8). Au mois de juillet, de petites baies de forme ovoïde co
primée remplacent les fleurs ; vertes d'abord, elles deviennent ensuite rouges, et
à l'automne la teinte noire indique leur maturité. Chacune d’elles contient ui
seule graine ; les enfants des campagnes les recherchent pour leur goût, cependant
médiocre.
Les bourgeons (XVI, 9) sont nus : les petites écailles qui les recouvren
étant très-caduques, manquent presque toujours. Ils sont formés extérieurement
par deux feuilles allongées et plissées entre lesquelles sont renfermées toutes les
autres.
Modeste arbuste qui ne dépasse pas une hauteur de 1 à 2 mètres, la Viorne
flexible se distingue par l'extrême souplesse jointe à la grande solidité de ses
rameaux, qui fournissent les Aorte (c'est-à-dire les liens de bois) les plus estimées.
Il est une troisième espèce de Viorne, très-recherchée pour l’embellissement
des massifs de verdure dans les jardins. A la différence des deux précédentes,
celte Viorne a les feuilles persistantes, entières et non dentées ; la verdure en
est foncée et luisante en dessus, en dessous plus claire, plus mate, duveteuse à
l’aisselle des nervures; leur forme est celle d’un ovale terminé en pointe et I
dimension plus faible que dans la Mancienne. Les fleurs, blanches et sans parfum,
forment des ombelles terminales et pressées, assez gracieuses, qui s
montrent de février à juin. De petites baies d'un bleu noir les remplacent ai
Cette espèce est vulgairement connue sous le nom de Laurier-Tin (Vibur-
mtm-Tinus), sans avoir rien de commun avec les Lauriers, si ce n'est une vague
ressemblance dans la forme des reuilles. Elle ne dépasse pas les dimensions d'un
modeste arbuste de 1 mètre à 1 mètre et demi de hauteur, très-rameux et très-
fourni dès la base.
le bois des Viormes est rougeâtre, dur, compacte, homogène, d'un grain fin
et serré. La densité en est de 0”,SG pour le Tin, de 0*,8A pour la Mancienne, et
de 0”,72 pour l'Obier. 11 ne parait pas qu'il en soit fait usage. Les tissus intérieurs
de l’écorce du Vibumum lantana servent, dit-on, à faire de la glu.
LE SUREAU. [MoNOréTALBS PSrigynbs, familles des CAPniFOLtAcéBs.]
(Pl. coloriée XVI. Fig. 10 à 12). — Sur tous les versants boisés des Vosges et
du Jura, aux abords des forêts de sapins et dans les taillis qui se déroulent à
leur pied, on remarque un arbrisseau de 3 à A mètres au plus, portant avant
et pendant (a foliation des thyrses, sortes de petites grappes de fleurettes d'un
jaune pâle (XVI, 10) que remplacent, à partir de juillet ou d’aoflt, de belles
grappes rouge-corail, (XVI, .11) dont les grains atteignent à peine la grosseur
de très-petits pois. C’est le Sureau à fruits rouges ou Sureau à grappes (Sam-
bucus raeemosa).
Ses feuilles sont opposées deux à deux (XVI, 10 et 11) et composées; les
folioles sont également opposées et adhèrent par de courts pétioles au pétiole
commun, terminé lui-même par une foliole impaire. La forme des folioles est
oblongue-lancéolée avec denture sur le pourtour, la couleur vert foncé à la face
supérieure, vert plus clair sur l’autre face.
Les jeunes rameaux (XIV, 12 ), au lieu d'être cylindriques, sont souvent
aplatis et anguleux ; ils portent à chaque aisselle deux ou plusieurs bourgeons
écailleux à la base et de forme arrondie.
Le Sureau à fruits rouges n'a pas une grande longévité, mais sa souche
produit de nombreux rejets qui remplacent les tiges vieillies et forment des buissons
très-compactes :
...Primo av.ulso, non déficit altor
On recherche cet arbrisseau pour l'embellissement des jardins. Aux approches
du printemps il est des premiers à reprendre ses feuilles; cl les feuilles, comme
si elles étaient reconnaissantes, ne le quittent qu’à regret, quand les grands
froids les contraignent à tomber. Ses thyrses jaunâtres, et surtout, à partir
du milieu de l'été, ses belles grappes de corail, lui donnent une véritable valeur
ornementale.
Le Sureau à fruits noirs (Sambucus nigra) diffère du précédent non-seulement
par la couleur de ses fruits, mais aussi par leur disposition, conséqucm-
menl par la disposition de ses fleurs et aussi par leur couleur qui est blanche.
Au lieu de composer un tbyrse ou Une grappe, fleurs et fruits forment ici une
large ombelle à surface souvent presque plane.
Les feuilles ont même agencement et même forme ; les folioles sont moins
étroitement ovales et moins aiguës. La plante est un grand arbrisseau de A à
6 mètres, voire un petit arbre qui peut atteindre, avec le temps, jusqu'à 10 mètres
de hauteur et trois pieds de circonférence. L'écorce, d'un gris verdâtre d’abord,
devient bientôt d’un jaune brunâtre, se gerce, se fendille et s'écaille. Des jets
très-droits et très-nombreux partent chaque année du pied autour de la tige
principale.
Dans les jeunes rejets des Sureaux la moelle occupe presque tout l'intérieur,
le bois et l’écorce ne formant autour de la cavité médullaire qu'une enveloppe
très-mince, ce qui permet d’en faire des tubes, après avoir chassé la moelle.
Avec les années, les couches ligneuses s’épaississent et rétrécissent de plus
en plus le tube médullaire qui finit par être réduit aux proportions habituelles.
Le bois est alors d’un jaune clair et égal, point lustré. Il sèche avec difficulté,
se gauchit et se fend. Cependant il est employé, après entière dessiccation,
à de menus ouvrages de tabletterie et de tour. Son chauffage et son charbon
peuvent être comparés assez exactement au charbon et au chauffage que fournil
le bouleau. La densité est de 0,61 pour le Sureau rouge et de 0,68 pour le
Le premier de ces deux arbrisseaux est, nous l’avons vu, un hôte des versants
montagneux. Le second habite plus ordinairement les plaines et les régions
peu élevées ; on le rencontre communément dans les haies, au fond des chemins,
dans les clairières des forêts, et cela par toute la France à peu près.
Diverses propriétés médicinales sont attribuées au Sureau, à son écorce et
à ses feuilles, qui seraient purgatives, à ses fleurs, sudorifiques, et à scs baies,
diurétiques.
Ajoutons que le tempérament des Sureaux est d’une rusticité extrême, ce
qui, trop souvent, les rend plus envahissants qu'il ne le faudrait.
1f§ |
i l
II