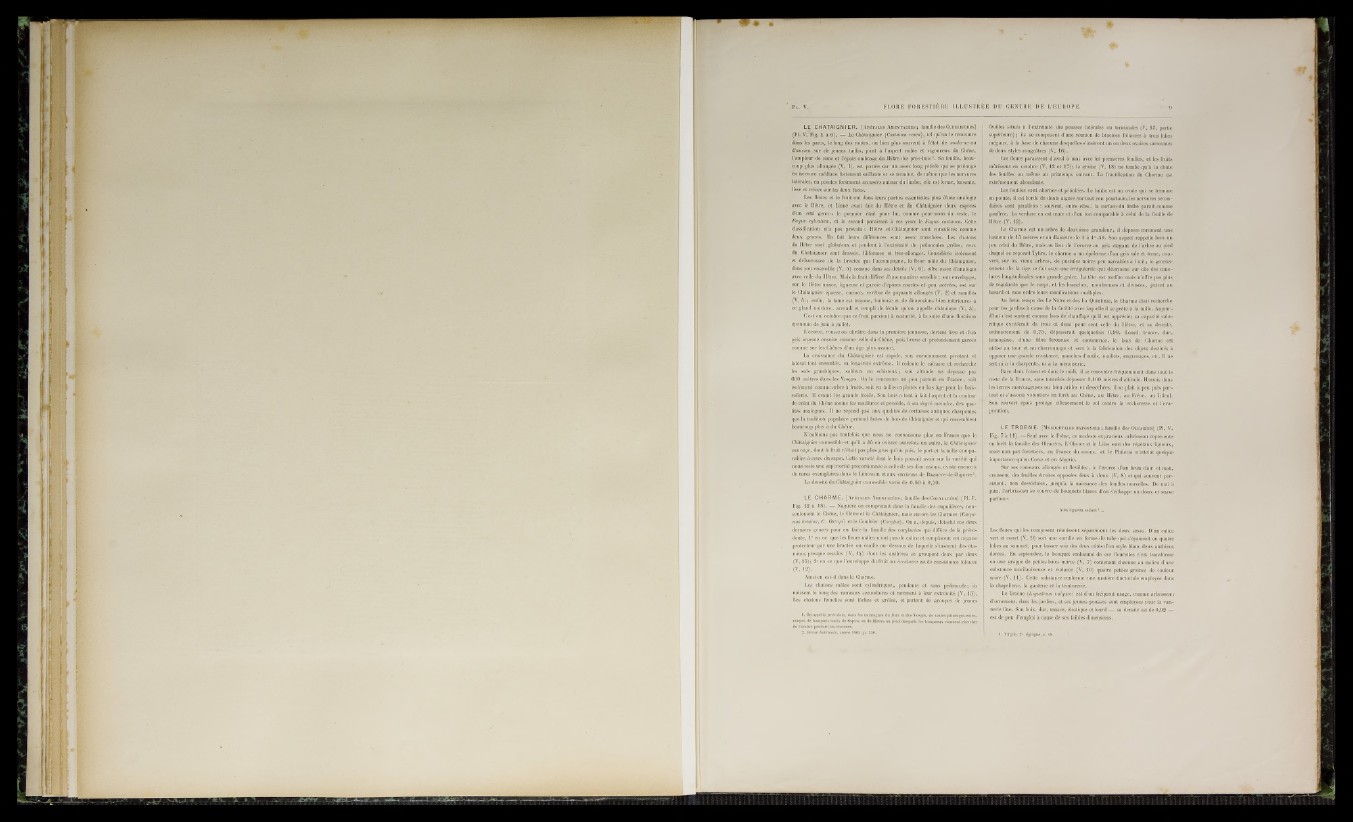
■ i
i Ii
I I
LE CHATAIGNIER. [Abétales Ambntacées; famille des CuruLiFÈnss]
(PL V. Fig. 1 h 6 ). — Le Châtaignier (Caslanea vesca), tel qu'on le rencontre
dans les parcs, le long des routes, ou bien plus souvent h l’état de moderne ou
d’ancien sur de jeunes taillis, joint h l’aspect noble et vigoureux du Chêne,
l’ampleur de cime et l’épais ombrage du Hêtre des prés-bois '. Sa feuille, beaucoup
plus allongée (V, I ), est portée sur un assez long pétiole qui se prolonge
en nervure médiane fortement saillante et se termine, de même que les nervures
latérales, en pointes fortement accusées autour du limbe; elle est ferme, luisante,
lisse et veinée sur les deux faces.
Les fleurs et le fruit pnt dans leurs parties essentielles plus d’une analogie
avec le Hêtre, et Linné avait fait du Hêtre et du Châtaignier deux espèces
d'un'seul genre: le premier était pour lui, comme pour nous du reste, le
Fagus sylvatica, et le second • paraissait à ses yeux le Fagus caslanea. Celte
classification n’a pas prévalu : Hêtre et Châtaignier sont considérés comme
deux genres. En fait leurs différences sont assez tranchées. Les chatons
du Hêtre sont globuleux et pendent h l’extrémité de pédoncules grêles ; ceux
du Châtaignier sont dressés, filiformes et très-allongés. Considérée isolément
et débarrassée de la bractée qui l’accompagne, la fleur mâle du Châtaignier,
dans son ensemble (Y, 5) comme dans ses détails (V, 6), offre assez d’analogie
avec celle du Hêtre. Mais le fruit diffère d'une manière sensible : son enveloppe,
sur le Hêtre mince, ligneuse et 'garnie d’épines courtes et peu acérées, est sur
le Châtaignier épaisse, coriace, revêtue de piquants allongés (V, 2) et ramifiés
(V, A); enfin, la faine est trigone, huileuse et de dimensions bien inférieures à
ce gland noirâtre, arrondi et rempli de fécule qu’on appelle châtaigne (V, 3),
C’est en octobre que ce fruit parvient h maturité, à la suite d’une floraison
épanouie de juin h juillet.
L’écorce, rousse ou olivâtre dans la première jeunesse, devient lisse et d’un
gris argenté ensuite comme celle du Chêne, puis brune et profondément gercée
comme sur les Chênes d’un âge plus avancé.
La croissance du Châtaignier est rapide, son enracinement pivotant et
latéral tout ensemble, sa longévité extrême. 11 redoute le calcaire et recherche
les sols granitiques, sableux ou schisteux ; son altitude ne dépasse pas
600 mètres dans les Vosges. On le rencontre un peu partout en France, soit
isolément comme arbre h fruits, soit en taillis exploités en bas âge pour la bois-
scllerie. Il craint les grands froids. Son bois a tout à fait l’aspect et la couleur
de celui du Chêne moins les maillures et possède, à un degré moindre, des qualités
analogues. II ne répond pas aux qualités de certaines antiques charpentes
que la tradition populaire prétend faites de bois de Châtaignier et qui ressemblent
beaucoup plus h du Chêne.
N’oublions pas toutefois que nous ne connaissons plus eD France que le
Châtaignier comestible et qu’il a dû en exister autrefois un autre, le Châtaignier
saurage, dont le fruit n’était pas plus gros qu’un pois, le port et la taille comparables
à ceux du sapin. Cette variété dont le bois pouvait avoir sur la variété qui
nous reste une supériorité proportionnée à celle de ses dimensions, existe encore à
de rares exemplaires dans le Limousin et aux environs de Bagnère-de-Bigorre1.
La densité du Châtaignier comestible varie de 0,60 h 0,70.
LE C HAR NI E. [Apétales Aiibntacébs; famille des’ConvLACÉBs] (PI. V.
Fig. 12 h 18). — Naguère on comprenait dans la famille des cupulifères; non-
seulement le Chêne, le Hêtre et le Châtaignier, mais encore les Charmes (Carpi-
nus belulus, C. Ostrya) et le Coudrier (Corylus). On a. depuis, détaché ces deux
derniers genres pour en faire la famille des corylacées qui diffère de la précédente,
1" en ce que les fleurs mâles n’ont pas de calice cl remplacent cet organe
protecteur par une bractée ou écaille au-dessous de laquelle s’insèrent des étamines
presque sessiles (Y, 1A) dont les anthères se groupent deux par deux
(Y, 15); 2» en ce que l’enveloppe du fruit ou involucre est de consistance foliacée
(V, 12).
Ainsi en est-il dans le Charme.
Les chatons mâles sont cylindriques, pendants et sans pédoncule; ils
naissent le long des rameuux secondaires cl rarement h leur extrémité (V, 13).
Les chatons femelles sont lâches et grêles, et partent do groupes de jeunes
coupés do bouquols isolés do Sapins ou do lléiros au piod desquels 1rs troupeaux vionnonl chercher
do l’ombro pondant les chaleurs.
feuilles situés h l’extrémité des pousses latérales ou terminales (V, 13, partie
supérieure) ; ils se composent d’une réunion de bractées foliacées h trois lobes
inégaux, h la base de chacune desquelles s'insèrent un ou deux ovaires surmontés
de deux styles rougeâtres (V, 16).
Ces fleurs paraissent d'avril à mai avec les premières feuilles, et les fruits
mûrissent en octobre (V, 12 et 17) ; la graine (V, 18) ne tombe qu'à la chute
des feuilles ou même au printemps suivant. La fructification du Charme est
extrêmement abondante.
Les feuilles sont alternes cl péliolées. Le limbe est un ovale qui se termine
en pointe; il est bordé de dents aiguës sur tout son pourtour; les nervures secondaires
sont parallèles : souvent, entre elles, la surface du limbe parait comme
'gaufirée. La verdure en est mate et d’tm ton comparable h celui de la feuille de
Hêtre (V, 12).
Le Charme est un arbre de deuxième grandeur; il dépasse rarement une
hauteur de 15 mètres et un diamètre de 1 h 1",30. Son aspect rappelle.bien un
' peu celui du Hêtre, mais au lieu de l’écorce au gris élégant de l'arbre au pied
duquel se reposait Tylire, le charme a un épidémie d'un gris sale et terne, couvert,
sur les vieux arbres, de pustules noires peu agréables h l’oeil; le grossissement
de la tige se fait avec une irrégularité qui détermine sur elle des canelares
longitudinales sans grande grâce. La tête est touffue mais n’offre pas plus
de régularité que le corps, et les branches, nombreuses et divisées, jettent au
hasard et sans ordre leurs ramifications multiples.
Au beau temps des Le Nôtre et des La Quinlinie, le Charme était recherché
pour les jardins à cause de la facilité avec laquelle il se prête à la taille. Aujourd’hui
c'est surtout comme bois de chauffage qu'il est apprécié; sa capacité calorifique
excéderait de trois et' demi pour cent celle du Hêtre, et sa densité,
ordinairement de 0,75, dépasserait quelquefois 0,90. Lourd, tenace, dur,
homogène, d'une fibre flexueuse et contournée, le bois de Charme .est
utilisé au tour et au charronnage et sert h la fabrication des-objets destinés à
opposer une grande résistance, manches d'outils,, maillets, engrenages, etc. II ne
sert ni h la charpente, ni à la menuiserie.
Rare dans l’ouest et dans le midi, il se rencontre fréquemment dans tout le
reste de la France, sans toutefois dépasser 1,100 mètres d'altitude. Hormis daos
les terres marécageuses ou bien arides et desséchées, il se plaît à peu près partout
et s’associe volontiers en forêt au Chêne, au Hêtre, au Frêne, au Tilleul.
Son couvert épais protège efficacement le soi contre la sécheresse et l'évaporation.
LE TROENE. [Monopétalbs iiypogynes; famille des Oléacébs] (Pl. V.
Fig. 7 à i l ) . — Seul avec le Frêne, ce modeste et gracieux arbrisseau représente
en forêt la famille des Oléacées. L'Olivier et le Lilas sont des végétaux ligneux,
mais non pas forestiers, en France du moins, et le Philaria n'atteint quelque
importance qu'en Corse et en Algérie.
Sur ses rameaux allongés et flexibles, à l’écorce d’un brun clair et mal,
croissent des feuilles étroites opposées deux à deux (V, 8) et qui souvent persistent,
non desséchées, jusqu’à la naissance des feuilles nouvelles. De mai à
juin, l'arbrisseau se couvre de bouquets blancs d'où s'échappe un doux et suave
parfum :
Alba ligustra cadunt '...
Les fleurs qui les composent réunissent séparément les deux sexes. D'un calice
vert et court (V, 9) sort une corolle en forme de tube qui s'épanouit en quatre
lobes au sommet, pour laisser voir des deux côtés d'un style blanc deux anthères
dorées. En septembre, le bouquet embaumé de ces fleurettes s'est transformé
en une grappe de petites baies noires (V, 7) contenant chacune au milieu d'une
substance mucilagineuse et violacée (Y, 10) quatre petites graines de couleur
noire (V, 1 1 ). Cette substance renferme une matière tinctoriale employée dans
la chapellerie, la ganterie et la teinturerie.
Le Troène (Liguslrum vulgare) est d’un fréquent usage, comme arbrisseau
d'ornement, dans les jardins, et ses jeunes pousses sont employées pour la vannerie
fine. Son bois, dur, tenace, élastique et lourd — sa densité est de 0,92 —
est de peu d’emploi à cause de ses faibles dimensions.
4. Virgile, S* églogue, v. 48, '