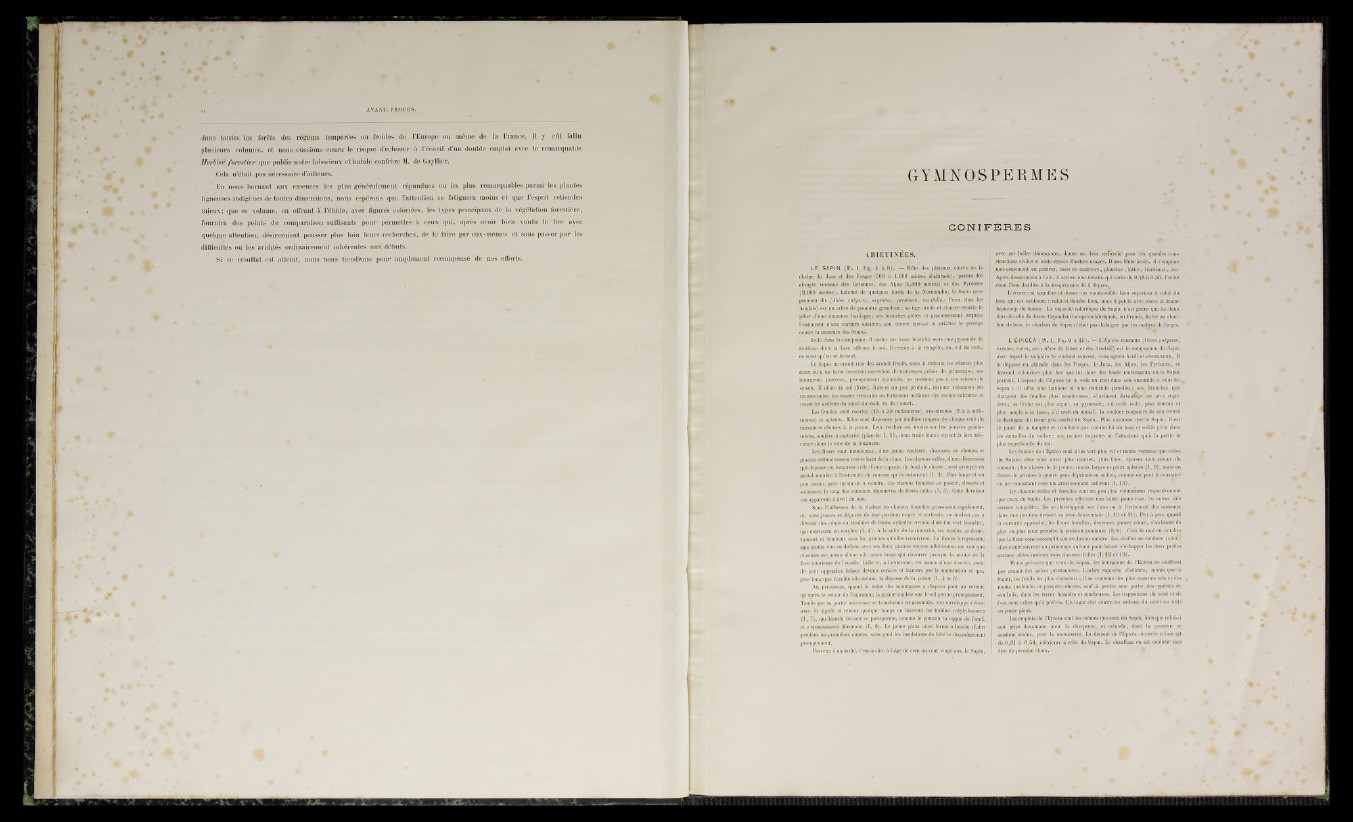
AVANT-PROPOS.
ns toutes les forêts des régions tempérées ou froides de l’Europe ou même de la France. Il y eût fallu
lusieurs volumes, et nous eussions couru le risque d’échouer à l’écueil d’un double emploi avec le remarquable
Ilerbief forestier que publie notre laborieux et habile confrère M. de Gayffier.
Cela n’était pas nécessaire d’ailleurs.
En nous bornant aux essences les plus généralement répandues ou les plus remarquables parmi les plantes
ligneuses indigènes de toutes dimensions, nous espérons que l’attention se fatiguera moins et que l’esprit retiendra
mieux; que ce volume, en offrant a l’étilde, aveè figuréà coloriées, lés types1 principaux de la végétation forestière,
fournira des points de comparaison suffisants pour permettre à ceux qui, après avoir bien voulu le lire avec
quelque attention, désireraient pousser plus loin leurs recherches, de le faire par eux-mêmes et sans passer par les
difficultés ou les aridités ordinairement inhérentes aux débuts.
Si ce résultat est atteint, nous nous tiendrons pour amplement recompensé de nos efforts.
GYMNOSPERMES
GONI
ABIÉIINÉESf
LE SAPIN (.?!•,.i , Fig. 1 à 8). — Hôte des plateaux élevés de la
chaîne du Jura et des Vosges .(500 h 1,000 mètres d’altitude), parure des
abrupts versants des Cévennes, des Alpes (1,500 mitres) et des Pyrénées
(2,Q0O mètres), habitué de quelques forêts de la Normandie, le Sapin proprement
dit (Aiies vulgaris, argenlea, pecliiiata, taxi folia; Picea chez les
Anglais) est un arbre de première grandeur ; sa tige droite et élancée semble le
pilier d’une immense basilique; ses branches grêles et gracieusement, arquées
l’entourent d’une verdùre austère; son écorce épaisse et grisâtre le protège
contre la morsure des frimas.
Isolé dans la campagne, il cache un tronc branchu sous une pyramide de
feuillage dont la base affleure le sol. 11 résiste à la tempête, ou, s’il lui cède,
ce n’est qu’en se brisant.
Le Sapin ne craint rien des grands froids, mais il redoute les climats plus
doux où ù un hiver incertain succèdent de traîtresses gelées de printemps ; ses
bourgeons précoces, promptement épanouis, ne résistent pas à ces retours de
saison. 11 aime un sol divisé, frais et un peu profond, insinue volontiers ses
racines entre les strates verticales ou fortement inclinées des roches calcaires et
craint les ardeurs du soleil du midi ou de l’ouest.
Les feuilles sont courtes (15 à 30.millimètres), très-étroites (2 à 3 millimètres)
et aplaties. Elles sont disposées par doubles rangées de chaque côté du
rameau et obtuses à la pointe. Leur verdure est tendre sur les pousses printanières,
sombre ù maturité (planche I, I ); deux traits blancs rayent la face inférieure
dans le sens de la longueur.
Les fleurs sont monoïques, d’un jaune verdâtre, disposées en chatons cl
placées ordinairement vers le haut de la cime. Les chatons mâles, d’une dimension
qui dépasse en longueur celle d’une capsule de fusil de chasse, sont groupés en
grand nombre h l’extrémité du rameau qu’ils entourent (I, 2). Plus longs et un
peu moins gros qu’un dé h coudre, les chatons femelles se -posent, dressés et
solitaires;' le long des rameaux dépourvus de fleurs mâles (I, 3). Celte floraison
Sous l’influence de la chaleur les chatons femelles grossissent rapidement,
et, sans jamais se départir de leur position érigée et verticale, ne tardent pas ù
devenir des cônes ou strobiles de forme cylindro- ovoïde d’un ton vert brunâtre,
qui mûrissent on octobre (1, 4). A la suite de la maturité, les écailles se désarticulent
et tombent avec les graines qu’elles recouvrent. La figure 5 représente
une écaille vue en dedans avec ses deux raines encore adhérentes; on voit que
chacune est munio d’une- aile assez large qui recouvre presque la moitié de la
face intérieure do l'écaille. Celle-ci, ù t’extérieur, est munie d'une bradée, sorte
do petit appendice foliacé devenu coriace et ligneux par la maturation et qui,
plus long que l’écaille elle-même, la dépa se de la pointe (I, A cl G).
Au printemps, quand la neige des montagnes a disparu pour ne revenir
qu'après le retour de l'automne, la graine tombée sur le sol germe promptement.
Tandis que sa partie intérieure se transforme en gemmule, son. enveloppe s'élève
avec la tigelle et retient quelque temps en faisceau les feuilles cotylédonaires
(1, 7), qui bientôt brisent ce périsperme comme le poussin la coque de l'oeuf.
et s'épanouissent librement (I, S). Le jeune plant ainsi formé a besoin d'abri
pendant les premières années, sans quoi les insolations de Pété le dessécheraient
promptement.
Parvenu à maturité, c’est-it-dire h l’âge de cent ou cent vingt ans, le Sapin,
È R E S
avec ses belles dimensions, donne un bois recherché pour les grandes constructions
civiles et toute espèce d’autres usages. D’une fente facile, il s'emploie
non-seulement en poutres, mais en madriers, planches, lattes, bardeaux, etc.
Après dessiccation à l'air, ¡I accuse une densité qui varie de 0,48 à 0,56, l'unité
étant l'eau distillée à la température de ù degrés.
L’écorce est tannilère et donne un combustible bien supérieur h celui du
bois qui est médiocre : celui-ci flambe bien, mais il pétillé avec excès et donne
beaucoup de fumée. La capacité calorifique du Sapin n'est guère que les deux
tiers de celle du hêtre. Cependant lorsqu’on fabriquait, en France, du fer au charbon
de bois, le charbon de Sapin n'était pas dédaigné par les maîtres de forges.
L'ÉPICÉA (RI, I.,Fig. 9 ù 15). — L'Épicéa commun [Picea vulgaris,
excelsa, rubra, etc.; Abies de Linné et des Anglais) est le compagnon du Sapin
avec lequel le vulgaire le confond souvent, compagnon hardi et aventureux. Il
le dépasse en altitude dans les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, et
descend volontiers plus bas que lui dans des fonds marécageux où le Sapin
périrait. L’aspect de l'Epicéa ne le cède en rien dans son ensemble ù celui du
Sapin : il offre une hauteur et une rectitude pareilles ; „ses branches que
chargent des feuilles plus nombreuses, s’inclinent davantage en arcs réguliers;
sa flèche est plus aiguë, sa pyramide, s'il croit isolé, plus fournie et
plus ample ù la base; s'il croit en massif, la couleur rougeâtre de son écorce
le distingue du tronc gris cendré du Sapin. Plus aisément que le Sapin, il est
le jouet de la tempête et n'enfonce pas comme lui un long et solide pivot dans
les entrailles du rocher ; scs ..rapines traçantes ne l'attachent qu’à la partie la
plus superficielle du sol.
Les feuilles de l’Épicéa sont d’un vert plus vif et moins vernissé que celles
du Sapin; elles sont aussi plus courtes, plus fines, éparses tout autour du
rameau, plus aiguës de la pointe, moins larges cl pbinl aplaties (I, 9), mais en
forme do prismes h quatre pans déprimés au milieu, comme on peut le constater
en les examinant sous un grossissement suffisant (I, 15).
Les chatons mâles et femelles sont unjpeu plus volumineux respectivement
que ceux du Sapin. Les premiers affectent une teinte jaune rosé, les autres uñe
nuance rougeâtre. Ils se développent sur l’axe ou h l’extrémité des rameaux
dans une position dressée ou semi-horizontale (I, 10 et 11) . Peu ù peu, quand
la maturité approche, Jes fleurs femelles, devenues jeunes cônes, s'inclinent de
plus en plus pour prendre la position pendante (R- 9). C’est de mai en octobre
que la fleur-côneaccomplil son évolution entière. Les écailles ne tombent point :
elles s'entr’ouvrenl au printemps suivant pour laisser s'échapper les deux petites
graines ailées insérées sous chacune d'elles (1,12 et 13).
Moins précoces que ceux du Sapin, les bourgeons de l'Épicéa ne souffrent
pas autant des gelées printanières. L'arbre supporte d'ailleurs, mieux, que le
Sapin, les froids les plus rigoureux ; il se contente des plus mauvais sols et des
moins profonds, et prospère eb'core, sauf .à perdre une partie des qualités de
son bois, dans les terres humides et tourbeuses. Les expositions du nord et de
l’est sont celles qu'il prélère. Un léger abri contre les ardeurs du soleil est utile
au jeune plant.
Les emplois de l'Épicéa sont les mêmes que ceux du Sapin, bien que celui-ci
soit prisé davantage pour la charpente, et celui-là, dont la grosseur se
soutient moins, pour la menuiserie. La densité de l’Épicéa desséché à l'air est
de 0,31 à 0,50, inférieure à celle du Sapin. Le chauffage en est meilleur sans
être de premier choix.