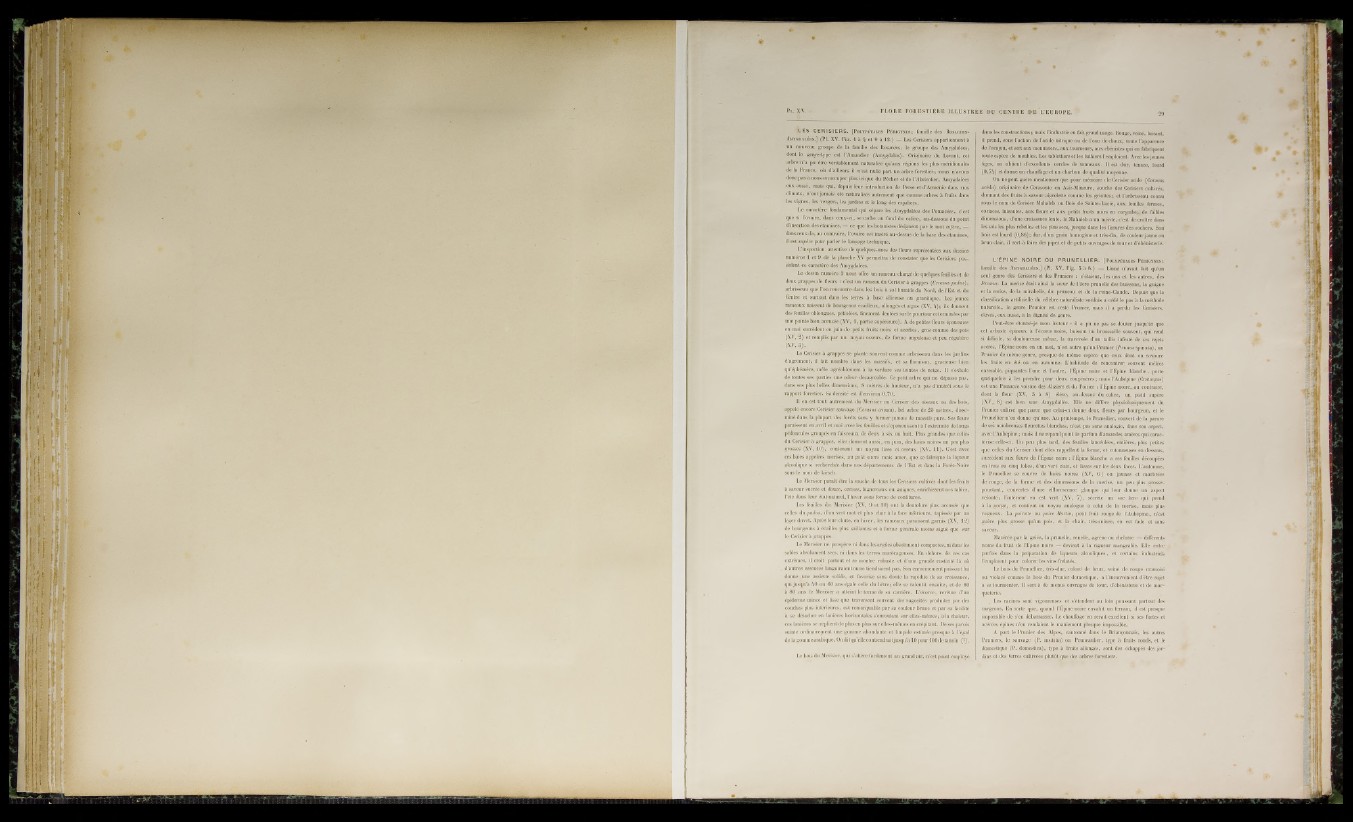
lililí. Ill l i i l
ViM
li
FLORE FORESTIÈRE ILLUSTRÉE DU CENTRE DE L’EUROPE.
CERISIERS. [Polypîtales PiiniGïNEs; famille des Rosacées-
Auygdai.iîks.] (Pl. XV. Fig. 1 à A cl 9 à 12.) — Les Cerisiers appartiennent h
un nouveau groupe de la làmille des Rosacées, le groupe des Amygdalées,
dont le genre-type est l’Amandier (Amygdalus). Originaire du Levant, cet
arbre n’a pu être véritablement naturalisé qu’aux régions les plus méridionales
de la France, où d’ailleurs il n’est nulle part un arbre forestier ; nous n'avons
donc pas à nous enoccuper plus ici que du Pécher et de l'Abricotier, Amygdalées
eux aussi, mais qui, depuis leur introduction de Perse et d’Arménie dans nos
climats, n oni jamais été naturalisés autrement que comme arbres à fruits dans
les vignes, les vergers, les jardins cl le long des espaliers.
Le caractère fondamental qui sépare les Amygdalées des Pomacées, c’est
que si l’ovaire, dans ceux-ci, se cache au fond du calice, au-dessous du point
d’insei¡l¡on des étamines, — ce que les botanistes désignent par le mol infère, -r-
dans ceux-là, au contraire, l’ovaire est inséré au-dessus de la base des étamines,
il est supére pour parler le langage technique.
L’inspection attentive de quelques-unes des fleurs représentées aux dessins
numéros 1 et 9 dé la planche XV permettra de constater que les Cerisiers possèdent
ce Caractère des Amygdalées.
Le dessin numéro 1 nous offre un rameau chargé de quelques feuilles et de
deux grappes de fleurs : c’est un rameau du Cerisier à grappes (Ccrasus poilus),
arbrisseau qué l'on rencontre dans les bois à sol humide du Nord, de l’E stel du
Centre et surtout dans les terres à base siliceuse ou granitique. Les jeunes
rameaux naissent de bourgeons écailleux, allongés et aigus (XV, 4); ils donnent
des feuilles oblongues, pétiolées, finement dentées sur le pourtour et terminées par
une pointe bien accusée (XV, 1, partie supérieure). A de petites fleurs épanouies
en mai succèdent en juin de petits fruits noirs et acerbes, gros comme des pois
(XV, 2) et remplis par un noyau osseux, de forme anguleuse et peu régulière
(XV, 3).
Le Cerisier à grappes se plante souvent comme arbrisseau dans les jardins
d'agrément; il fait nombre dans les massifs, et sa floraison, gracieuse bien
qu'éphémère, mêle agréablement à la verdure ses teintes de neige. Il s’exhale
de toutes ses parties une odeur désagréable. Ce petit arbre qui ne dépasse pas,
dans ses plus belles dimensions, 8 mètres de hauteur, n’a pas d’intérêt sous le
rapport forestier. Sa densité est d'environ 0,70.
11 en est tout autrement du Merisier ou Cerisier des oiseaux ou des bois,
appelé encore Cerisier sauvage (Cerasus avium), bel arbre de 25 mètres, disséminé
dans la plupart des forêts sans y former jamais de massifs purs. Ses fleurs
paraissent en avril et mai avec les feuilles et s'épanouissent à l'extrémité de longs
. pédoncules groupés en faisceaux de deux à six ou huit. Plus grandes que celles
du Cerisier à grappes, elles donnent aussi, en juin, des baies noires un peu plus
grosses (XV, 10), contenant un noyau lisse et osseux (XV, 11). C’est avec
ces baies appelées merises, au goût sucré mais amer, que se fabrique la liqueur
alcoolique si recherchée dans nos départements de l'Est et dans la Forét-Noire
sous le nom de kirsch.
Le Merisier paraît être la souche de tous les Cerisiers cultivés dont les fruits
à saveur sucrée et douce, cerises, bigarreaux ou guignes, enrichissent nos tables,
l’été dans leur état naturel, l'hiver sous forme de confitures.
Les feuilles du Merisier (XV, 9 et 10) ont la dentelure plus accusée que
celles du padus, d'un vert mal et plus clair à la face inférieure, tapissée par un
de bourgeons à écailles plus saillantes et à forme générale moins aiguë que sur
Le Merisier ne prospère ni dans lesargilos absolument compactes, ni dans les
sables absolument secs, ni dans les terres marécageuses. En dehors do ces cas
extrêmes, il croit partout et se montre robuste et d'une grande rusticité là où
... d’autres essences languiraientoune tiendraient pas. Son enracinement puissant lui
donno une assiette solide, et favorise sans doute la rapidité de sa croissance,
qui jusqu'à 40 ou GO ans égale celle du hêtre ; elle se ralentit ensuite, et de 60
à 80 ans le Merisier a atteint le terme de sa carrière. L'écorco, revêtue d'un
épiderme mince et lisse que traversent souvent des'rugosités produites par des
couches plus inférieures, est remarquable par sa couleur brune et par sa facilité
à se détacher en lanières horizontales s’enroulant sur elles-mêmes; à la chaleur,
ces lanières se replient do plus en plus sur elles-mêmes en crépitant. Doses parois
. suinte ordinairement une gomme abondante et limpide estimée presque à l’égal
do la gommoarabiquo. On dit qu’elle contiendrait jusqu’à 10 pour 100 do tannin (?).
Leboi du Merit nul ai
dans les constructions ; mais l’industrie en rail.grand usage. Rouge, veiné, luisant,
il prend, sous l’action de l’acide nitrique ou de l’eau de chaux» toute l’apparence
de l’acajou, et sert aux menuisiers, aux tourneurs, aux ébénistes qui en fabriquent
toute espèce de meubles. Les tableltiers et les luthiers l’emploient. Avec les jeunes
tiges, on obtient d’excellents cercles de tonneaux. 11 est dur, tenace, lourd
(0,74) et donne un’chauffage et un charbon de qualité moyenne.
On ne:peut guère mentionner que pour mémoire : le Cerisier acide (Cerasus
acèda) originaire de Cerasonle en Asie-Mineure, souche des Cerisiers cultivés,
donnant des fruits à saveur aigrelette comme les griottes ; et l’arbrisseau connu
sous le nom de Cerisier Mahaleb ou Bois de Sainle-Lucie, aux feuilles fermes,
coriaces, luisantes, aux fleurs, et aux petits fruits noirs en corymbc; de faibles
dimensions, d’une croissance lente, le Mahaleb a un mérite, c’est de croître dans
les sols les plus rebelles et les plus secs, jusque dans les. fissures des rochers. Son
bois est lourd (0,86); dur, d’un grain homogène et très-fin, de couleur jaune ou
brun clair, il sert à faire des pipes et de petits ouvrages de tour et d’ébénisleric.
-- -L'ÉPINE NOIRE .OU PRUNELLIER. [ PolypjStalbs Piîiugynes;
famille des Amygdalées.] (PL XV. Fig. 5 à 8 . )— Linné n’avait fait qu’un
seul genre des Cerisiers et des Pruniers : c’étaient, les uns et les autres, des
Prunus. La merise était ainsi la soeur de l’êcre prunelle des buissons, la guigne
et la cerise, de la mirabelle, du pruneau et de la reine-Claude. Depuis que la
classification artificielle du célèbre naturaliste suédois a cédé le pas à la méthode
naturelle, le. genre Prunier est resté Prunier, mais il a perdu les Cerisiers,
élevés, eux aussi, à la dignité de genre.
Peut-être étonné-je mon lecteur : il a pu ne pas se douter jusqu’ici que
cet arbuste épineux à l’écorce noire, buisson ou broussaille souvent, qui rend
si difficile, si douloureuse même, la traversée d’un taillis infesté de ses rejets
acérés, l’Epine noire en un mot, n’est autre qu’un Prunier (Prunus spinosa), un
Prunier de même genre, presque de même espèce que ceux dont on savoure
les fruits en été ou en automne. L’habitude de rencontrer souvent mêlées
ensemble, piquantes l’une et l’autre, l’Épine noire et l’Épine blanche, porte
quelquefois à les prendre pour deux congénères ; mais l’Aubépine (Craloegus)
est une Pomacée voisine des Aliziers et du Poirier : l’Épine noire, au contraire,
dont la fleur (XV, 5 à 8) élève, au-dessus« du calice, un pistil supère
(XV, 8) est bien une Amygdallée. Elle ne* diffère physiologiquement du
Prunier cultivé que parce que celui-ci donne deux fleurs par bourgeon, et le
Prunellier n’en donne qu’une. Au printemps, le Prunellier, couvert de la parure
de ses nombreuses fleurettes blanches, n’est pas sans analogie, dans son aspect,
avec l’Aubépine ; mais il ne répand point le parfum d’amandes amères qui caractérise
celle-ci. Un peu plus tard, des feuilles lancéolées, entières, plus petites
que celles du Cerisier dont elles rappellent la forme, et cotonneuses en dessous,
succèdent aux fleurs de l’Épine noire : l’Épine blanche a ses feuilles découpées
en trois ou cinq lobes, d’un vert clair, et lisses sur les deux faces. L’automne,
le Prunellier se couvre de baies noires (XV, 6 ) ou jaunes et marbrées
de rouge, de la forme et des dimensions de la merise, un peu plus grosses
pourtant, couvertes d’une efflorescence glauque qui leur donne un aspect
velouté; l’intérieur en est vert (XV, 7), sécrète un suc âcre qui prend
à la gorge, cl contient un noyau analogue à celui de la merise, mais plus
rugueux. La poirolle ou poire Martin, petit fruit rouge de l’Aubépine, n’est
guère plus grosse qu’un pois, et la chair, très-mince, en est fade et sans
Macérée par la gelée, la prunelle, senelle, agrène ou chelosse — différents
noms du fruit de l’Épine noire — devient à la rigueur mangeable. Elle entre t
parfois dans la préparation de liqueurs alcooliques, et certains industriels
l’emploient pour colorer les vins frelatés.
Le bois du Prunellier, très-dur, coloré de brun, veiné de rouge cramoisi
ou violacé comme le bois du Prunier domestique, a l’inconvénient d’être sujet
à se tourmenter. 11 sert à de menus ouvrages de loUr, d’ebénisterie et de marqueterie.
. Les racines sont vigoureuses et s'étendent au loin poussant partout des
surgeons. En sorte que, quand l’Épine noire envahit un terrain, il est presque
impossible de s'en débarrasser. Le chauffage en serait excellent si ses fortes et
acérées épines n'en rendaient le maniement presque impossible.
A part le Prunier des Alpes, cantonné dans le Briançonnais, les autres
Pruniers, le sauvage (P. insititia) ou Pruncaulicr, type à fruits ronds, et le
domestique (P. domeslica), type à fruits allongés, sont des échappés des jardins
et des terres cultivées plutôt que des arbres forestiers.
9I!
i l I
§