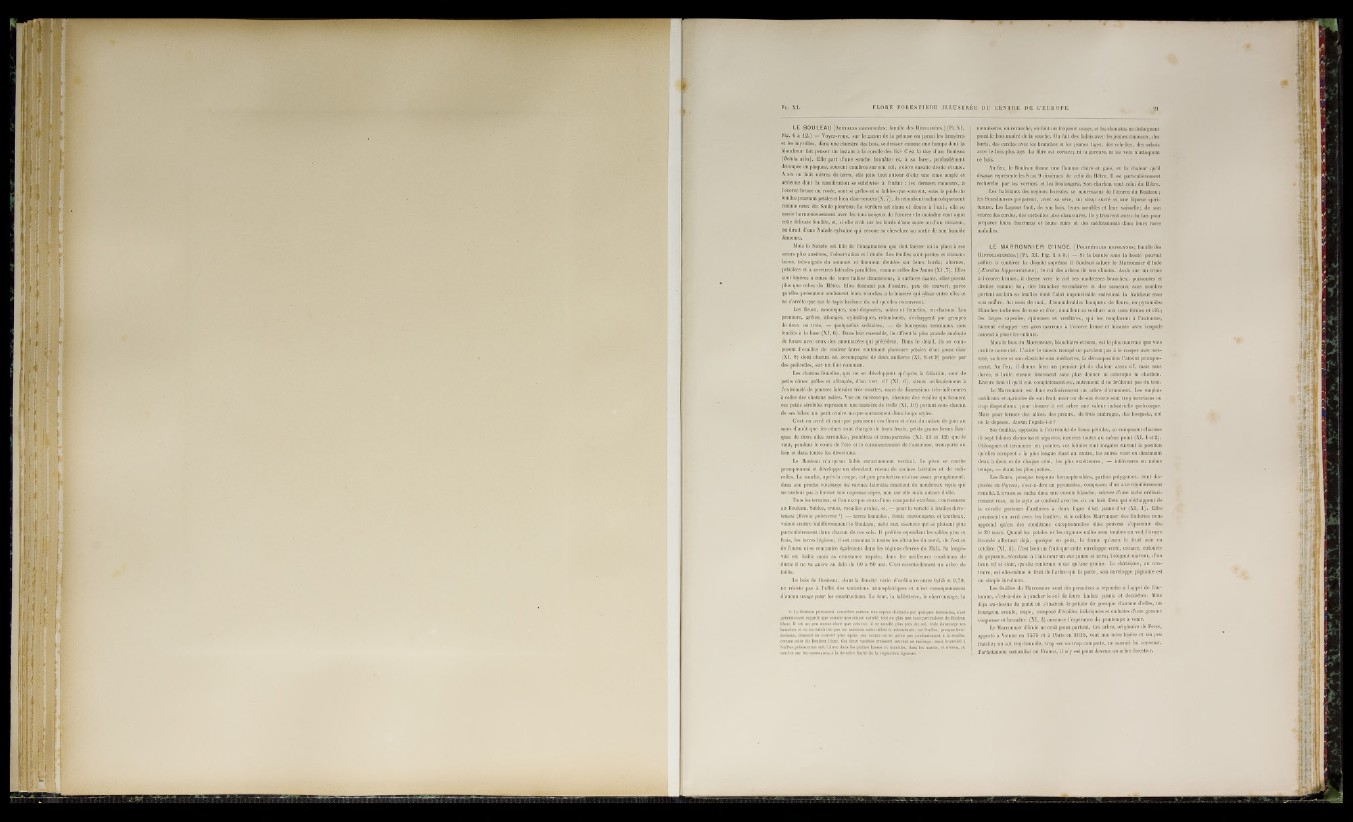
li
l ì
S i ,
FLORE FORESTIERE ILLUSTRÉE DU CENTRE DE L’EUROPE.
LE BOU LEAU [Apétales a.mentaoées; famille des Bétulinébs.] (Pl. XI.
Fig. 6 S 12.) — Voyez-vous, sur le gazon de la pelouse ou parmi les bruyères
et les myrtilles, dans une clairière des bois, se dresser comme une hampe dont la
blancheur fait penser un instant a la corolle des lis? C’est la lige d'un Bouleau
(Belula allia),. Elle part d’une souche brunâtre et, h sa base, profondément
découpée en plaques, souvent.cambrée sur son col; s'élève ensuite droite et unie.
A six ou huit mètres de terre, elle jette tout autour d’elle une cime ample et
aérienne dont la ramification se subdivise h l’infini : les derniers rameaux, h
l'écorce brune ou rosée, sont si grêles et si faibles que souvent, sous le poids de
feuilles pourtant petites et bien clair-semécs (X, 7), ils retombent mélancoliquement
comme ceux du Saule pleureur. La verdure est claire et douce h l’oeil ; elle sç
marie harmonieusement avec les tons neigeux de l’écorce : le moindre vent agite
cette délicate feuillée, et, si elle croit sur les bords d’une mare ou d'un ruisseau,
on dirait d’une Naïade sylvaine qui secoue sa chevelure au sortir de son humide
demeure.
Mais la Naïade est fille de l'imagination qui doit laisser ici la place à ses
soeurs plus austères, l'observation et l’étude. Les feuilles sont petites et triangulaires,
très-aiguës du sommet et finement dentées sur leurs bords; alternes,
pétiolées et à nervures latérales parallèles, comme celles des Aunes (XI ,7). Elles
sont légères a cause de leurs faibles dimensions ; à surfaces égales, elles pèsent
plus que celles' du Hêtre. Elles donnent peu d’ombre, peu de couvert, parce
qu’elles présentent seulement leurs tranches h la lumière qui glisse entre elles et
ne s'arrête que sur le (apis herbacé du sol qu'elles recouvrent.
Les fleurs, monoïques, sont disposées, mâles et femelles, en chatons. Les
premiers, grêles, allongés, cylindriques, retombants, s’échappent par groupes
de deux ou trois, — quelquefois solitaires, — de bourgeons terminaux non
feuillés à la base (XI, 6). Dans leur ensemble, ils offrent la plus grande analogie
de forme avec ceux des amentacées qui précèdent. Dans le détail, ils se composent
d'écailles de couleur fauve soutenant plusieurs pétales d'un jaune clair
(XI, S) dont chacun est accompagné de deux anthères (XI, S et 9) portés par
des pédicelles, sur un Glet commun.
Les chatons femelles, qui ne se développent qu'après la foliation, sont de
petits cènes grêles et allongés, d'un vert vif (XI, 6), situés ordinairement h
l'extrémité de pousses latérales très-courtes, mais de dimensions très-inférieures
à celles des chatons mâles. Vue au microscope, chacune des écailles qui forment
ces petits strobiles représente une manière de trèfle (XI, 10) portant sous chacun
de ses lobes un petit ovaire hu que surmontent deux longs styles.
C’est en avril et mai que paraissent ces fleurs et c’est du milieu de juin au
mois d’août que les cènes sont chargés de leurs fruits, petits grains bruns flanqués
de deux ailes arrondies, jaunâtres et transparentes (XI, 11 et 12) que le
vent, pendant le cours de l’été et le commencement de l'automne, transporte au
loin et dans toutes les directions.
Le Bouleau n’a qu'un faible enracinement vertical. Le pivot se courbe
promptement et développe un abondant réseau de racines latérales et de radicelles.
La souche, après la coupe, est peu productive et s'use assez promptement;
dans son proche voisinage les racines latérales émettent de nombreux rejets qui
ne tardent pas à former une copieuse cépée, non sur elle mais autour d’elle.
Tous les terrains, si l’on excepte ceux d'une compacité extrême, conviennent
au Bouleau. Sables, craies, rocailles arides, et, — pour la variété à feuilles duveteuses
(Belula pubescens ') — terres humides, fonds marécageux et tourbeux,
voient croître indifféremment le Bouleau, mêlé aux essences qui se plaisent plus
particulièrement dans chacun de ces sols. Il préfère cependant les sables gras et
frais, les terras légères ; il est commun h toutes les altitudes du nord, de l'est et
de l’ouest et se rencontre également dans les régions élevées du Midi. Sa longévité
est faible mais sa croissance rapide; dans les meilleures conditions de
durée il ne va guèro au délit de 60 h 80 ans. C’est essentiellement un arbre do
taillis.
.o bois do Bouleau, dont la densité
liste pas h l’effet des variations ati
in usage pour les constructions. Le
(trio d'ordinaire entre 0,65 et 0,70,
sphériques et n'est conséqucmmenl
ir, la tabletterie, le charronnage, la
menuiserie, en revanche, en font un fréquent usage, et les ébénistes ne dédaignent
point le bois madré de la souche. On fait des balais avec les jeunes rameaux, des
harts, des cercles avec les branches et les jeunes liges, des échelles, des sabots
avec le bois plus âgé. La fibre est coriace; ni la gerçure, ni les vers n'attaquent
ce bois.
Au feu, le Bouleau donne'une flamme claire et gaie, et la chaleur qu'il
dégage représente les 8 ou 9 dixièmes de celle du Hêtre. Il est particulièrement
recherché par les verriers et les boulangers. Son charbon vaut celui du Hêtre.
Les habitants des régions boréales se nourrissent de l'écorce du Bouleau ; ■
les Scandinaves préparent, avec sa séve, un sirop sucré et une liqueur spiri-
lueusc. Les Lapons font, de son bois, leurs meubles et leur vaisselle; de son
écorce des cordes, des corbeilles ,des chaussures. Ils y trouvent aussi du tan pour
préparer leurs fourrures et leurs cuirs et des médicaments dans leurs rares
maladies.
LE MAR RONNIER D' I N DE. [Poi.ïcétai.es iiïpouy.nes; famille des
IIu'pocastanébs.] (Pl. XI. Fig. 1 h 5.) — Si la beauté sans la bonté pouvait
suffire h conférer la dignité suprême il faudrait saluer le Marronnier d'Inde
(Æseulus Itippocaslamun), le roi des arbres de nos climats. Assis sur un tronc
il l’écorce brunie, il dresse vers le ciel ses maîtresses branches,- puissantes cl
droites comme lui ; des branches secondaires et des rameaux sans nombre
portent au loin sa feuillée dont l'abri impénétrable entretient la fraîcheur sous
son ombre. Au mois de mai, d'innombrables bouquets de fleurs, en pyramides
blanches tachetées de rose et d’or, émaillenl sa verdure aux tons fermes et vifs ;
les larges capsules, épineuses et verdâtres, qui les remplacent à l’automne,
laissent échapper ces gros marrons à l’écorce brune et luisante avec lesquels
aiment h jouer lés enfants.
Mais le bois du Marronnier, blanchâtre et mou, est le plus mauvais que voie
croître notre ciel. L’acier le mieux trempé ne parvient pas à le couper avec netteté,
sa force et son élasticité sont médiocres, la décomposition l’atteint prompte-
meut. Au feu, il donne bien un premier jet de chaleur assez vif, mais sans
durée, et brûle ensuite lentement sans plus donner ni calorique ni charbon.
Encore faut-il qu’il soit complètement sec, autrement il ne brûlerait pas du tout.
Le -Marronnier est donc exclusivement un arbre d’ornement. Les emplois
médicaux et agricoles de son fruit amer ou de son écorce sont trop incertains ou -
trop dispendieux pour donner h cet arbre une valeur industrielle quelconque.
Mais pour former des allées, des préaux, de. frais.ombrages, des bosquets, nul
ne le dépasse. Aucun Fégalé-l-il?
Ses feuilles, opposées à l’extrémité de longs pétioles, se composent chacune
de sept folioles distinctes et séparées, insérées toutes au même point (XI, lo t 2).
Oblongues et terminées en pointes, ces folioles sont inégales suivant la position
qu’elles occupent : la plus longue étant au centre, les autres vont en diminuant
deux h deux et de chaque côté, les plus extérieures, — inférieures en même
temps, — étant les plus petites.
Les fleurs, presque toujours hermaphrodites, parfois polygames, sont disposées
en thyrses, c’esl-à-dire en pyramides, composées d’un axe régulièrement
ramifié. L’ovaire se cache dans une corolle blanche, relevée d’une tache ordinairement
rose, et le style se confond avec les six ou huit filets qui s'échappent de
la corolle porteurs d'anthères h deux loges d'un jaune d'or (XI, 1). Elles
paraissent en avril avec les feuilles, et le célèbre ûlarronnier des Tuileries nous
apprend qu'en des conditions exceptionnelles elles peuvent s'épanouir dès
le 20 mars. Quand les pétales et les-organcs mâles sont tombés on voit l’ovaire
.fécondé affectant déjà, quoique en petit, la forme qu'aura le fruit mûr en
octobre (XI, 4). C'est bien un fruit que celle enveloppe verte, coriace, entourée
do piquants, sécrétant à l'intérieur un suc jaune et âcre; l’élégant marron, d’un
brun vif et clair, qu’elle renferme n'est qu’une graine. La châtaigne, au contraire,
est elle-même le fruit de l'arbre qui la porte, son enveloppe piquante est
un simple involucre.
Les feuilles du Marronnier sont des premières à répondre à l'appel de l'automne,
c’est-à-dire à joncher le sol de leurs limbes jaunis et desséchés. Mais
déjà au-dessus du point où s’insérait le pétiole de presque chacune d’elles, un
bourgeon ovoïde, trapu, composé d'écailles imbriquées et enduites d'une gomme
visqueuse et brunâtre (XI, 3) annonce l’espérance du printemps à venir.
Le Marronnier d’Inde ne croit point partout. Cet arbre, originaire de Perse,
apporté à Vienne en 1575 et à Paris en 1615, veut une terre légère et un peu
fraîche; un sol trop humide, trop sec ou trop compacte, ne saurait lui convenir.
Parfaitement naturalisé en France, il n’y est point devenu un arbre forestier.
i f 1
11
Hi]
l! n
i j j
l ü
fr
1 1
Ü ï
fi
il