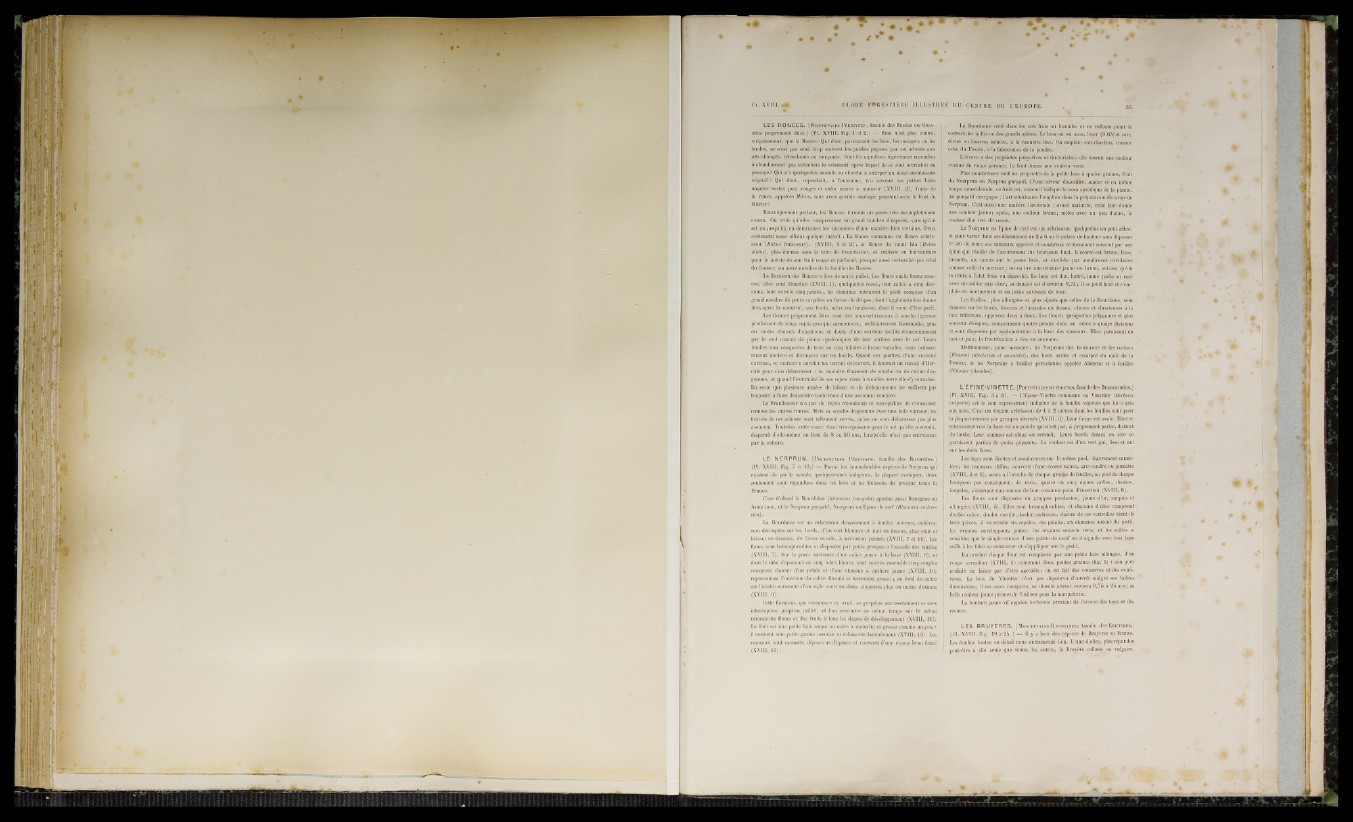
m m
• 0
FLQRË FORESTIÈRE ILLUSTRÉE DU CENTRE DE L’ EUROPE.
LES R 0 NCES. [Polypétales Pébigynes; famille des Rosées ou Rosa- -
céiîs proprement dites.] (Pl. XVIII:*Fig. 1 et 2;) — Rien n'est plus- connu,
vulgairement, que la Ronce.-Qui donc, parcourant les bois, les murgers ou- les
landes, ne s’est pas senti trop souvent les jambes piquées par cet arbuste aux
jets allongés, retombants ou rampants, dont les aiguillons légèrement recourbés
n’abandonnent pas volontiers le vêtement après lequel ils se sont accrochés au
passage? Qui n’a quelquefois maudit ou cherché h extirper un aussi envahissant
végétal ? Qui donc, cependant, h l’automne, n’a savouré ces petites baies
naguère vertes puis rouges et enfin noires h maturité (XVIII, 2);' fruits de
la' ronce, appelées Mûres, sans avoir grande analogie pourtant avec le fruit du
Mûrier?
Bolaniquement parlant, les Ronces forment un genre très-incomplétement
connu. On croit qu’elles comprennent un grand nombre d’espèces, sans qu’on
ail pu jusqu’ici en déterminer les caractères d’une manière bien certaine. Deux
seulement nous offrent quelque intérêt : La Ronce commune ou Ronce arbrisseau'(/
lufrifs frulicosus), (XVIII, 1 et 2 ) ; la Ronce du mont Ida (ñubus
iilams), plus connue sous le nom de Framboisier, et cultivée en horticulture
pour le mérite de son fruit rouge et parfumé, presque aussi recherché que celui
du fraisier, un autre membre de la famille des Rosées.
La floraison des Ronces a lieu de mai à juillet. Les fleurs ont la forme rosacée,
elles sont blanches (XVIII, 1), quelquefois roses; leur calice a cinq divisions,
leur corolle cinq pétales ; les étamines entourent le pistil composé d’un
grand nombre de petits carpelles en forme de drupes, dont l’agglomération donne
. lieu, après la maturité, aux fruits, mûre ou framboise, dont il vient d’être parlé.
Les Ronces proprement dites sont des sous-arbrisseaux à souche ligneuse
produisant de longs rejets presque sarmenteux, ordinairement bisannuels, plus
ou moins chargés d’aiguillons et doués d’une extrême facilité d’enracinement
par le seul contact de points quelconques de leur surface avec le sol. Leurs
feuilles sont composées de trois ou cinq folioles à forme variable, mais ordinairement
dentées et découpées sur les bords. Quand ces plantes, d’une rusticité
extrême, se mettent à envahir un terrain découvert, il faudrait un travail d’Hercule
pour s’en débarrasser : le moindre fragment de souche ou de racine dra-
geonne, et quand l’extrémité de ses rejets vient à toucher terre elle s’y enracine.
En sorte que plusieurs années de labour et de défoncements ne suffisent pas
toujours h faire disparaître toute trace d’une ancienne roncière.
Le Framboisier n’a pas de rejets retombants et susceptibles de s’enraciner
comme les autres ronces. Mais sa souche drageonne avec une telle vigueur, les
fourrés de cet arbuste sont tellement serrés, qu’on ne s’en débarrasse pas plus
aisément. Toutefois, cette ronce étant très-épuisante pour le sol qu’elle a envahi,
disparaît d’elle-même au bout de 8 ou 10 ans, lorsqu’elle n’est pas entretenue
par la culture.
LE NERPRUN. [ Polypétales Péiugynes; famille des Ruminées.]
(Pl. XVIII. Fig. 7 h 13.) — Parmi les innombrables espèces de Nerprun qui
existent de par le monde, quelques-unes indigènes, la plupart exotiques, deux
seulement sont répandues dans les bois et les buissons de presque toute la
C’est d’abord la Bourdaine (it/iamnus frángula) appelée aussi Bourgène ou
Aune noir, et le Nerprun purgatif, Noirprun ou Épine de cerf (llhammis calhar-
La Bourdaine est un arbrisseau drageonnant h feuilles alternes, entières,
non découpées sur les bords, d’un vert bleuâtre et mat en dessus, plus clair et
luisant en dessous, de forme ovoïde, à nervation pennée.(XVIII, 7 et 11). Les
fleurs sont hermaphrodites et disposées par petits groupes h l’aisselle des feuilles
(XVIII, 7). Sur la paroi intérieure d’un calice jaune h la base (XVIII, S), et
dont le tube s’épanouit en cinq lobes blancs, sont insérés ensemble cinq couples
composés chacun d’un pétalo et d’une étamine h anthère jaune (XVIII, 10,
représentant l’intérieur du calice déroulé et fortement grossi) ; au fond du calice
(XVIII, 9).
Cette floraison, qui commenco en avril, se perpétue successivement et sans
interruption jusqu’en juillet, et l’on rencontre en ménte temps sur le même
rameau des fleurs et des fruits h tous les degrés de développement (XVIII, 11).
Le fruit est uno petite baie rouge ou noire h maturité et grosso -comme un pois ;
il contient une petite graine osseuse et échancrée latéralement (XVIII, 12). Les
(XVIII, 13).
La Bourdaine croît dans les sols frais ou humides cl ne redoute point le
couvert des taillis ou des grands arbres. Le bois en est mou, léger (0,63) et sert,
divisé en lanières minces, h la vannerie .fine. On emploie son<charbon, comme
celui du Fusain, h la fabrication de la poudre.
L’écorce a des propriétés purgatives et tinctoriales; cllo fournit une couleur
voisine du rouge garance. Le fruit donne une couleur verte.
Plus nombreuses sont les propriétés dé la petite baie a quatre graines, fruit
du Noirprun ou Nerprun purgatif. D’une saveur douceâtre, amère et en même
temps nauséabonde, ce fruit est, comme l’indique le nom spécifique de la plante,
un purgatif énergique : l’art vétérinaire l’emploie dans la préparation du sirop'dc
Nerprun. C’est aussi une matière tinctoriale : avant maturité, cette baie donne
une couleur jaune; après, une couleur brune; mêlée avec un peu d’alun, la
couleur dite vert de vessie.
Le Noirprun ou Épine de cerf est un arbrisseau, quelquefois un petit arbre,
et peut varier dans ses dimensions de 2 à 6 ou 8 mètres de hauteur sans dépasser
0",50 de tour; ses rameaux opposés et nombreux se terminent souvent par une
épine qui résulte de l’avortement du bourgeon final. L’écorce est brune,Tisse,
luisante, au moins sur le jeune bois, et s'exfolie par membrures circulaires
comme celle du merisier : on en tire une teinture jaune ou brune, suivant qu’on
la traite à l’état frais ou desséché. Le bois est dur, lustré, jaune paille ou rosé
avec un aubier gris clair; sa densité est d'environ 0,71; il se polit bien et s’emploie
en marqueterie et en petits ouvrages de tour.
Les feuilles, plus allongées et plus aiguës que celles de la Bourdaine, sont
dentées sur les bords, foncées et luisantes en dessus, claires et duveteuses à la
face inférieure, opposées deux à deux. Les fleurs, quelquefois polygames et plus
souvent diolques, comprennent quatre pétales dans un calice à quatre divisions
et sont disposées par agglomération à la base des rameaux. Elles paraissent en
mai et juin; la fructification a lieu en'automne.
Mentionnons, pour mémoire, les Nerpruns des teinturiers et des rochers
(lîhamni infeclorius el saxalilis), des lieux arides et escarpés du midi de la
France, et les Nerpruns à feuilles persistantes appelés Alaterne et à feuilles
d’Olivier (oleoîdes).
L’É PIN E-VI NETTE. [Polypétales üypogynbs, famille des BBnuÉniDÉes.]
(Pl. XVIII. Fig. 3 à 6). — L'Épine-Vinette commune ou Vinettier (Berberis
vulgaris) est le seul représentant indigène de la famille végétale qui lui a pris
son nom. C’est un élégant arbrisseau de 1 à 2 mètres dont les feuilles sont pour
la plupart réunies par groupes alternés (XVIII, 3). Leur forme est ovale. Elles se
rétrécissent vers la base en un pétiole qui n’est pas, à proprement parler, distinct
du limbe. Leur sommet est obtus ou arrondi. Leurs bords dentés en scie se
garnissent parfois de petits piquants. La couleur est d'un vert gai, lisse et uni
sur les deux faces.
Les liges sont droites el nombreuses sur le même pied, légèrement cannelées;
les rameaux diffus, couverts d'une écorce mince, gris cendré ou jaunâtre
(XVI11. 3 et 6), ornés à l'aisselle de chaque groupe de feuilles, au pied de chaque
bourgeon par conséquent, de trois, quatre ou cinq épines grêles, droites,
inégales, s'écartant tout autour de leur commun point d’insertion (XVIII, 6).
Les fleurs sont disposées en grappes pendantes, jaune d’or, simples el
allongées (XVIII, 3). Elles sont hermaphrodites, et chacune d’elles comprend
double calice, double corolle, double androcée; chacun de ces verticilles étant de
trois pièces, il en résulte six sépales, six pétales, six étamines autour du pistil,
les organes enveloppants jaunes, les organes sexuels verts, et les mâles si
sensibles que le simple contact d’une pointe de canif ou d’aiguille avec leur base
suflil à les faire se contracter et s’appliquer sur le pistil.
En octobre chaque fleur est remplacée par une petite baie allongée, d’un
rouge vermillon (XVIII, /i) contenant deux petites graines (fig. 5) : son goût
acidulé ne laisse pas d'être agréable; on en fait des conserves et des confitures.
Le bois du Vinettier n'est pas dépourvu d’intérêt malgré ses faibles -‘
dimensions; il est assez compacte, sa densité atteint environ 0,75 à 25 ans; sa
belle couleur jaune permet de l'utiliser pour )a marqueterie.
La teinture jaune vif appelée berbérine provient de l’écorce des tiges et des
LES BRUYÈRES. [Monopétalbs Hypogynbs; famille des Eiucinébs.]
(Pl. XVIII. Fig. 19 à 24..) — Il y a bien des espèces de Bruyères en France.
Les étudier toutes en détail nous entraînerait loin. L’une d’elles, plus répandue
peut-être à elle seule que toutes les autres, la Bruyère callune ou vulgaire,