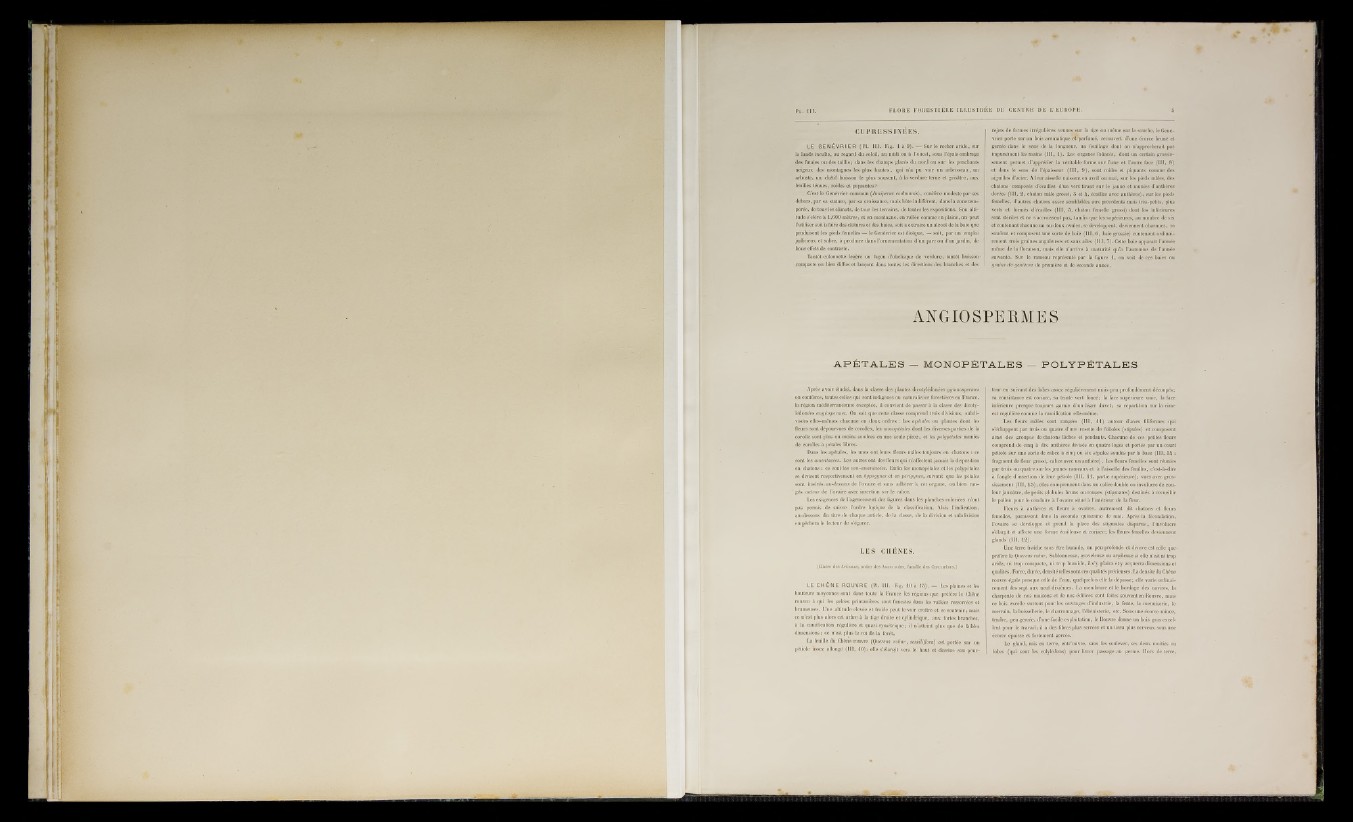
CUPRESSINÊES.
$ LE. GEN ÉV R IER fP 4 III. fig , 1 à 9)! — Sur le rocher aride, sur
la lande inculte, au regard du soleil, au midi ou h l'ouest, sous l'épais ombrage
des futaies ou des taillis; dans les champs glacés du nord ou sur les penchants
neigeux des montagnes les plus hautes, qui n’a pu voir un arbrisseau, un
arbuste, un cliétif buisson le plus souvent, & la verdure terne cl grisûtro, aux ■
feuilles ténues, roides et piquantes?
C’est le Genévrier commun (Juniperus conhnunis), conifère modeste par ses
dehors, par sa stature, par sa croissance, mais hôte .'indifférent, dans la zone tempérée,
de tous les climats, de tous les terrains, de toutes les expositions. Son altitude
s'élève h 1,600 mètres; et en montagne, en vallée comme en plaine, on peut ■
l’utiliser soit h faire des clôtures et des haies, soit à extraire un alcool de la baie que
produisent les pieds femelles — le Genévrier est dioTque, — soit, par un emploi
judicieux et sobre, à produire dans l’ornementation d’un parc ou d’un jardin, de
bons effets de contraste.
Tantôt colonnette.légère ou façon d’obélisque do verdure, tantôt buisson*
çojn pacte .ou bien diffus et lançant dans toutes les directions des branches et des
rejets de formes irrégulières venues sur la lige ou même sur la souche, le Genévrier
porte sur un bois aromatique «parfumé, recouvert d’une écorce brune et
gercée dans le sens de la longueur, un feuillage dont on n'approcherait pas
impunément les mains (III, 1). Les organes foliacés, dont un certain grossissement
permet d'apprécier la véritable forme sur l'une cl l'autre face (III, 8)
et dans le sens de l’épaisseur (III, 0 ), sont roides et piquanls comme des
aiguilles d’acier A leur aisselle naissent en avril ou mai, sur les pieds môles, des
chatons composés d'écailles d'un vert tirant sur le jaune et munies d'anthères
dorées (III, 2, chaton mâle grossi; 3 et h, écailles avec anthères); sur les pieds
femelles, d'autres chatons assez semblables aux précédents mais irès-pelits, plus
verts et formés d'écailles (III, 5, chaton femelle grossi) dont les inférieures
sont stériles et ne s'accroissent pas, tandis que les supérieures, au nombre de six
etcontenantchacuneun ou deux ovules, se développent, deviennent charnues, se
soudent et composent une sorte de baie (III, 6, baie grossie) contenant ordinairement
trois graines anguleuses et sans ailes (III, 7). Cette baie apparaît l'année
même de la floraison, mais elle n’arrive à maturité qu’h l’automne de l'année
suivante. Sur le rameau représenté par la ligure 1, on voit de ces haies ou
grains de genièvre de première et de seconde année.
ANGIOSPERMES
APÉTALES — MONOPÉTALES — POLYPÉTALES
Après avoir étudié, dans la classe des plantes dicotylédonécs gymnospermes
ou conifères, toutes celles qui sont indigènes ou naturalisées forestières en France,
la région méditerranéenne exceptée, il convient de passer il la classe des dicoty-
lédonécs angiospermes. On sait que celte classe comprend trois divisions, subdivisées
elles-mêmes chacune en deux ordres : Les apétales ou plantes dont les
fleurs sont dépourvues de corolles, les monopétales dont les diverses parties de la
corolle sont plus ou moins soudées en une seule pièce, et les polypélales munies
de corolles à pétales libres.
Dans les apétales, les unes ont leurs fleurs mâles toujours en chatons : ce
sont les amenlacées. Les autres ont des lleurs qui n'alfeclenl jamais la disposition
en chatons : ce sont les non-amentacées. Enfin les monopétales et les polypélales
se divisent respectivement en hypogynes et en périgynes, suivant que les pétales
’ gés autour de l’ovaire avec insertion sur le calice.
Les exigences de l'agencement des ligures dans les planches coloriées n’ont
pas permis de suivre l'ordre logique de la classification. Mais l’indication,
au-dessous du titre de chaque article, do la classe, de la division et subdivision
empêchera le lecteur de s'égarer.
LES CHÊNES.
LE CHÊNE ROUVRE (Pl. III. Fig. 10 à 15).— Les plaines et les
hauteurs moyennes sont dans louto la France les régions que préfère le Chênè
rouvre h qui les gelées printanières sont funestes dans les vallées resserrées cl
brumeuses. Une altitude élevée et froide peut le voir croître et se soutenir; mais
ce n’est plus alors cet arbre h la lige droite et cylindrique, aux fortes branches,
h la ramification régulière et quasi symétrique; il n’atteint plus que do faibles
dimensions ; ce n’est plus lo roi de la forêt.
1a feuille du Chêne rouvre (Quercus rolntr, sessiliflora) est portée sur un
pétiole tissez allongé (HII, 10); elle s’élargit vers lo haut et dessine son pourtour
en suivant des lobes assez régulièrement mais peu profondément découpés;
sa consistance est coriace, sa teinte vert foncé ; la face supérieure unie, la face
inférieure presque toujours garnie d'un léger duvet; sa répartition sur la cime
est régulière comme la ramification elle-même.
Les fleurs mâles sont rangées (III, 11) autour d'axes filiformes qui
s'échappent par trois ou quatre d'une rosette de folioles (stipules) et composent
ainsi des groupes de chatons lâches et pendants. Chacune de ces petites fleurs
comprend do cinq h dix anthères divisés en quatre loges et portés par un court
pétiole sur une sorte de calice à cinq ou six sépales soudés par la base (III, lû :
fragment de fleur grossi, calice avec un anthère). Les fleurs femelles sont réunies
par trois ou quatre sur les jeunes rameaux et à l’aisselle des feuilles, c’est-à-dire
à l’angle d'insertion de leur pétiole (III, 11, partie supérieure); vues avec grossissement
(III, 15), elles comprennent dans un calice double ou involucrede couleur
jaunâtre, de petits globules bruns ou rouges (stigmates) destinés à recueillir
le pollen pour lo conduire à l'ovaire situé à l'intérieur de la fleur.
Fleurs à anthères et fleurs à .ovaires, autrement .dit chatons et fleurs
femelles, paraissent dans la seconde quinzaine de mai. Après la fécondation,
l’ovaire se développe et prend la place des stigmates disparus, l'involucre
s'élargit et affecte une forme écailleuse et coriace; les lleurs femelles deviennent
glands'(III, 12).
Une terre fraîche sans être humide, un peu profonde et divisée est celle que-
préfère le Quercus robur. Sablonneuse, graveleuse ou argileuse si elle n'est ni trop
aride, ni trop compacte, ni trop humide, il s'y plaira cl y acquerra dimensions et
qualités. Force, durée, densité telles sont ces qualités précieuses. La densitédu Chêne
rouvre égale presque celle de l'eau, quelquefois elle la dépasse; elle varie ordinairement
des sept aux neuf dixièmes. La membrure et le bordage des navires, la
charpente de nos maisons et de nos édifices sont faites souvent en Rouvre, mais
ce bois excelle surtout pour les ouvrages d'industrie, la fente, la menuiserie, le
merrain, la boissellerie, lo charronnage, l'ébénisterie, etc. Sous une écorce mince,
tendre, peu gercée, d'nne facile exploitation, le Rouvre donne un bois gras excellent
pour le travail ; il a des fibres plus serrées et un tissu plus nerveux sous une
' écorce épaisse et fortement gercée.
Le gland, mis en terre, entr'ouvre, sans les soulever, ses deux moitiés ou
lobes (qui sont les cotylédons) pour livrer passage au germe. Hors de terre,