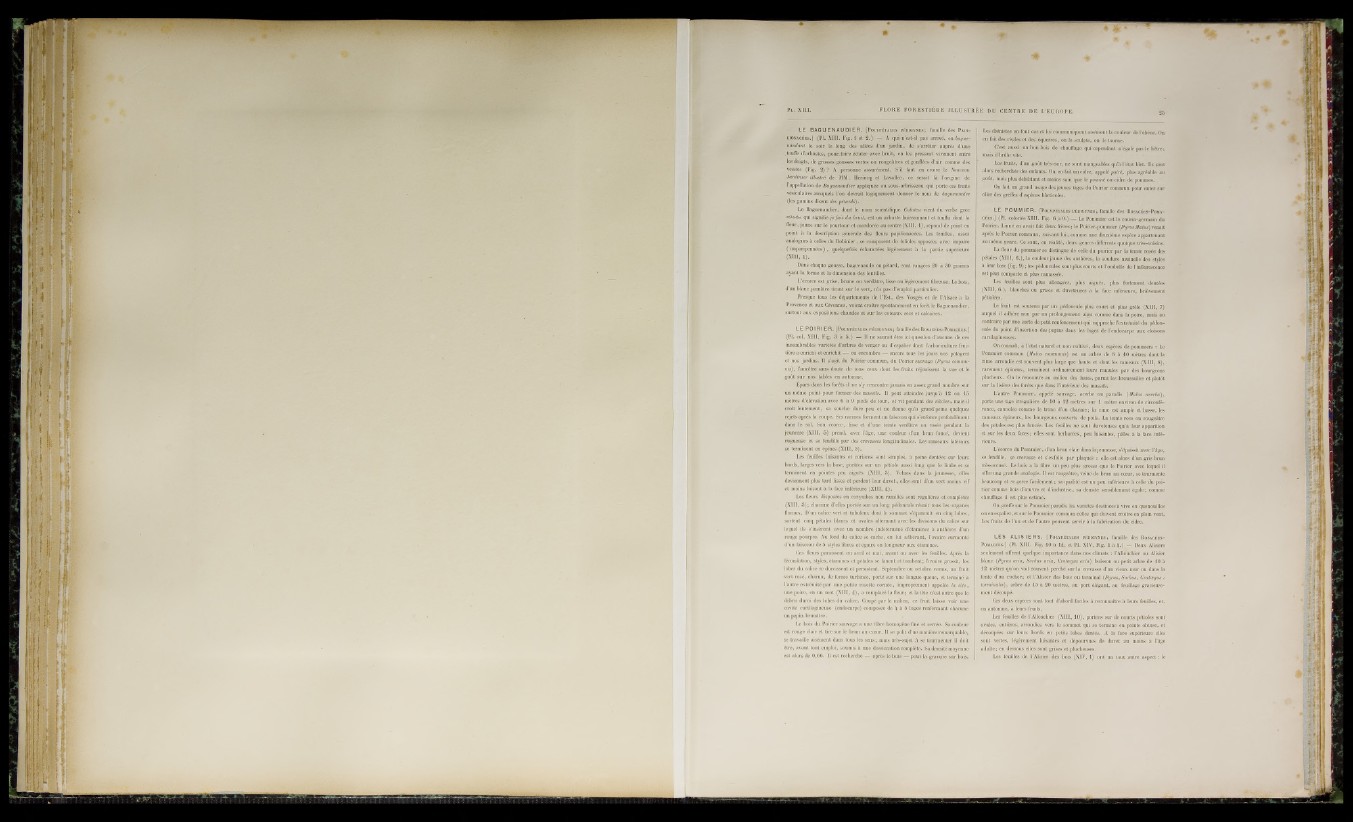
FLORE FORESTIÈRE ILLUSTRÉE DU CENTRE DE L’EUROP
LE BAGUENAU:DIÎER. [PolyfAtalhs pírigynes; famille des Pati-
lionacébs.] (Pl. XIII. Fig. I et 2.) — A qui n'est-il pas arrivé, en baguenaudant
le soir le long des allées d’un jardin, de s'arrêter auprès d'une
.touiTe d'arbustes, pour, faire éclater avec bruit, en les pressant vivement entre
les doigts, de grosses gousses vertes ou rougeâtres et gonflées d’air comme des
vessies (Fig. 2)? A personne assurément. S’il faut en- croire le Nouveau
Jardinier illustré de MM. Herincq et Lavallée, ce serait là l'origine dé
I appellation de Baguenaudier appliquée au sous-arbrisseau qui porte ces fruits
vésiculaires auxquels l’on devrait logiquement donner le nom de baguenaudes
(les gamins disent des pétards).
Le Baguenaudier, dont le nom scientifique Càlutea vient du verbe grec
xo>!«ai. qui signifie je fais du bruit, est un arbuste buissonnanl et touffu dont la
fleur, jaune sur le pourtour et mordorée au centre(XIII, 1), répond de point en
point à la description générale des fleurs papilionacées. Les feuilles, assez
analogues à celles du Robinier, se composent de folioles opposées avec impaire
( imparipennées ) , quelquefois échancrées légèrement à la partie supérieure
(XIII, 1). ' /
Dans chaque gousse, baguenaude ou pétard, sont rangées 20 à 30 graines
ayant la forme et la dimension des lentilles.
L’écorce est grise, bruné ou verdâtre, lisse ou légèrement fibreuse. Le bois,
d’un blanc jaunâtre tirant sur le .vert, n’a pas d’emploi particulier.
Presque tous les départements de l'Est, des Vosgés et de l'Alsace à la
Provence et aux Cévcnnes, voient croître spontanément en forêt le Baguenaudier,
surtout aux expositions chaudes et sur les coteaux secs et calcaires.
LE PO IR IER . [ Poltpéta'Lbs réaiGYNBS; famille des Rosacbbs-Pouacées.]
(Pl. col. XIII. Fig. 3 à 5.) — Il ne saurait être ici question d’aucune de ces
innombrables variétés d'arbres de verger ou d'espalier dont l’arboriculture fruitière
a enrichi et enrichit — ou encombre — encore tous les jours nos potagers
et nos jardins. 11 s'agit du Poirier commun, du Poirier sauvage (Pgrus communie),
l’ancêtre sans doute de tous ceux dont les fruits réjouissent la vue et le
goût sur nos tables en automne.
Epars dans les forêts il ne s'y rencontre jamais en assez grand nombre sur
un même point pour former des massifs. Il peut atteindre jusqu'à 12 ou 15.
mètres d'élévation avec 6 à 9 pieds de tour, et vit pendant des siècles; mais il
croit lentement, sa souche dure peu et
ne donne qu'à grand’peine quelques
rejets après la coupe. Ses racines forment u
n faisceau qui s’enfonce profondément
dans le sol. Son écorce, lisse et d’une
teinte verdâtre ou rosée pendant la
jeunesse (XIII, 5) prend, avec l’âge, un
3 couleur d'un brun foncé, devient
rugueuse et se H H
te fendille par des crevasses longitudinales. Les rameaux latéraux
se terminent en épines (XIII, 5). .
Les feuilles luisantes et coriaces sont simples, à peine dentées sur leurs
bords, larges vers la base, portées sur un pétiole aussi.long que le limbe et se
terminent en pointes peu aiguës (XIII, 3). Velues dans la jeunesse, elles
deviennent plus tard lisses et perdent leur duvet ; elles sont d'un vert moins vif
et moins luisant à la face inférieure (XIII, 4).
Les fleurs disposées en corymbes non ramifiés sont régulières et complètes
(XIII, 3); chacune d'elles portée sur un long pédoncule réunit tous les organes
floraux. D’un calice vert et tubulcux dont le sommet s’épanouit en cinq lobes,
sortent cinq pétales blancs et ovales alternant avec lès divisions du calice sur
lequel ils s'insèrent avec un nombre jndéterminé d’étamines à anthères d’un
rouge pourpre. Au fond du calice se cache, en lui adhérant, l’ovaire surmonté
d'un faisceau de 5 styles libres et égaux en longueur aux étamines.
Ces fleurs paraissent en avril et mai, avant ou avec les feuilles. Après la
fécondation, styles, étamines et pétales se fanent et tombent; l’ovaire grossit, les
lobes du calice se durcissent et persistent. Septembre ou octobre venus, un fruit
vert rosé, charnu, de forme turbinée, porté sur une longue queue, et terminé à
l'autre extrémité par une petite rosette cornée, improprement appelée la téle,
une poire, en un mot (XIII, li), a remplacé la fleur;
débris durci des lobes du calice. Coupé par le milieu,
cavité cartilagineuse (endocarpe) composée de A à 5 I
ges renfermant chacune
un pépin brunâtre.
Le bois du Poirier sauvage a une fibre homogène fine c
est rouge clair et tire sur le brun au coeur. Il se polit d'uem
se travaille aisément dans tous les sens ; mais très-sujet à si
!. Sa couleur
remarquable,
est alors de 0,60. 11 est recherché — après le buis — pour la gravure sur.bois.
Los ébénistes en font cas et lui communiquent aisément la couleur de l'ébène. On
en faitdes règles e t des équerres, on le.sculpte, on le tourne.
C’est aussi un bon bois de chauffage qui cependant n’égale pas le hêtre;
mais il brûle vite.
Les fruits, d’un goût très-sur, no sont mangeables qu’à l’état blet. Ils sont
alors recherchés des enfants. On en fait un cidre, appelé poiré, plus agréable au
goût, mais plus débilitant et moins sain que lé pommé ou cidre de pommes.
On fait un grand usage des jeunes tiges du Poirier commun pour enter sur
elles des greffes d'espèces horticoles.
LE POMMIER. [PoLYpÉTALiis pÉniGYNES; famille des Rosacées-Poua-
cbes.] (PL coloriéeXIII. Fig. Le Pommier est le cousin-germain du
Poirier. Linné en avait fait deux frères ; le Poirier-pommier (Pgrus Malus) venait
après le Poirier, commun, suivant lui, comme une deuxième espèce appartenant
au même genre. Ce sont, en réalité, deux genres différents quoique très-voisins.
La fleur du pommier se distingue de celle du poirier par la teinte rosée des
pétales (XIII, 6.), la couleur jaune des anthères, la soudure mutuelle des styles
à leur base (fig. 9); les pédoncules sont plus courts et l’ombelle de l’inflorescence
est plus compacte et plus ramassée.
Les feuilles sont plus allongées, plus aiguës, plus fortement dentées
(XIII, 6,), blanches ou grises et duveteuses à la face inférieure, brièvement
pétiolées.
Le fruit est soutenu par un pédoncule plus court et plus grêle (XIII, 7)
auquel il adhère non par un prolongement aigu comme dans la poire, mais au
contraire par une sorte do petit rénfoncement qui' rapproche l’extrémité du pédoncule
du point d’insertion des pépins dans les loges de l'endocarpc aux cloisons
cartilagineuses.
On connaît, à l’état naturel et non cultivé, deux espèces de pommiers : Le
Pommier commun (Malus commuais) est un arbre de 8 à 10 mètres dont la
cime arrondie est souvent plus large que haute et dont les rameaux (XIII, 8),
rarement épineux, terminent ordinairement leurs ramules par des bourgeons
plucheux. On le rencontre au milieu des haies, parmi les broussailles et plutôt
sur la lisière des forêts que dans l'intérieur des massifs.
L’autre Pommier, appelé sauvage, acerbe ou paradis (¡Valus acerba),
porte une lige irrégulière de 10 à 12 mètres sur 1 mètre environ de circonférence,
cannelée comme le tronc d’un charme; la cime est ample et basse, les
I rameaux épineux, les bourgeons couverts de poils. La teinte rose ou rougeâtre
des pétales est plus foncée. Les feuilles ne sont duveteuses qu’à leur apparition
et sur les deux faces; elles sont herbacées, peu luisantes, pâles à la face infé-
L'écorce du Pommier, d’un brun clair dans la jeunesse, s’épaissit avec l'âge,
se fendille, se crevasse et s’exfolie par plaques : elle est alors d’un gris brun
très-accusé. Le bois a la fibre un peu plus grosse que le Poirier avec lequel il
offre une grande analogie. Il-est rougeâtre; veiné de brun au coeur, se tourmente
beaucoup et se gerce facilement ; sa qualité est un peu inférieure à celle du poirier
comme bois d’oeuvre et d’industrie, sa densité sensiblement égale ; comme
chauffage il est plus estimé.
On greffe sur le Pommier paradis les variétés destinées à vive en quenouilles
ou en espalier, et sur le Pommier commun celles qui doivent croître en plein vent,
Les fruits de l’un et de l’autre peuvent servir à la fabrication du cidre.
L ES A L IS IE R S . [PoLYPéTALBS périgynes; famille des Rosacbbs-
Pojiacées.] (Pl. XIII. Fig. 10 à 14, et Pl. XIV, Fig. 1 à 4.) — Deux Alisiers
seulement offrent quelque importance dans nos climats : l’Allouchier ou Alisier
blanc (Pgrus aria, Sorbus aria, Cralagus aria) buisson ou petit arbre de 10 à
12 mètres qu’on voit souvent perché sur la crevasse d’un vieux mur ou dans la
fente d'un rocher; et l'Alisier des bois ou torminal (Pgrus, Sorbus, Cralagus :
torminalis), arbre do 15 à 20 mètres, au port élégant, au feuillage gracieusement
découpé.
Ces deux espèces sont tout d’abord faciles à reconnaître à leurs feuilies, et,
I on automne, à leurs fruits.
Les feuilles de l'Allouchier (XIII, 10), portées sur de courts pétioles sont
ovales, entières, arrondies vers le sommet qui se termine en pointe obtuse, et
découpées sur leurs bords en petits lobes dentés. A la face supérieure elles
sont vertes, légèrement luisantes et dépourvues de duvet au moins à l'âge
adulte; en dessous elles sont grises et plucheuses-
Les feuilles de l'Alisier des bois (XIV, 1) ont un tout autre aspect : le