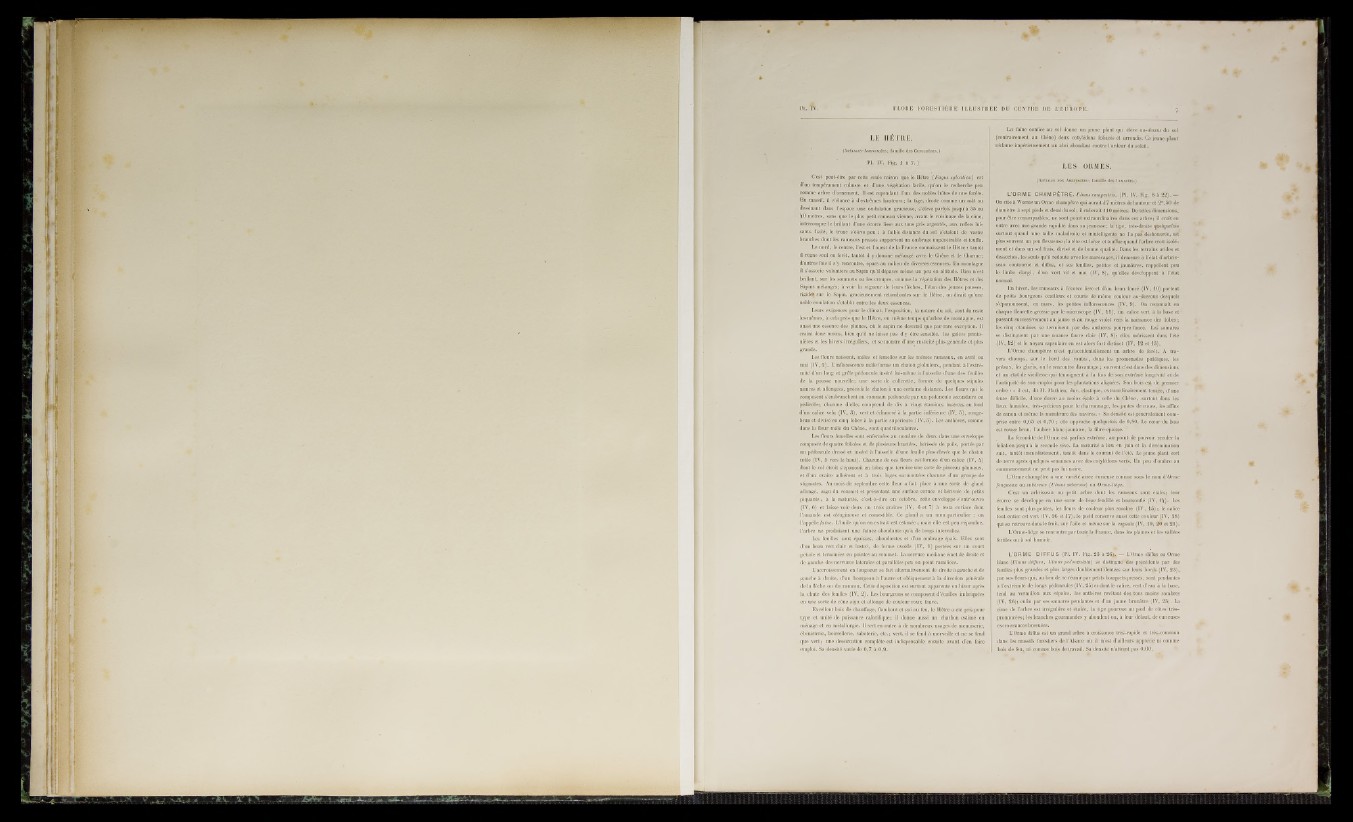
LE HÊTRE.
(AririLis-AuBNTicÉES ; famille des Gopolifèiibs. )
Pl. IV. Fig. 1 à
C'est peut-être par cette seule raison que le Hêtre (Fagus sylvalica) est
d'un tempérament robuste e t. d’un.e végétation facile, qu'on le recherche peu
comme arbre d’ornement. II est cependant l'un des nobles hôtes de nos forêts.
En massif, il s'élance h d'extrêmes hauteurs ; la tige, droite comme un mât ou
dessinant dans l'espace une ondulation gracieuse, s'élève parfois jusqu’à 35 ou
AO mitres, sans que le plus petit rameau vienne, avant le voisinage de la cime,'
interrompre le brillant d'une écorce lisse aux tons gris argentés, aux reflets luisants.
Isolé, le tronc s'élève peu : à faible distance du sol s’étalent de vastes
branches dont les rameaux pressés supportent un ombrage impénétrable et touffu.
Le nord, le centre, l'est et l’ouest de la France connaissent le Hêtre : tantôt
il règne seul en forêt, tantôt il y domine mélangé avec le Chêne et le Charme;
d'autres fois il s’y rencontre, épars au milieu de diverses essences. En montagne ‘
il s’associe volontiers au Sapin qu'il dépasse même un peu en altitude. Rien n’est
brillant, sur les sommets ou les croupes, comme la végétation des Hêtres et des
Sapins mélangés; à voir la vigueur de leurs flèches, l'élan des jeunes pousses,
rigides sur le Sapin, gracieusement retombantes sur le Hêtre, on dirait qu'une
noble émulation s'établit entre les deux essences.
Leurs exigences pour le climat, l’exposition, la nature du sol, sont du reste
les mêmes, à cela près que le Uêtre, en même temps qu'arbre de montagne, est
aussi une essence des plaines, où le sapin ne descend que par rare exception. Il
craint donc moins, bien qu'il ne laisse pas d'y être sensible, les gelées printanières
et les hivers irréguliers, cl se montre d'une rusticité plus générale et plus
.grande.
Les fleurs naissent, mêles et femelles sur les mêmes rameaux, en avril ou
mai (IV, 1). L'inflorescence mêle forme un chaton globuleux, pendant àl'extcé-
. mité d’un long et grêle pédoncule inséré lui-même à l'aisselle d'une des feuilles
de la pousse nouvelle; une sorte de côllerellc, formée de quelques stipules
minces et allongées, précède le chaton à une certaine distance. Les fleurs qui le
composent s’embranchent au commun pédoncule par un pédoncule secondaire ou
pédicelle; chacune d'elles comprend de dix à vingt étamines insérées au fond
d'un calice velu (IV, 3), vert et échancré à la partie inférieure (IV, 5), rouge-
brun et divisé en cinq lobes à la partie supérieure (IV, 3). Les anthères, comme
dans la fleur mêle du Chêne, sont quadriloculaires.
Les fleurs femelles sont enfermées au nombre de deux dans une enveloppe
composée de quatre folioles et do plusieurs bractées, hérisséo do poils, portée par
un pédoncule dressé et inséré à l’aisselle d’une feuille plus élevée que le chaton
mêle (IV, 1 vers le haut). Chacune de ces fleurs est formée d'un calice (IV, A)
dont le col étroit s'épanouit en lobes que termine une sorte de pinceau plumeux,
et d'un ovaire adhérent et à trois loges surmontées chacune d'un groupe de
stigmates. Au mois de septembre cette fleur a fait place à une sorte de gland
allongé, aigu du sommet et présentant une surface cornée et hérissée de petits
piquants ; à la maturité, c'est-à-dire en octobre, cette en veloppe s'enlr’ouvre
(IV, 0) et laisse voir deux ou trois graines (IV, 6 et 7) à testa coriace dont
l'amandê est oléagineuse et comestible. Ce gland a un nom particulier : on
l’appelle fatne. L’huile qu'on en extrait est estimée ; mais elle est peu répandue,
l'arbre ne produisant une fainée abondante qu’à de longs intervalles.
Les feuilles sont épaisses, abondantes et d'un ombrage épais. Elles sont
d'un beau vert clair et lustré, de forme ovoïde (IV, 1) portées sur un court
pétiole et terminées en pointes au sommet. La nervure médiane émet de droite et
de gauche des nervures latérales et parallèles peu ou point ramiflées.
L'accroissement en longueur se fait alternativement de droite à gauche et de
gauche à droite, d’un bourgeon à l’autre et obliquement à la direction générale
de la flèche ou du rameau. Cette disposition est surtout apparente en hiver après
la chute des feuilles (IV, 2). Les bourgeons se composent d'écailles imbriquées
on une sorte de cône aigu et allongé de couleur roux fauve.
Excellent bois de chauffage, flambant et gai au feu, le Hêtre a été pris pour
type et unité de puissance calorifique; il donne aussi un charbon estimé en
ménage et en métallurgie. Il sert en outre à de nombreux usages de menuiserie,
ébénislcrie, boisselleric, saboterie, etc.; vert, il se fend à merveille et ne se fend
que vert ; une dessiccation complète est indispensable ensuite avant d’en faire
emploi. Sa densité varie de 0,7 à 0,9.
La fatne confiée au sol donne un jeune plant qui élève au-dessus du sol
(contrairement au Chêne) deux cotylédons foliacés cl arrondis. Ce jeune plant
réclame impérieusement un abri abondant contre l'ardeur du soleil.
LES ORMES.
(Apétales non Auestacées; famille des Ulmacëes.)
L'O R M E C H AM PÊTRE. Ulmus campeslms. (Pl. IV.. Fig.' 8 à 22). —
On cite à Worms un Orme champêtre qui aurait A 7 mètres de hauteur et 2“,50 de
diamètre à sept pieds cl demi du sol ; il cuberait il 10 mètres. De telles dimensions,
pour être remarquables, ne sont point extraordinaires dans cet arbre; il croît en
outre avec une grande rapidité dans sa jeunesse; la-tige, très-droite quelquefois'
surtout quand une taille maladroite et inintelligente ne l’a pas déshonorée, est
plus souvent un peu flexueusc ; la tête est large et touffue quand l’arbre crotl isolément
cl dans un sol frais, divisé et de bonne qualité.-Dans les terrains arides et
desséchés, les seuls qu'il redoute avec les marécages, il demeure à l'état d'arbrisseau
contourné et diffus, et ses feuilles, petites cl jaunâtres, rappellent peu
le limbe élargi, d'un vert vif et mat (IV, 8), qu’elles développent à l'état
En hiver, les rameaux à l'écorce lisse et d’un brun foncé (IV, 10) portent
de petits bourgeons écailleux et courts de même couleur au-dessous desquels
s’épanouissent, en mars, les petites inflorescences (IV, 9). On reconnaît en
chaque fleurette grossie par le microscope (IV, 11), un calice vert à la base et*
passant successivement au jaune et au rouge violet vers la naissance des lobes ;
les cinq étamines se terminent par des anthères pourpre foncé. Les samares
se distinguent par une nuance fauve clair (IV, 8); elles mûrissent dans l'été
.(IV, 12) cl le noyau capsulairecn est alors fort distinct (IV, 12 et 13).
L’Orme champêtre n'est qu’accidentellement un arbre de forêt. A travers
champs, sur le bord des routes, dans les promenades publiques, les
préaux, les glacis, on le rencontre davantage ; souvent c'est dans des dimensions
et un état de vieillesse qui témoignent à la fois de son extrême longévité et de
l'antiquité de son emploi pour les plantations alignées. Son bois est de premier
ordre: « il est, dit AI. Mathieu, dur, élastique, extraordinairement tenace, d'une
fente difficile, d'une durée au moins égale à celle du, Chêne, surtout dans les
lieux humides, très^précieux pour le charronnage, lestantes de roues, les affûts
de canon et même la membrure des navires. » Sa densité est généralement comprise
entre 0,65 et 0,70; elle approche quelquefois de 0,80. Le coeur du bois
est rouge brun, l'aubier blanc jaunâtre, la Gbre épaisse.
La fécondité de l'Orme est parfois extrême, au point de pouvoir reculer la
foliation jusqu'à la seconde sévo. La maturité a lieu en juin et la dissémination
suit, tantôt immédiatement, tantôt dans le courant de l'été. Le jeune plant sort
de terre après quelques semaines avec des cotylédons verts. Un peu d’ombre au
commencement ne peut pas lui nuire.
L'Orme champêtre a une variété assez curieuse connue sous le nom d’Orme
fongueux ou subéreux (Ulmus suberosà) ou Orme-liige.
C'est un arbrisseau ou petit arbre dont les rameaux sont étalés; leur
écorce se développe en une sorte de liège fendillé et boursouflé (IV, i A). Les
feuilles sont plus petites, les fleurs de couleur plus sombre (IV, 15); le calice
tout entier est vert (IV, 16 et 17); le pistil conserve aussi cette couleur (IV, 18)
qui se retrouve dans le fruit, sur l’aile et même sur la capsule (IV, 19, 20 et 21).
L’Orme-Iiégc se rencontre par toute la France, dans les plaines et les vallées
fertiles ou à sol humide.
L'O R ME 0 IFFU S (Pl. IV. Fig. 23 à 26),. — L’Orme diffus ou Orme
blanc (Ulmus diffusa, Ulmus pedonculala) se distingue ries précédents par des
feuilles plus grandes et plus larges doublementrdentées sur leurs bor(ls (IV, 23),
par ses fleurs qui, au lieu de se réunir par petits bouquets pressés, sont pendantes
à l’extrémité de longs pédoncules (IV, 25) et dont le calice, vert d’eau à la base,
tend au vermillon aux sépales, les anthères revêtant des tons moins sombres
(IY, 26); enfin par ses samares pendantes et d'un jaune brunêlre (IV, 23). La
cime de l'arbre est irrégulière et étalée, la lige pourvue au pied de côtes très-
prononcées; les branches gourmandes y abondent ou, à leur défaut, de curieuses
excroissances bossuées.
L’Orme diffus est un grand arbre à croissance très-rapide et très-commun
dans les massifs forestiers de, l’Alsace où il n'est d’ailleurs apprécié ni comme
bois de feu, ni comme bois do travail. Sa densité n'atteint pas 0,60.