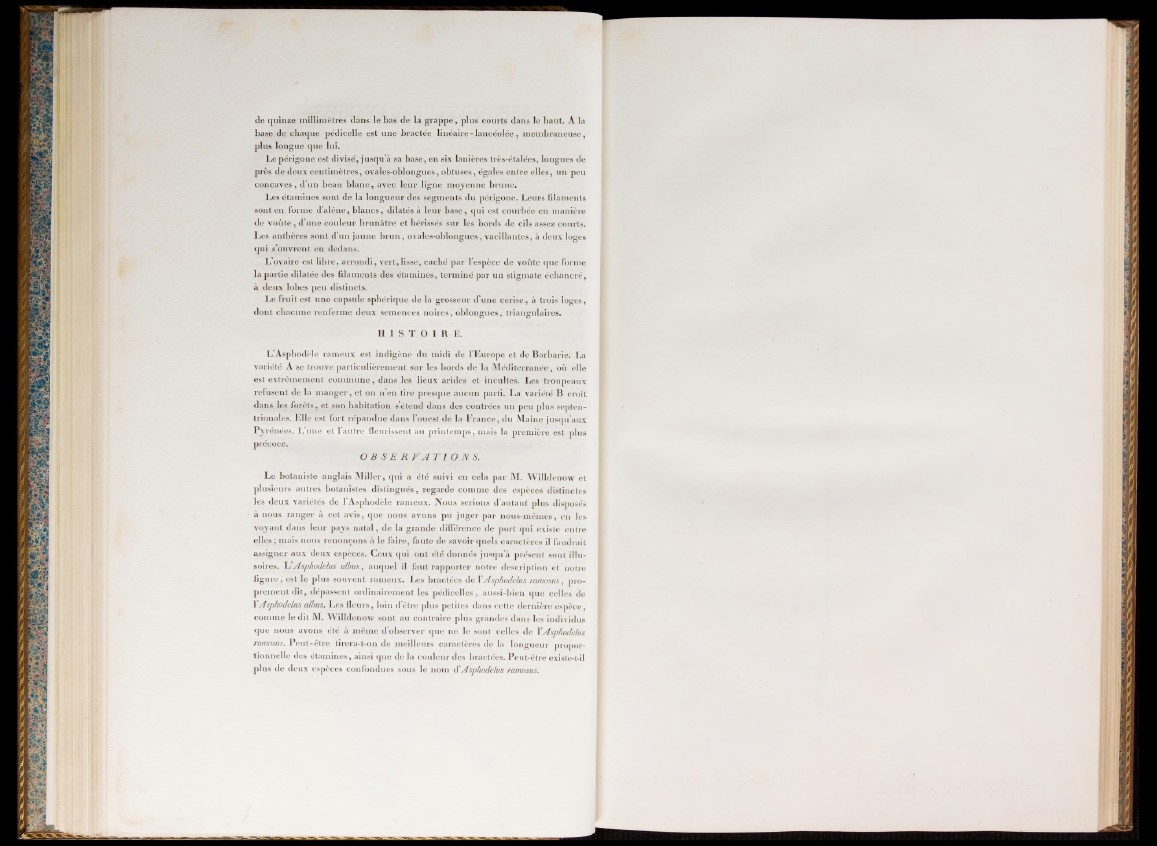
de quinze millimètres dans le bas de la g ra p p e , plus courts dans le haut. A la
base de chaque pédicelle est une bractée linéaire - lan c éo lé e , membraneuse,
plus longue que lui.
Le périgone est divisé, jusqu’à sa base, en six lanières très-étalées, longues de
près de deux centimètres, ovales-oblongues, obtuses, égales entre elles, un peu
con ca v e s , d’un beau b la n c , avec leur ligne moyenne brune.
Les étamines sont de la longueur des segments du périgone. Leurs filaments
sont-en forme d’a lêne , b lan c s , dilatés à leu r b a se , qui est courbée en manière
de v o û te , d’une couleur brunâtre et hérissés sur les bords de cils assez courts.
Les anthères «ont d’un jaune b ru n , ovales-oblongues, v acillantes, à deux loges
qui s’ouvrent en dedans.
L’ ovaire est lib re , a rrondi, v er t,lis se , caché par l ’espèce de voûte que forme
la partie dilatée des filaments des étamines, terminé par un stigmate échancré,
à deux lobes peu distincts.
Le fruit est une capsule sphérique de la grosseur d’une cerise, à trois loges,
dont chacune renferme deux semences noires, ob longues, triangulaires.
H I S T O I R E .
L ’Asphodèle rameux est indigène du midi de l ’Europe et de Barbarie. La
variété A se trouve particulièrement sur les bords de la M éditerran ée, où elle
est extrêmement com m u n e , dans les lieux arides et incultes. Les troupeaux
refusent de la m an g e r , et on n’en tire presque aucun parti. L a variété B croît
dans les forêts, et son habitation s’étend dans des contrées un peu plus septentrionales.
E lle est fort répandue dans l’ouest de la F ra n c e , du Maine jusqu’aux
Pyrénées. L ’une et l ’autre fleurissent au printemps, mais la première est plus
précoce.
O B S E R V A T I O N S .
L e botaniste anglais M ille r , qui a été suivi en cela par M. W ïlld en ow et
plusieurs autres botanistes distingués, regarde comme des espèces distinctes
les deux variétés de l ’A sphodèle rameux. Nous serions d’autant plus disposés
à nous ranger à cet a v is, que nous avons p u ju g e r par nous-mêmes, en les
vo yan t dans leu r pays n a ta l, de la grande différence de port qui existe entre
elles ; mais nous renonçons à le faire, faute de savoir quels caractères il faudrait
assigner aux deux espèces. C eu x qui ont été donnés jusqu’à présent sont illu soires.
L 'Asphodelus albus, auquel il faut rapporter notre description et notre
fig u r e , est le plus souvent rameux. Les bractées de 1 Asphodelus ramosus, proprement
dit, dépassent ordinairement les p éd ice lle s, aussi-bien que celles de
Y Asphodelus albus. Les fleurs , loin d’être plus petites dans cette dernière espèce,
comme le dit M . W illd en ow sont au contraire plus grandes dans les individus
que nous avons été à même d’observer que ne le sont celles de Y Asphodelus
ramosus. P eu t-ê tre tirera-t-on de meilleurs caractères de la longueur proportionnelle
des étamines, ainsi que de la couleur des bractées. Peut-être existe-t-il
plus de deux espèces confondues sous le nom d’Asphodelus ramosus.