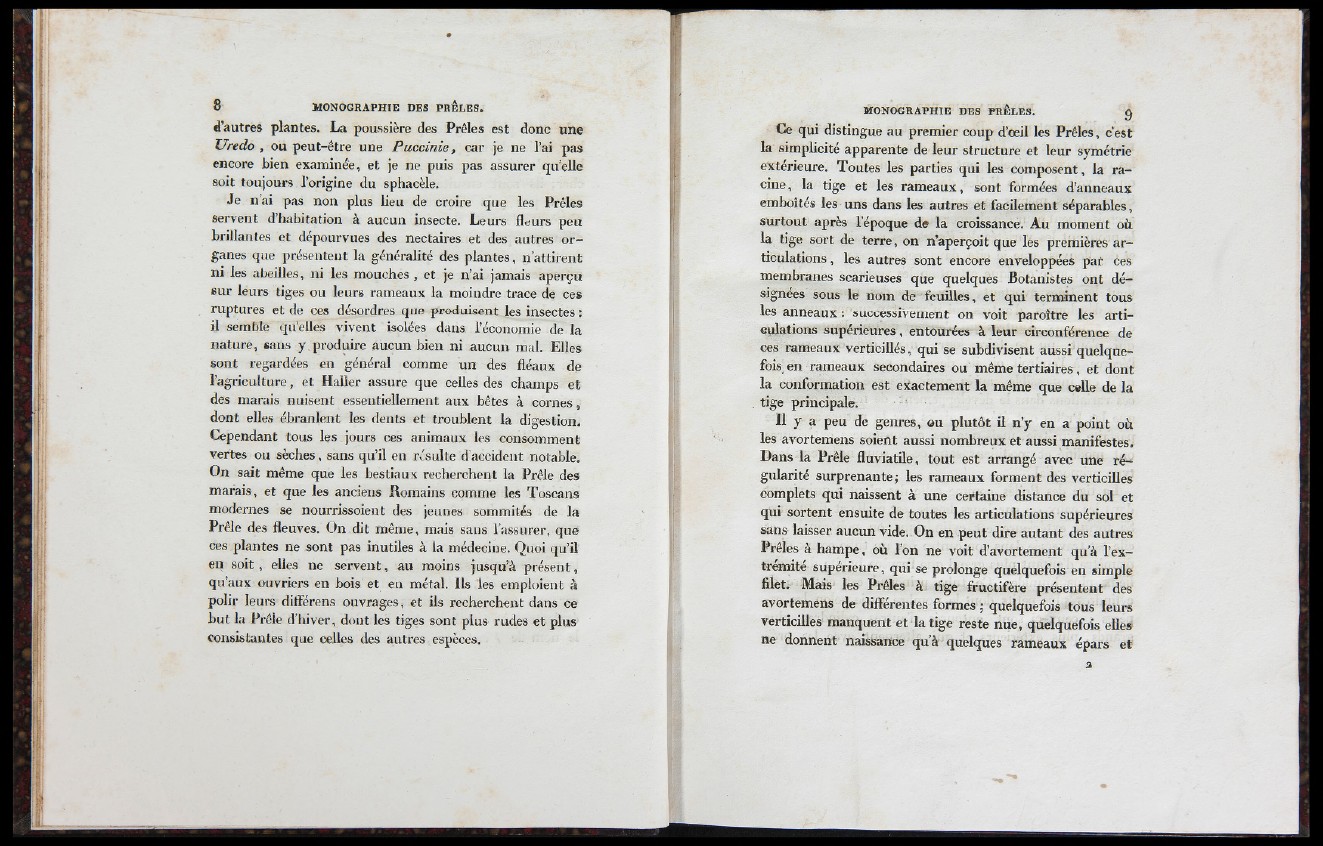
d’autres plantes. La poussière des Prêles est donc une
Uredo , ou peut-être une Puccinie, car je ne l’ai pas
encore bien examinée, et je ne puis pas assurer quelle
soit toujours l’origine du sphacèle.
Je n’ai pas non plus lieu de croire que les Prêles
servent d’habitation à aucun insecte. Leurs fleurs peu
brillantes et dépourvues des nectaires et des autres organes
que présentent la généralité des plantes, n’attirent
ni les abeilles, ni les mouches, et je n’ai jamais aperçu
sur leurs tiges ou leurs rameaux la moindre toce de ces
ruptures et de ces désordres q u e p r o d u i s e n t les insectes :
il semble qu’elles vivent isolées dans l’économie de la
nature, sans y produire aucun bien ni aucun mal. Elles
sont regardées en général comme un des fléaux de
l’agriculture, et HaÜer assure que celles des champs et
des marais nuisent essentiellement aux bêtes à cornes,
dont elles ébranlent les dents et troublent la digestion.
Cependant tous les jours ces animaux les consomment
vertes ou sèches, sans qu’il en résulte d'accident notable.
On sait même que les bestiaux recherchent la Prêle des
marais, et que les anciens Romains comme les Toscans
modernes se nourrissoient des jeunes sommités de la
Prêle des fleuves. On dit même, mais sans l’assurer, que
ces plantes ne sont pas inutiles à la médecine. Quoi qu’il
en soit , elles ne servent, au moins jusqu’à présent,
qu’aux ouvriers en bois et eu métal. Ils les emploient à
polir leurs différens ouvrages, et ils recherchent dans ce
but la Prêle d’hiver, dont les tiges sont plus rudes et plus
consistantes que celles des autres espèces.
Ce qui distingue au premier coup d’oeil les Prêles, c'est
la simpbcité apparente de leur structure et leur symétrie
extérieure. Toutes les parties qui les composent, la racine,
la tige et les rameaux, sont formées d’anneaux
emboîtés les uns dans les autres et facilement séparables,
surtout après l’époque de la croissance. Au moment où.
la tige sort de terre, on n’aperçoit que les premières articulations
, les autres sont encore enveloppées pat ces
membranes scarieuses que quelques Botanistes ont désignées
sous le nom de feuilles, et qui terminent tous
les anneaux : successivement on voit paroître les articulations
supérieures, entourées à leur circonférence de
ces rameaux verticillés, qui se subdivisent aussi quelquefois
en rameaux secondaires ou même tertiaires, et dont
la conformation est exactement la même que celle de la
, tige principale.
Il y a peu de genres, ou plutôt il n’y en a point où
les avortemens soient aussi nombreux et aussi manifestes.
Dans la Prêle fluviatile, tout est arrangé avec une régularité
surprenante; les rameaux forment des verticilles
complets qui naissent à une certaine distance du sol et
qui sortent ensuite de toutes les articulations supérieures
sans laisser aucun vide. On en peut dire autant des autres
Prêles à hampe, où l’on ne voit d’avortement qu’à l’ex-
tremité supérieure, qui se prolonge quelquefois en simple
filet. Mais les Prêles à tige fructifère présentent des
avortemens de différentes formes ; quelquefois tous leurs
verticilles manquent et la tige reste nue, quelquefois elles
ne donnent naissance qu’à quelques rameaux épars et