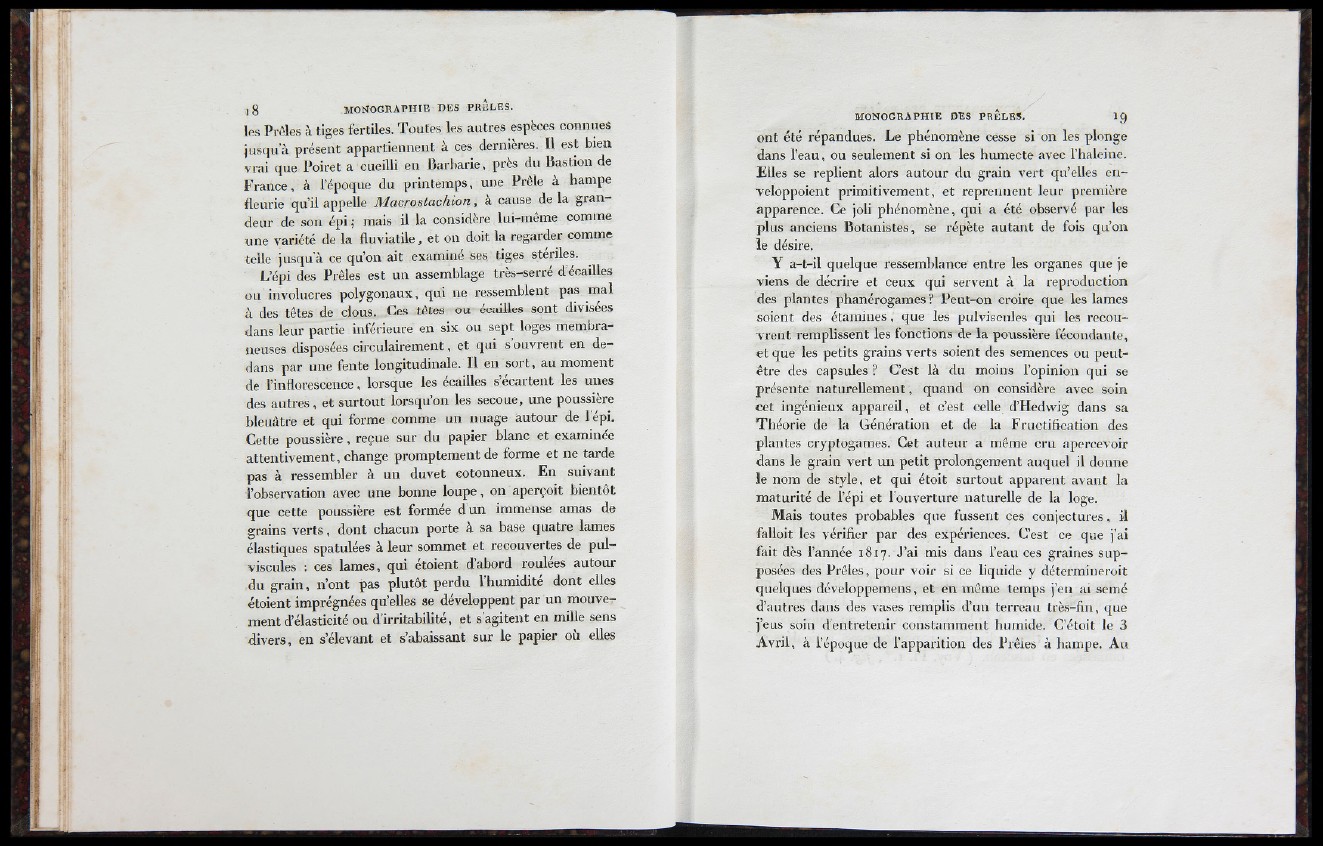
h ï
les Prêles à tiges fertiles. Toutes les autres espèces connues
jusqu’à présent appartiennent à ces dernières. Il est bien
vrai que Poiret a cueilli en Barbarie, près du Bastion de
France, à l’époque du printemps, une Prêle à hampe
fleurie qu’il appelle Macroatachion, à cause de la grandeur
de son épi ; mais il la considère lui-même comme
une variété de la fluviatile, et on doit la regarder comme
telle jusqu'à ce qu’on ait examiné ses tiges stériles.
L ’épi des Prêles est un assemblage très-serré d'écailles
ou involucres polygonaux, qui ne ressemblent pas mal
à des têtes de clous. Ces têtes ou écailles sont divisées
dans leur partie inférieure en six ou sept loges membraneuses
disposées circulairement, et qui s’ouvrent en dedans
par une fente longitudinale. Il en sort, au moment
de l’inflorescence, lorsque les écaUles s’écartent les unes
des autres, et surtout lorsqu’on les secoue, une poussière
bleuâtre et qui forme comme un nuage autour de l’épi.
Cette poussière, reçue sur du papier blanc et examinée
attentivement, change promptement de forme et ne tarde
pas à ressembler à un duvet cotonneux. En suivant
l’observation avec une bonne loupe, on aperçoit bientôt
que cette poussière est formée d un immense amas de
grains verts, dont chacun porte à sa base quatre lames
élastiques spatulées à leur sommet et recouvertes de pul-
viscules ; ces lames, qui étoient d’abord roulées autour
du grain, n’ont pas plutôt perdu l’humidité dont elles
étoient imprégnées qu’elles se développent par un mouvement
d’élasticité ou d’irritabiUté, et s'agitent en mille sens
divers, en s’élevant et s’abaissant sur le papier où elles
m o n o g r a p h i e d e s p r e l e s . 1 9
ont été répandues. Le phénomène cesse si on les plonge
dans l’eau, ou seulement si on les humecte avec l’haleine.
Elles se replient alors autour du grain vert qu’elles en-
veloppoient primitivement, et reprennent leur première
apparence. Ce joli phénomène, qui a été observé par les
plus anciens Botanistes, se répète autant de fois qu’on
le désire.
Y a-t-il quelque ressemblance entre les organes que je
viens de décrire et ceux qui servent à la reproduction
des plantes phanérogames ? Peut-on croire que les lames
soient des étamines , que les pulviscules qui les recouvrent
remplissent les fonctions de la poussière fécondante,
et que les petits grains verts soient des semences ou peut-
être des capsules ? C’est là du moins l’opinion qui se
présente naturellement, quand on considère avec soin
cet ingénieux appareil, et c’est celle d’Hedwig dans sa
Tliéorie de la Génération et de la Fructification des
plantes cryptogames. Cet auteur a même cru apercevoir
dans le grain vert un petit prolongement auquel il donne
le nom de style, et qui étoit surtout apparent avant la
maturité de l’épi et l’ouverture naturelle de la loge.
Mais toutes probables que fussent ces conjectures, il
falloit les vérifier par des expériences. C’est ce que j’ai
fait dès l’année 1817. J ’ai mis dans l’eau ces graines supposées
des Prêles, pour voir si ce liquide y détermiueroit
quelques développemens, et en même temps j’en ai semé
d’autres dans des vases remplis d’un terreau très-fin, que
j’eus soin dentretenir constamment humide. C’étoit le 3
Avril, à l’époque de l’apparition des Prêles à hampe. Au