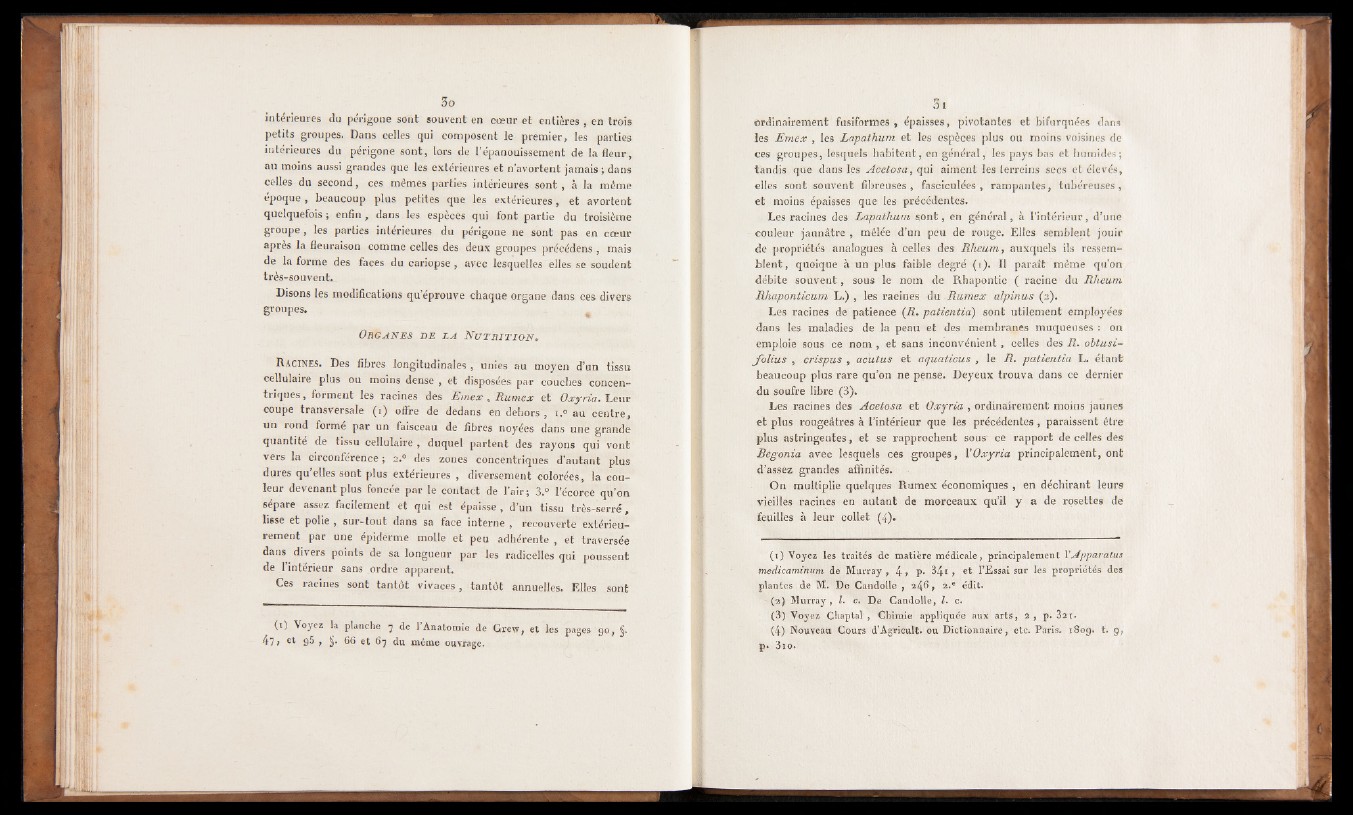
intérieures du périgone sont souvent en coeur et entières , en trois
petits groupes. Dans celles qui composent le premier, les parties
intérieures du périgone sont, lors de l ’épanouissement de la fleur,
au moins aussi grandes que les extérieures et n’avortent jamais ; dans
celles du second, ces mêmes parties intérieures sont , à la même
époque, beaucoup plus petites que les extérieures, et avortent
quelquefois ; enfin , dans les espèces qui font partie du troisième
groupe, les parties intérieures du périgone ne sont pas en coeur
apres la fleuraison comme celles des deux groupes précédens , mais
de la forme des faces du cariopse , avec lesquelles elles se soudent
très-souvent.
Disons les modifications qu’éprouve chaque organe dans ces divers
groupes.
Or g an e s d e l a N u t r it io n ,
Racines. Des fibres longitudinales , unies au moyen d’un tissu
cellulaire plus ou moins dense , et disposées par couches concentriques
, forment les racines des Emex , Iturnex et Oxyria. Leur
coupe transversale (i) offre de dedans en dehors , i.° au centre,
un rond forme par un faisceau de fibres noyées dans une grande
quantité de tissu cellulaire, duquel partent des rayons qui vont
vers la circonférence ; 2.0 des zones concentriques d’autant plus
dures qu elles sont plus extérieures , diversement colorées, la couleur
devenant plus foncée par le contact de l’air; 3.° l’écorcé qu’on
sépare assez facilement et qui est épaisse , d’un tissu très-serré,
lisse et polie , sur-tout dans sa face interne , recouverte extérieurement
par une épiderme molle et peu adhérente , et traversée
dans divers points de sa longueur par les radicelles qui poussent
de l’intérieur sans ordre apparent.
Ces racines sont tantôt vivaces, tantôt annuelles. Elles sont
(x) Voyez la planche 7 de l’Anatomie de Grew, et les pages 90, §.
47 > et 95 , §. 66 et 67 du même ouvrage.
ordinairement fusiformes, épaisses, pivotantes et bifurquées dans
les Emex , les Lapathum et les espèces plus ou moins voisines de
ces groupes, lesquels habitent, en général, les pays bas et humides;
tandis que dans les Acetosa, qui aiment les lerreins secs et élevés,
elles sont souvent fibreuses, fasciculées , rampantes, tubéreuses,
et moins épaisses que les précédentes.
Les racines des Lapathum. sont, en général, à l’intérieur, d’une
couleur jaunâtre , mêlée d’un peu de rouge. Elles semblent jouir
de propriétés analogues à celles des Rheum, auxquels ils ressemblent,
quoique à un plus faible degré (1). Il paraît même qu’on
débite souvent, sous le nom de Rhapontic ( racine du Rheum
Rhaponticum L.) , les racines du Rumex alpinus (2).
Les racines de patience (R. patientia') sont utilement employées
dans les maladies de la peau et des membranes muqueuses : on
emploie sous ce nom , et sans inconvénient, celles des R. obtusi-
jfolius , crispus , acutus et aquaticus , le R. patientia L. étant
beaucoup plus rare qu’on ne pense. Deyeux trouva dans ce dernier
du soufre libre (3).
Les racines des Acetosa et Oxyria , ordinairement moins jaunes
et plus rougeâtres à l’intérieur que les précédentes , paraissent être
plus astringentes, et se rapprochent sous ce rapport de celles des
Bégonia avec lesquels ces groupes, l’Oxyria principalement, ont
d’assez grandes affinités.
On multiplie quelques Rumex économiques , en déchirant leurs
vieilles racines en autant de morceaux qu’il y a de rosettes de
feuilles à leur collet (4).
(1) Voyez les traités de matière médicale, principalement Y Apparatus
medicaminum de Murray , 4 , p* 3 | 1 , et l’Essai sur les propriétés des
plantes . de M. De Candolle , 246, 1 2 3 4*e édit.
'(2) Murray, Z. c. De Candolle, Z. c.
(3) Voyez Chaptal', Chimie appliquée aux arts, 2, p. 321.
(4) Nouveau Cours d’Agricult. ou Dictionnaire, etc. Paris. 1809. t. 9,
p. 3to.