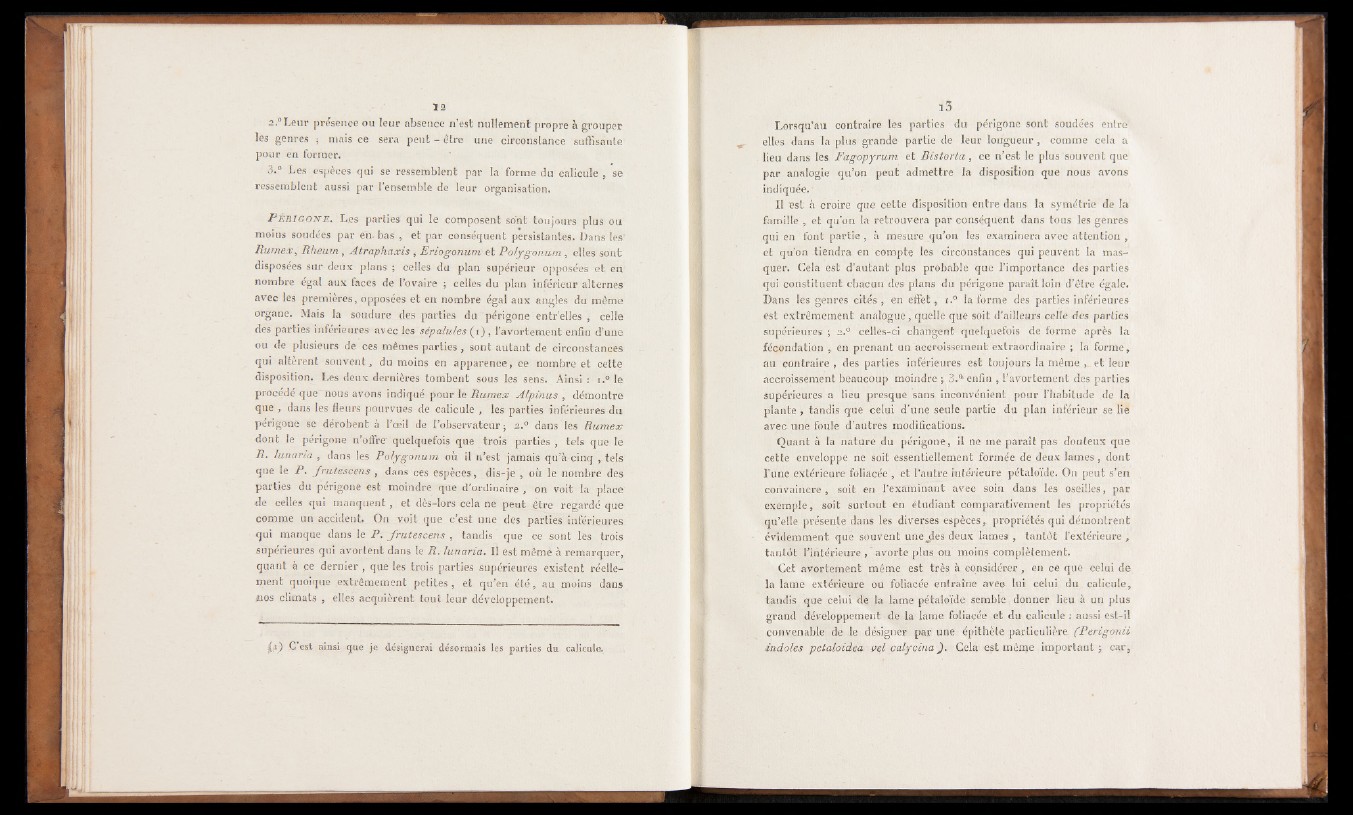
a.0Leur présence ou leur absence n’est nullement propre à grouper
les genres ; mais ce sera peut - être une circonstance suffisante
pour en former.
3.° Les espèces qui se ressemblent par la forme du calicule , se
ressemblent aussi par l’ensemble de leur organisation.
P é r ig on e . Les parties qui le composent sont toujours plus ou
moins soudées par en. bas , et par conséquent persistantes. Dans les1
Rumex, Rheum , Atraphaxis , Eriogonum et Polygonum , elles sont
disposées sur deux plans ; celles du plan supérieur opposées et en
nombre égal aux faces de l’ovaire ; celles du plan inférieur alternes
avec les premières, opposées et en nombre égal aux angles du même
organe. Mais la soudure des parties du périgone entr’elles , celle
des parties inférieures avec les sépalules (i) , l’avortement enfin d’une
ou de plusieurs de ces mêmes parties , sont autant de circonstances
qui altèrent souvent, du moins en apparence, ce nombre et cette
disposition. Les deux dernières tombent sous les sens. Ainsi: i.° le
procédé que nous avons indiqué pour le Rumex Alpinus , démontre
que , dans les fleurs pourvues de calicule , les parties inférieures du
périgone se dérobent à l’oeil de l’observateur ; a.0 dans les Rumex
dont le périgone n’offre- quelquefois que trois parties , tels que le
R. lunaria , dans les Polygonum où il n’est jamais qu’à cinq , tels
que le P. jrutescens , d a n s ces espèces, dis-je , où le nombre des
parties du périgone est moindre que d'ordinaire | on voit la place
de celles qui manquent , et dès-lors cela ne peut être regardé que
comme un accident. On voit que c’est une des parties inférieures
qui manque dans le P . frutescens , tandis que ce sont les trois
supérieures qui ayortent dans le R. lunaria. Il est même à remarquer,
quant à ce dernier , que les trois parties supérieures existent réellement
quoique extrêmement petites , et qu’en été, au moins dans
nos climats , elles acquièrent tout leur développement.
;( 0 C’est ainsi que je désignerai désormais les parties du calicule.
Lorsqu’au contraire les parties du périgone sont soudées entre
elles dans la plus grande partie de leur longueur , comme cela a
lieu dans les Fagopyrum et Ristorta , ce n’est le plus souvent que
par analogie qu’on peut admettre la disposition que nous avons
indiquée.'
Il est à croire que cette disposition entre dans la symétrie de la
famille , et qu’on la retrouvera par conséquent dans tous les genres
qui en font partie , à mesure qu’on les examinera avec attention ,
et qu’on tiendra en compte les circonstances qui peuvent la masquer.
Cela est d’autant plus probable que l’importance des parties
qui constituent chacun des plans du périgone paraît loin d’ôtre égale.
Dans les genres cités, en effet, i.° la forme des parties inférieures
est extrêmement analogue, quelle que soit d’ailleurs celle des parties
supérieures ; 3.° celles-ci changent quelquefois de forme après la
fécondation , en prenant un accroissement extraordinaire ; la forme,
au contraire , des parties inférieures est toujours la même ,_ et leur
accroissement beaucoup moindre ; 3.q enfin , l’avortement des parties
supérieures a lieu presque sans inconvénient pour l’habitude de la
plante , tandis que celui d’une seule partie du plan inférieur se lie
avec une foule d’autres modifications.
Quant à la nature du périgone, il ne me paraît pas douteux que
cette enveloppe ne soit essentiellement formée de deux lames , dont
l’ une extérieure foliacée , et l’autre intérieure pétaloïde. On peut s’en
convaincre, soit en l’examinant avec soin dans les oseilles, par
exemple, soit surtout en étudiant comparativement les propriétés
qu’elle présente dans les diverses espèces,, propriétés qui démontrent
évidemment que souvent une^des deux lames , tantôt l’extérieure ,
tantôt l’intérieure , avorte plus ou moins complètement.
Cet avortement même est très à considérer , en ce que celui de
la lame extérieure ou foliacée entraîne aveo lui celui du calicule,
tandis que celui de la lame pétaloïde semble donner lieu à un plus
grand développement de la lame foliacée et du calicule : aussi est-il
convenable de le désigner par une épithète particulière (Perigonii
indoles petaloidea çel calycina Cela est même important ; car.