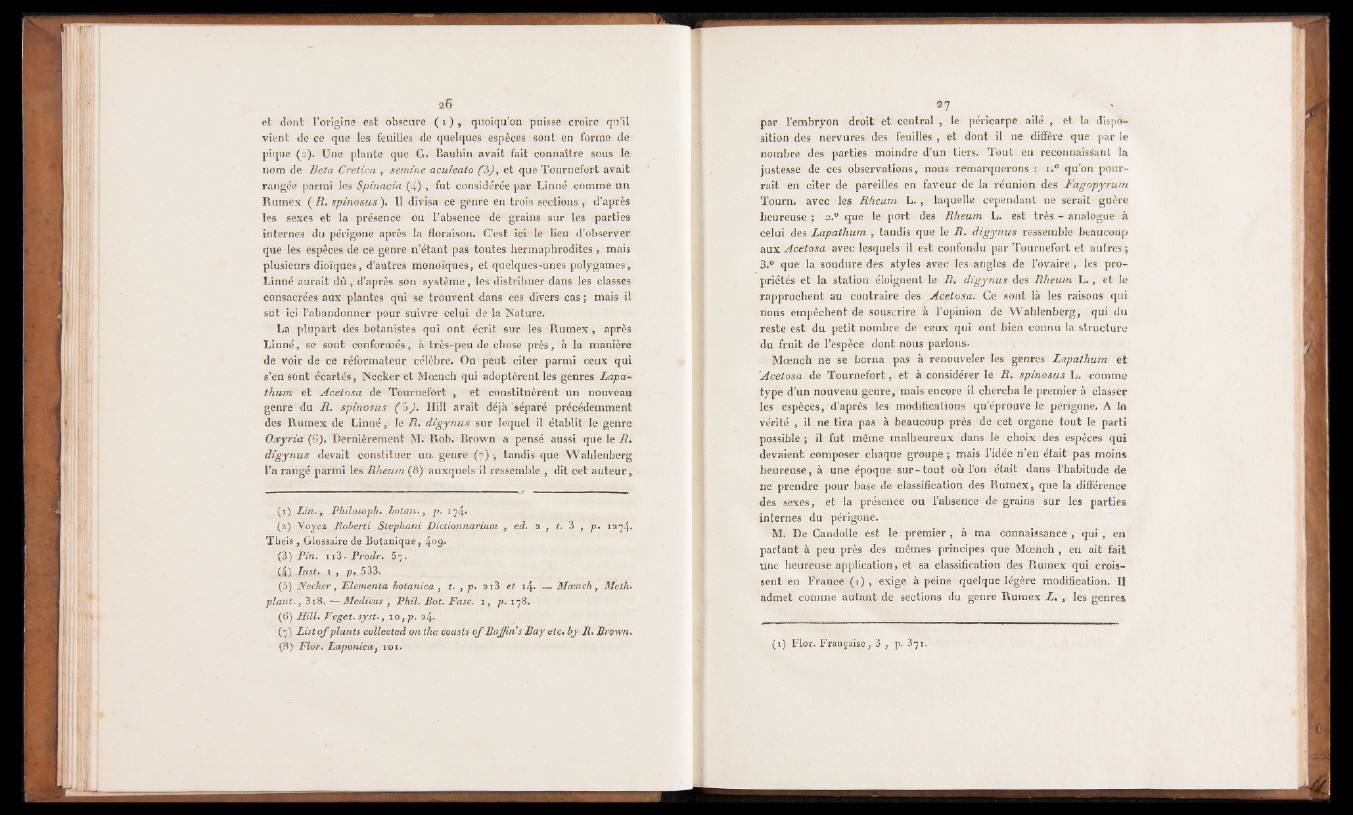
et dont l ’origine est obscure ( x ) , quoiqu’on puisse croire qu’il
vient de ce que les feuilles de quelques espèces sont en forme de
pique (2). Une plante que G. Bauhin avait fait connaître sous le
nom de B et a Cretica , semine aculeato ( i ) , et que Tournefort avait
rangée parmi les Spinacia (4) , fut considérée par Linné comme un
Rumex ( R. spinosus ). Il divisa ce genre en trois sections , d’après
les sexes et la présence ou l ’absence de grains sur les parties
internes du périgone après la floraison. C’est ici le lieu d’observer
que les espèces de ce genre n’étant pas toutes hermaphrodites , mais
plusieurs dioïques, d’autres monoïques, et quelques-unes polygames,
Linné aurait d û , d’après son système, lesdistribuer dans les classes
consacrées aux plantes qui se trouvent dans ces divers cas; mais il
sut ici l’abandonner pour suivre celui de la Nature.
La plupart des botanistes qui ont écrit sur les Rumex , après
Linné, se sont conformés, à très-peu de chose près, à la manière
de voir de ce réformateur célèbre. On peut citer parmi ceux qui
s’en sont écartés, Necker et Moench qui adoptèrent les genres Lapa-
thurn et Acetosa de Tournefort , et constituèrent un nouveau
genre du R. spinosus ( 5) . Hill avait déjà "séparé précédemment
des Rumex de Linné, le R. digynus sur lequel il établit le genre
Oxyria (6). Dernièrement M. Rob. Brown a pensé aussi que le R.
digynus devait constituer un. genre (7) -, tandis que Wahlenberg
l ’a rangé parmi les Rheum (8) auxquels il ressemble , dit cet auteur,
(1) Lin., Philosoph, botan. , p. 1 -.j.
(2) Voyez Roberti Stephani Dictionnarium , ed. 2 , t. 3 , p. 1274*
Theis , Giossaire de Botanique, 4°9>
(3) Pin. 113. Prodr. Sy,
(4) Inst. 1 , p, 533.
(5) Necker, Elementa botanica , t. , p. 2t3 et 14. — Moench, Meth.
plant., 318. — Medicus , Phil. Bot. Fase. 1, p. 178.
(6) Hill. Feget, syst., 10, p. 24.
(7) List o f plants collected on the coasts of Baffin's Bay etc. by R. Brown.
(8) ' Flor. Laponiea, ioipar
l’embryon droit et central , le péricarpe ailé , et la disposition
des nervures des feuilles , et dont il ne diffère que par le
nombre des parties moindre d’un tiers. Tout en reconnaissant la
justesse de ces observations, nous remarquerons : i.° qu’on pourrait
en citer de pareilles en faveur de la réunion des Fagopyrum
Tourn. avec les Rheum L . , laquelle cependant ne serait guère
heureuse ; 2.0 que le port des Rheum L. est très - analogue à
celui des Lapathum , tandis que le R. digynus ressemble beaucoup
aux Acetosa avec lesquels il est confondu par Tournefort et autres ;
3.° que la soudure des styles avec les angles de l’ovaire , les propriétés
et la station éloignent le R. digynus des Rheum L . , et le
rapprochent au contraire des Acetosa. Ce sont là les raisons qui
nous empêchent de souscrire à l’opinion de Wahlenberg, qui du
reste est du petit nombre de ceux qui ont bien connu la structure
du fruit de l’espèce dont nous parlons.
Moench ne se borna pas à renouveler les genres Lapathum et
Acetosa de Tournefort, et à considérer le R. spinosus L. comme
type d’un nouveau genre, mais encore il chercha le premier à classer
les espèces, d’après les modifications qu’éprouve le périgone. A la
vérité , il ne tira pas à beaucoup près de cet organe tout le parti
possible ; il fut même malheureux dans le choix des espèces qui
devaient composer chaque groupe ; mais l’idée n’en était pas moins
heureuse, à une époque sur-tout où l’on était dans l’habitude de
ne prendre pour base de classification des Rumex, que la différence
des sexes, et la présence ou l’absence de grains sur les parties
internes du périgone.
M. De Candolle est le premier , à ma connaissance , qui , en
partant à peu près des mêmes principes que Moench , en ait fait
une heureuse application, et sa classification des Rumex qui croissent
en France (1) , exige à peine quelque légère modification. Il
admet comme autant de sections du genre Rumex L. , les genres 1
(1) Flor. Française, 3 , p. 37t.