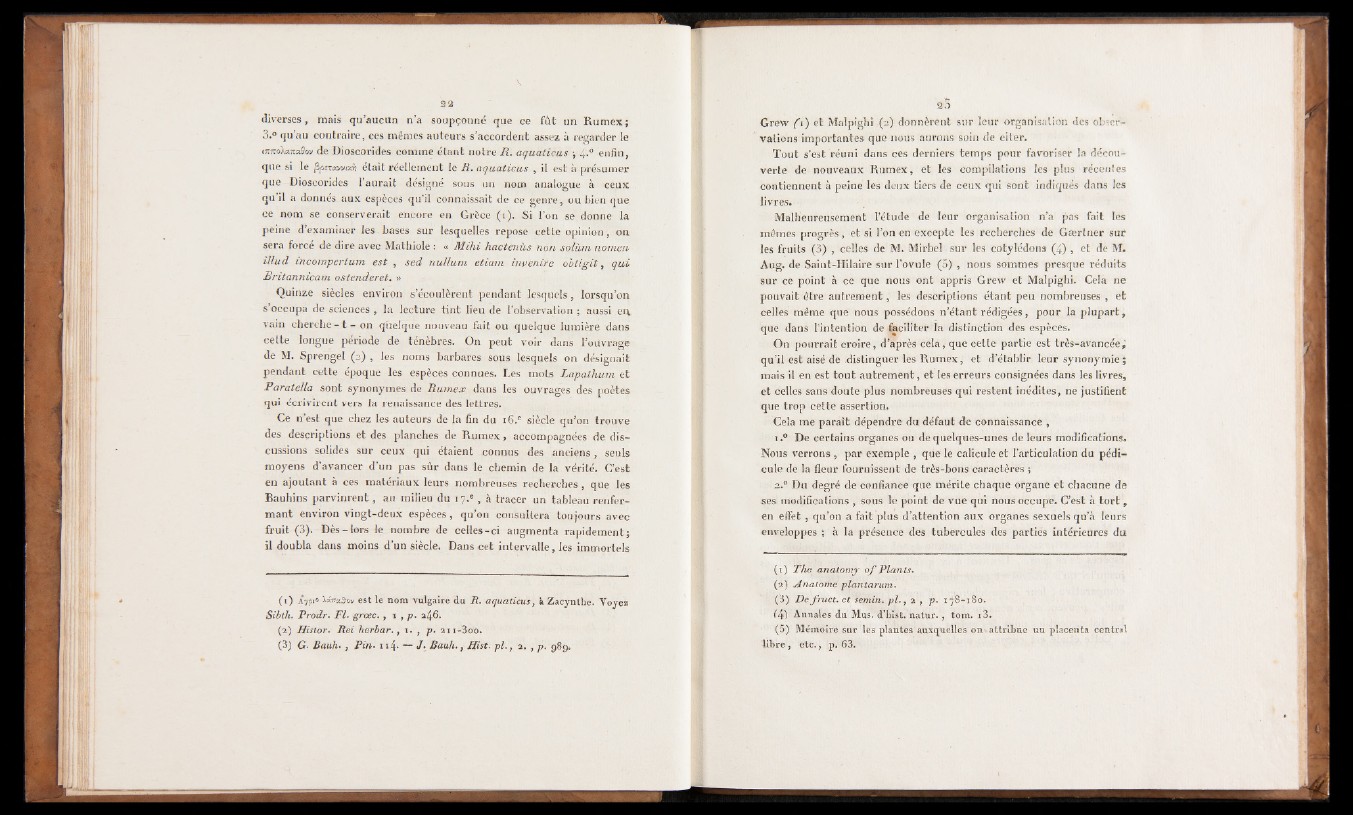
diverses, mais qu’aucun n’a soupçonné que ce fût un Rumex;
3.° qu’au contraire, ces mêmes auteurs s’accordent assez à regarder le
mnoXccKxdov de Dioscorides comme étant notre R. aquaticus ; 4-° enfin,
que si le ppszcawixii était réellement le R. aquaticus , il est à présumer
que Dioscorides l’aurait désigné sous un nom analogue à ceux
qu’il a donnés aux espèces qu’il connaissait de ce genre, ou bien que
ce nom se conserverait encore en Grèce (i). Si l’on se donne la
peine d’examiner les bases sur lesquelles repose cette opinion, on
sera force de dire avec Mathiole : « Mihi hactenùs non soliim nomen
illud incompertum est , sed nullum etiam inpenire obtigit, qui
Britannicam ostenderet. »
Quinze siècles environ s’écoulèrent pendant lesquels , lorsqu’on
s’occupa de sciences , la lecture tint lieu de l’observation ; aussi en
vain cherche - 1 - on quelque nouveau fait ou quelque lumière dans
cette longue période de ténèbres. On peut voir dans l’odvrage
de M. Sprengel (a) , les noms barbares sous lesquels on désignait
pendant cette époque les espèces connues. Les mots Lapathum et
Paratella sont synonymes de Rumex dans les ouvrages des poètes
qui écrivirent vers la renaissance des lettres.
Ce n’est que chez les auteurs de la fin du i6.° siècle qu’on trouve
des descriptions et des planches de Rumex, accompagnées de discussions
solides sur ceux qui étaient connus des anciens , seuls
moyens d’avancer d’un pas sûr dans le chemin de la vérité. C’est
en ajoutant à ces matériaux leurs nombreuses recherches , que les
Bauhins parvinrent, au milieu du 17. ' , à tracer un tableau renfermant
environ vingt-deux espèces, qu’on consultera toujours avec
fruit (3). Dès-lors le nombre de celles-ci augmenta rapidement;
il doubla dans moins d’un siècle. Dans cet intervalle, les immortels
* (1) Â7S10 MjraSov est lé nom vulgaire du R. aquaticus, à Zacynthe. Voyez
Sibth. Prodr. Fl. groec. , 1 , p. 246.
(2) Histor. Rei herbar. , 1. , p. 211-800.
(3) G- Bauh■ , Pin. n 4- — J- Bauh. , ffist. pl.t 2. , p. 989.
Grew f i ) et Malpighi (2) donnèrent sur leur organisation des observations
importantes que nous aurons soin de citer.
Tout s’est réuni dans ces derniers temps pour favoriser la découverte
de nouveaux Rumex, et les compilations les plus récentes
contiennent à peine les deux tiers de ceux qui sont indiqués dans les
livres.
Malheureusement l’étude de leur organisation n’a pas fait les
mêmes progrès, et si l’on en excepte les recherches de Gærlner sur
les fruits (3) , celles de M. Mirbel sur les cotylédons (4) , et de M.
Aug. de Saint-Hilaire sur l’ovule (5) , nous sommes presque réduits
sur ce point à ce que nous ont appris Grew et Malpighi. Cela ne
pouvait être autrement, les descriptions étant peu nombreuses , et
celles même que nous possédons n’étant rédigées, pour la plupart,
que dans l’intention de faciliter la distinction des espèces.
On pourrait croire, d’après cèla, que cette partie est très-avancée,'
qu’il est aisé de distinguer les Rumex, et d’établir leur synonymie;
mais il en est tout autrement, et les erreurs consignées dans les livres,
et celles sans doute plus nombreuses qui restent inédites, ne justifient
que trop cette assertion.
Cela me parait dépendre du défaut de connaissance ,
i.° De certains organes ou de quelques-unes de leurs modifications.
Nous verrons , par exemple , que le calicule et l’articulation du pédicule
de la fleur fournissent de très-bons caractères ;
2.0 Du degré de confiance que mérite chaque organe et chacune de
ses modifications , sous le point de vue qui nous occupe. C’est à to r t ,
en effet , qu’on a fait plus d’attention aux organes sexuels qu’à leurs
enveloppes ; à la présence des tubercules des parties intérieures du
(1) The anatomy of Plants.
(2) Anatome plantarum.
(3) Defruct.et semin.pl., 2, p. 178-180.
C4) Annales du Mus. d’hist. natur., tom. i 3.
(5) Mémoire sur les plantes auxquelles on- attribue un placenta central
libre, etc., p. 63.