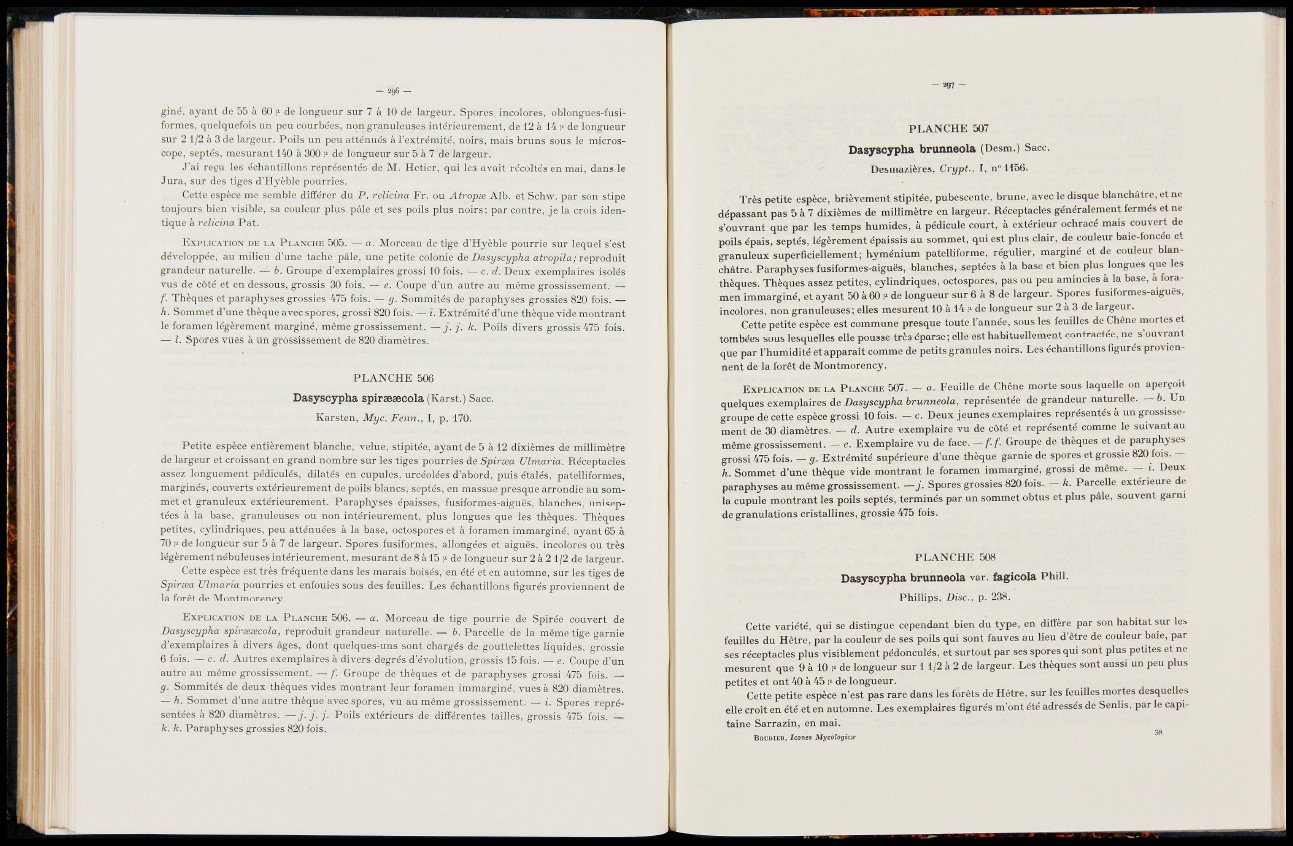
giné, a3'ant de 55 à 60 p- de longueur sur 7 à 10 de largeur. Sjoores incolores, oblongues-fusiformes,
quelquefois un peu courbées, non granuleuses intérieurement, de 12 à 14 i-^ de longueur
sur 2 1/2 à 3 de largeur. Poils un peu atténués à l'extrémité, noirs, mais bruns sous le microscope,
septés, mesurant 140 à 300 H de longueur sur 5 à 7 de largeur.
J'ai reçu les échantillons représentés de M. Hetier, qui les avait récoltés en mai, dans le
Jura, sur des tiges d'Hyèble pourries.
Cette espèce me semble différer du P. relicina Fr. ou Atropse Alb. et Schw. par son stipe
toujours bien visible, sa couleur plus pâle et ses poils plus noirs; par contre, je la crois identique
à relicina Pat.
E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE 505. ~ a. Morceau de tige d'Hj'èble pourrie sur lequel s'est
développée, au milieu d'une tache pâle, une petite colonie às Dasyscypha aft-opi7a; reproduit
grandeur naturelle. — h. Groupe d'exemplaires grossi 10 fois. — c. cl. Deux exemplaires isolés
vus de côté et en dessous, grossis 30 fois. — e. Coupe d'un autre au même grossissement. —
/'. Thèques et paraphyses grossies 475 fois. — g. Sommités de paraphyses grossies 820 fois. —
h. Sommet d'une thèque avec spores, grossi 820 fois. — i. Ext rémi t é d'une thèque vide montrant
le foramen légèrement margine, même grossissement. — j . j. k. Poils divers grossis 475 fois.
— l. Spores vues à un grossissement de 820 diamètres.
PLANCHE 506
Dasyscypha spiraeaecola (Karst.) Sacc.
Karsten, Myc. Fenn., I, p. 170.
Petite espèce entièrement blanche, velue, stipitée, ayant de 5 à 12 dixièmes de millimètre
de largeur et croissant en grand nombre sur les tiges pourries de Spirsea Ulmaria. Réceptacles
assez longuement pédiculés, dilatés en cupules, urcéolées d'abord, puis étalés, patelliformes,
marginés, com-erts extérieurement de poils blancs, septés, en massue presque arrondie au sommet
et granuleux extérieurement. Paraphyses épaisses, fusiformes-aiguës, blanches, uniseptées
à la base, granuleuses ou non intérieurement, plus longues que les thèques. Thèques
petites, C3'lindriques, peu atténuées à la base, octospores et à foramen immarginé, ayant 65 à
70 de longueur sur 5 à 7 de largeur. Spores fusiformes, allongées et aiguës, incolores ou très
légèrement nébuleuses intérieurement, mesurant de 8 à 15 H- de longueur sur 2 à 2 1/2 de largeur.
Cette espèce est très fréquente dans les marai s boisés, en été et en automne, sur les tiges de
Spireea Ulmaria pourries et enfouies sous des feuilles. Les échantillons figurés proviennent de
la forêt de Montmorenc3'.
E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE 506. — a. Morceau de tige pourrie de Spirée couvert de
Dasyscypha spireeiecola, reproduit grandeur naturelle. — b. Parcelle de la même tige garnie
d'exemplaires à divers âges, dont quelques-rms sont chargés de gouttelettes liquides, grossie
6 fois. — c. d. Autres exemplaires à divers degrés d'évolution, grossis 15 fois. — e. Coupe d'un
autre au même grossissement. — f . Groupe de thèques et de paraphyses grossi 475 fois. —
g. Sommités de deux thèques vides montrant leur foramen immarginé, vues à 820 diamètres.
— h. Sommet d'une autre thèque avec spores, vu au même grossissement. — i. Spores représentées
à 820 diamètres. — j . j . j. Poils extérieurs de différentes tailles, grossis 475 fois. —
k. k. Paraphyses grossies 820 fois.
- m -
PLANCHE 507
Dasyscypha brunneola (Desm.) Sacc.
Desmazières, Crypt., I, n» 1156.
Très petite espèce, brièvement stipitée, pubescente, brune, avec le disque blanchâtre, et ne
dépassant pas 5 à 7 dixièmes de millimètre en largeur. Réceptacles généralement fermés et ne
s'ouvrant que par les temps humides, à pédicule court, à extérieur ochracé mais couvert de
poils épais, septés, légèrement épaissis au sommet, qui est plus clair, de couleur baie-foncée et
granuleux superficiellement; hyménium patelliforme, régulier, marginé et de couleur blanchâtre.
Paraphyses fusiformes-aiguës, blanches, septées à la base et bien plus longues que les
thèques. Thèques assez petites, cylindriques, octospores, pas ou peu amincies à la base, à foramen
immarginé, et ayant 50 à 60 de longueur sur 6 à 8 de largeur. Spores fusiformes-aiguës,
incolores, non granuleuses ; elles mesurent 10 à 14 de longueur sur 2 à 3 de largeur.
Cette petite espèce est commune presque toute l'année, sous les feuilles de Chêne mortes et
tombées sous lesquelles elle pousse très éparse; elle est habituellement contractée, ne s'ouvrant
que par l'humidité et apparaî t comme de petits granules noirs. Les échantillons figurés proviennent
de la forêt de Montmorency.
E X P L I C A T I O N DE LA PLANCHE 507. - a. Feuille de Chêne morte sous laquelle on aperçoit
quelques exemplaires de Dasyscypha brunneola, représentée de grandeur naturelle. — h. Un
groupe de cette espèce grossi 10 fois. — c. Deux jeunes exemplaires représentés à un grossissement
de 30 diamètres. — d. Autre exemplaire vu de côté et représenté comme le suivant au
même grossissement. - e. Exemplaire vu de face. - f./'. Groupe de thèques et de paraphyses
grossi 475 fois. — g. Extrémité supérieure d'une thèque garnie de spores et grossie 820 fois. —
h. Sommet d'une thèque vide montrant le foramen immarginé, grossi de même. — i. Deux
paraphyses au même grossissement, —j. Spores grossies 820 fois. - k. Parcelle extérieure de
la cupule montrant les poils septés, terminés par un sommet obtus et plus pâle, souvent garni
de granulations cristallines, grossie 475 fois.
PLANCHE 508
Dasyscypha brunneola var. fagicola Phill,
Phillips, Disc., p. 238.
Cette variété, qui se distingue cependant bien du type, en diffère par son habitat sur les
feuilles du Hêtre, par la couleur de ses poils qui sont fauves au lieu d'être de couleur baie, par
ses réceptacles plus visiblement pédonculés, et surtout par ses spores qui sont plus petites et ne
mesurent que 9 à 10 de longueur sur 11/2 à 2 de largeur. Les thèques sont aussi un peu plus
petites et ont 40 à 45 de longueur.
Cette petite espèce n'est pas rare dans les forêts de Hêtre, sur les feuilles mortes desquelles
elle croît en été et en automne. Les exemplaires figurés m'ont été adressés de Senhs, par le capitaine
Sarrazin, en mai.
BOUDIER, Icônes Mycologicoe