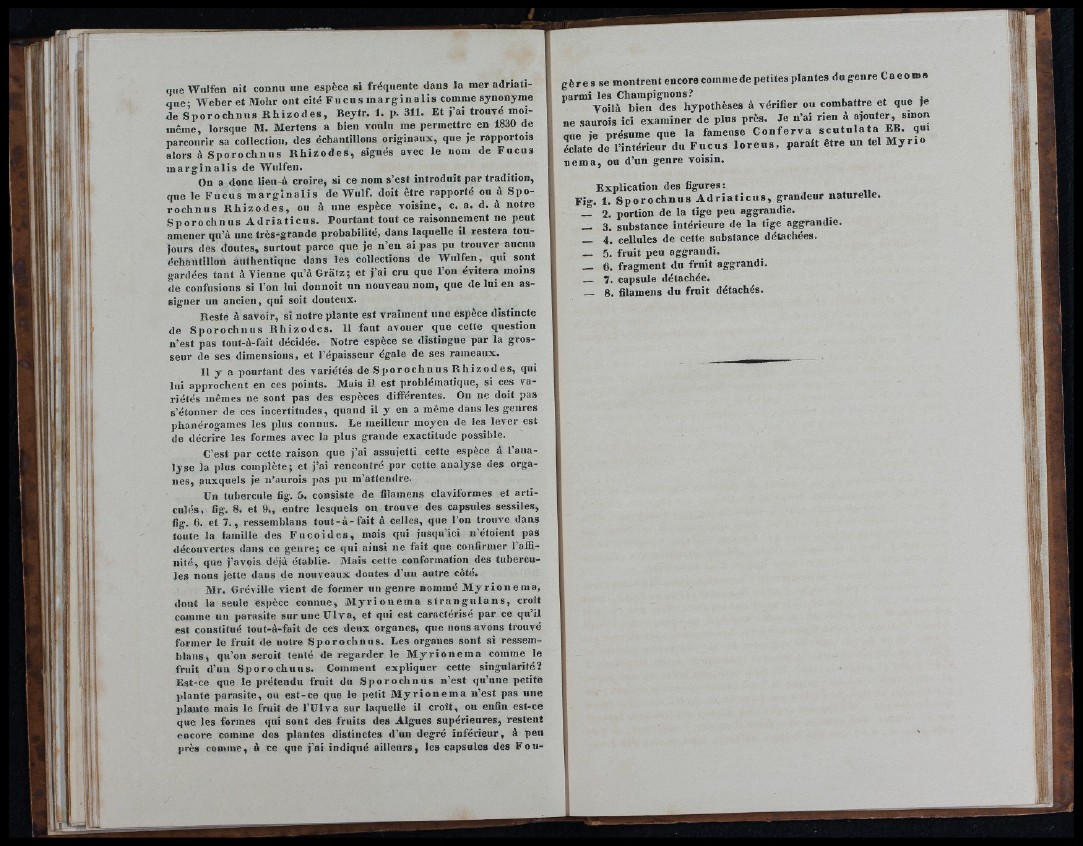
que Wulfen a it connu une espèce si fréq u en te dans la mer a d ria tî-
q u e - W eb e r et Mobr on t cité F u c u s i n a r g i n a l i s comme synonyme
de S p o r o c b m i s R b i z o d e s , B ey tr. 1. p. 311. Et j ’ai trouvé mot-
même, lorsque M. Mertens a bien voulu me pe rme ttre en 1830 de
parcourir sa collection, des échantillons orig in au x , que je rapportois
alors à S p o r o c h n u s R b i z o d e s , signés avec le nom de F u c u s
m a r g i n a l i s de Wulfen.
On a donc lieuA croire, si ce nom s’e st in tro d u it pa r tradition,
qne le F u c u s m a r g i n a l i s de Wulf. doit ê tre rap p o rté on à S p o -
r o c h im s R b i z o d e s , ou à un e espèce v o is in e , c. a. d. à n o tre
S p o r o c h n u s A d r i a t i e n s . P o u rtan t to u t ce raisonnement ne peu t
amener qu’à une trè s -g ran d e probabilité, dans laquelle il re ste ra to u jours
des doutes, su rtout parce que je n ’en ai pas pu tro u v er aucun
é ch antillon au th en tiq u e dans les collections de W u lfe n , qui sont
g ardées ta n t à Vienne qu’àG r a lz ; e t j ’ai cru que l ’on év ite ra moins
de confusions si l’on lui donnoit un nouveau nom, qne de lu i en assigner
un ancien, qui soit douteux.
Reste à savoir, si notre p lan te est v ra im en t un e espèce distincte
de S p o r o c h n u s R b i z o d e s . H fau t avouer qu e cette question
n ’est pas tout-à-fait décidée. Notre espèce se distingue p a r la g ro sseur
de ses dimensions, e t l ’épaisseur égale de ses ram e au x .
Il y a p o u rtan t des v a rié té s de S p o r o c h n u s R b i z o d e s , qui
lui approchent en ces points. Mais i) est problématique, si ces v a rié
té s mêmes ne sont pas des espèces différentes. Ou n e doit pas
s’étonner de ces in c e rtitu d e s , quand il y en a même dans les genres
phanérogames les plus connus. Le meillenr moyen de les lev e r est
de décrire les formes avec la p lu s gran d e exactitude possible.
C’est p a r celte ra iso n que j’ai assujetti cette espèce à l ’an a ly
s e la pins complète; et j’ai rencontré par cette a n a ly se des organ
e s , auxquels je n ’aurois pas pu m’atleiulre.
TJn tubercule fig. 5. consiste de filamens claviformes et a r ticu
lé s, flg. 8. et 9., entre lesquels ou trouve des capsules sessiles,
fig. 6. et 7 . , ressemblans to u t- à - f a i t à celles, qne l ’on trouve dans
tonte la famille des F n c o i d e s , mais qui jusqu’ici n ’étoient pas
découvertes dans ce g e n re ; ce qui ainsi ne fait que confirmer l’affin
ité , que j’avois déjà établie. Mais cette conformation des tubercules
nous jette dans de n o u v e au x doutes d ’un au tre côté.
M r. Gréville v ien t de former un g enre nommé M y r i o n e m a ,
dont la seule espèce connue, M y r i o n e m a s l r a n g u l a n s , croît
comme un p arasite sur une U lv a , e t qui est caractérisé p a r ce qn’il
esl constitué to ut-à-fait de ces d eux organes, que nous avons trouvé
fo rm er le fru it de notre S p o r o c h n u s . Les organes so n t si ressemb
la n s , qu ’on seroit tenté de re g a rd e r le M y r i o n e m a comme le
fru it d’u n S p o r o c h n u s . Comment e x p liq u e r cette singularité?
Est-ce que le p ré ten d u fru it du S p o r o c h n u s n ’est qu’une petite
]>laiite p a ra s ite , ou e s t- c e que le p e tit M y r i o n e m a n ’est pas une
p lan te mais le fruit de l’U lv a sur laquelle il c ro ît, ou enfin est-ce
que les formes qui so n t des fru its des Algues supé rieu re s, re sten t
encore comme des p lan te s distinctes d ’un degré in fé rie u r, à peu
près comme, à ce que j ’ai indiqué a illeu rs , ies capsules des F o u g
è r e s se m o n tren t encore c o m m e de p etites p lantes du g en re C a e om »
parmi les Champignons? .
Yoilà b ien des hypo th èses à v é rifier ou combattre et que Je
ne sanrois ici e x am in e r de p lu s p rè s. Je n’ai rien à
mie je présume que la fameuse C o n f e r v a s c u t u l a t a EB. qui
L la te de l’in té rieu r du F u c u s l o r e u s , p a ra ît ê tre un tel M y r i o
p e m a , ou d ’un g en re voisin.
E x p lic a tio n des figures:
Fig . 1. S p o r o c h n u s A d r i a t î c u s , g randeur n a tu re lle .
1 2. portion de la tige peu aggrandie.
— 3. substance in té rieu re de la tige aggrandie.
_ 4. cellules de cette substance détachées.
_ 5. fru it peu aggrandi.
_- 6. fragment du fru it aggrandi.
7. capsule détachée.
— 8. filamens du fru it détachés.
iî
■f
‘ii'
i