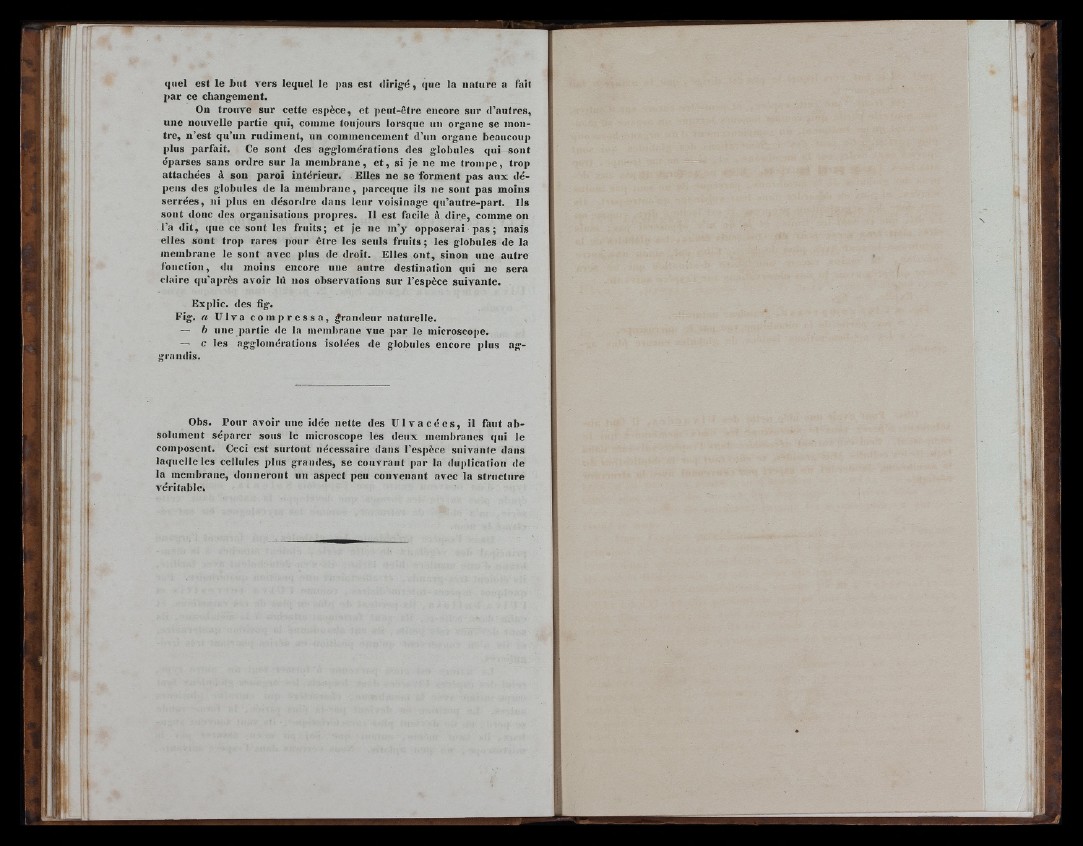
quel est le b u t vers lequel le pas est d ir ig é , que la n a tu re a fait
p a r ce cbangeineiit.
On trouve su r cette e spè ce , et p eut-être encore su r d’autres,
u ne nouvelle partie qui, comme toujours lorsque uu organe se montre,
n ’e st qu ’un ru d im en t, un commencement d ’un organe beaucoup
plus p a rfa it. Ce sont des agglomérations des globules qui sont
éparses san s o rd re su r la m em b ran e , e t , si je ne me trom p e , trop
attachées à sou p aroi in té rieu r. Elles n e se forment jjas a u x dé-
jjens des globules de la in em b ra iie , parceque ils ne sont p a s moins
s e rré e s , ni plus en désordre dans leu r voisinage qu’autre -p art. Ils
sont doue des organisations p ropres. 11 est facile à d ire , comme on
l ’a d it, que ce sont les fru its ; et je ne m’j opposerai pas ; mais
elles so n t trop ra re s pour ê tre les seuls fruits ; les globules de la
membrane le sont avec plus de droit. Elles o n t, sinon une a n tre
to iic tio n , du moins encore nue a u tre destination qui n e sera
claire qu’après av o ir lû nos observations su r l’espèce suivante.
Explic. des fig.
Fig. a U t v a c o m p r e s s a , g randeur naturelle.
— b une p a rtie de la membrane vue ])ar le microscope.
— c les agglomérations isolées de globules encore ]>lus ag-
graiidis.
i
si:
!4
m
•‘M
Obs. P o u r av o ir une idée n e tte des U l v a c é e s , il faut ab solument
sép a re r sous le microscope les d eu x membranes qui le
coinposeiit. Ceci est surtout nécessaire dans l’espèce suivante dans
laquelle les cellules plus grandes, se co u v ran t par la duplication de
la ineiiibraiie, iloiiiieroiit un aspect peu coiiveiiaiit avec la structure
véritable.
i