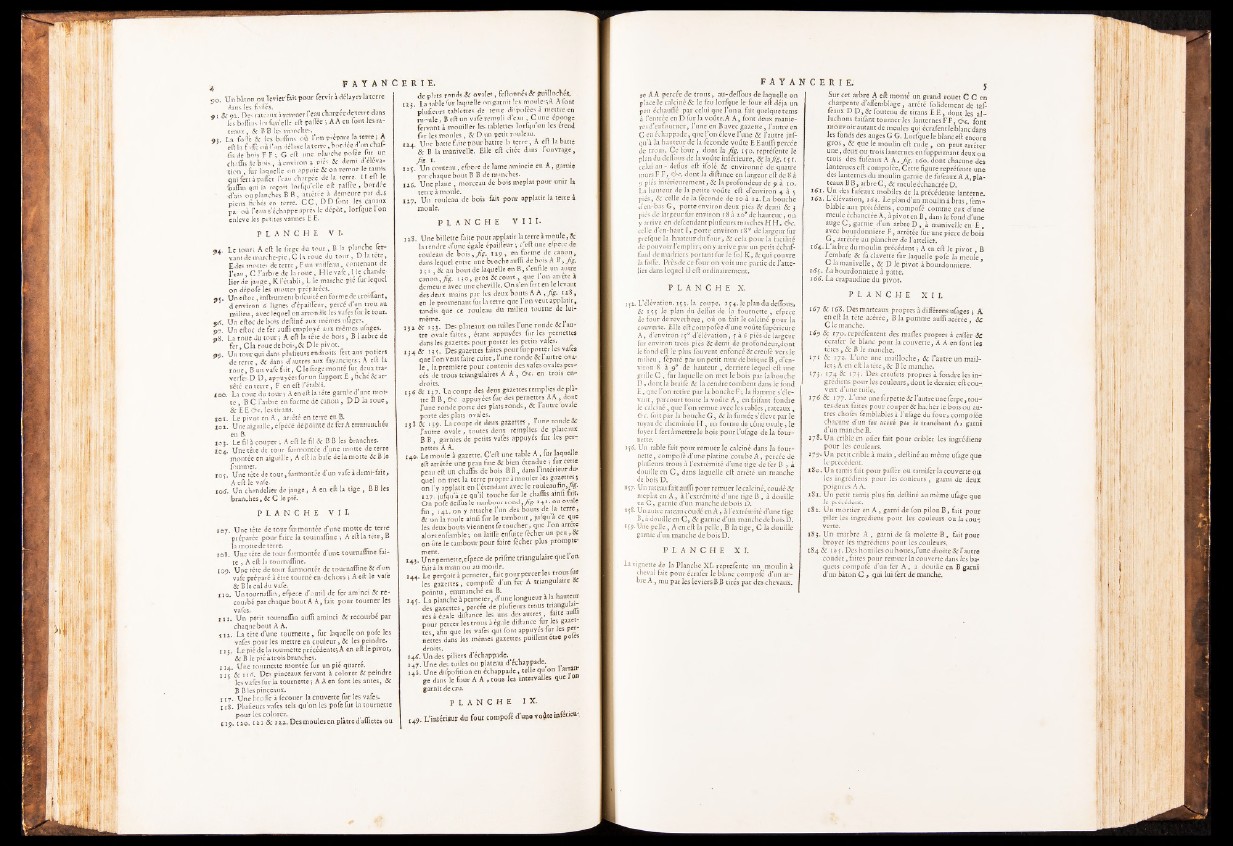
F A Y A N C
50. UnNïton onlevierTatt pour IMvii-à délayer là'tcrre
o I &d oazn.s Dlees< froâtlleeasu. x — S l’eau chargé,e dewre dans
les baflins lo.fqu’elle eft p a liée -, A A en font les râ93.
Lteaa ufoxl l,e && Bl'Bes lebsa fmlînasn cohùe s.l ’on pré#paré « terrei A eft la forte où l’on délaye la terre, bordee d’un chaf-
11s de bo'-s F F -, G eft une planche pofée fur tm
ctiho ’n.lT i,s fduer bloaiqsu ,e làle e novni raopnp u1i ep i&es o5nc redmemuie dle é tlaémvais
quifertàpaffer l’eau chargée delà terre. H eft Je
'badin qui la reçoit lorfqu elle eft paflee, bordee
’ ‘dpi’aeiusx o ufi cphléasn cehne st eBr rBe ., CanCct,c eD aD dfeomnte ulrees pcaarn adu.xs
par où l’eau s’échappe après le dépôt, lorfque 1 on
enleve les petites vannes E E.
P L A N C H E V I.
94. Lvea ntto duer ;m Aar cehfte -lep ifci,e Cge ldau r otouue rd ,u B t olau rp ,l aDnc lhae t ê1eter-,
Edes mottes de terre , F un vailfcau, contenant de
l’eau , C »’arbre de la roue, H le vafe, I le chandelier
de jauge, K l’ctabli, L le marche pié fur lequel
. Uonn edfétpoocf,e i nlefstr ummoettnets b pifrcéupiatréé eens. forme de troiuant,
d environ 6 lignes d’épailïeur, perce d un trou au
milieu, avec lequel on arronditles vafes fur le tour.
9976.. UUnn eeffttoocc ddee bfeori sa udfelîf teinmép alouxy ém aêumx ems êumfaegse su.fages.
08. La roue du tour ; A eft la tête de bois, B 1 arbre de
99. Ufenr t, oCu rla q ruoi udea ndse bpoluifsi,e &ur Ds e lned prioviotst .fert aux potiers
de terre, ôc dans d’autres aux fayanciers ; A eft la
roue, B un vafe fait, C le fiege monté fur deux tra-
verfés D D, appuyées fur un fupport E , fiché ôc ar100.
rLêaté r oenu et edrure t ,o uF r;e nA eefnt el’fétt alab ltiê.te garnie d’une motte
, B C l’arbre en forme de canon, D D la roue,
101. ôLc eE pEiv &oct .e nle sAt i,r aanrsr.êté en terre en B. f iox. Une aiguille, efpece de pointe de fer A emmanchée
103. eLne Bfi.l à couper -, A eft le fil & B B les branches.
104. Une tête de tour furmontée d’une motte de terre
montée en aiguille > A eft la baie de la motte ôc B le
tof. fUomnem teêtt.e de tour, furmontée d’un vafé a demi-fait#
106. AU enf tc lhea nvadfeel.ier de jauge » A en eft la tige , B B les
branches, ôc C le pié.
P L A N C H E V I I .
107. pUrénpea rtéêete pdoeu tro fuarir fei nl-am toonutrénea fdl’îunne e-, mAo etftte l ad teê tteer,r Be
108. laU mneo tttêet ed ed ete troreu.r furmontée d’une tournaflîne fai109.
tUe n, eA t êetfet ldae t otouurnr affulîrnme.ontée de tournaflîne ôc d un vafe préparé à être tourné en-dehors ; A eft le vafe
110. &U nBt loeu crunla dfulî vna, feef.pece d’outil de fer amnei ôc recourbé
par chaque bout A A, fait pour tourner les
i n . vafUesn. petit tournaflin aùfli aminci & recourIbe par
•ni. cLhaa qtuêete b do’uutn Ae Ato.umette, fur laquelle on pofe les
113. vLafee psi ép doeu rl al etos umrneetttrtee penré ccéoduelnetuer,, A & e nle esf tp leeipnidYreo.t,
114. &U nBe l eto puicm àe trttoei sm boranntcéhee fsu. r un pié quarré. l i t ôc 11 <5. Des pinceaux fervant à colorer ôc peindre
• les vafes fur la tournette -, A A en font les antes, ôc
117. BU Bn lee sb proindcee aàu fxe.couer la couverte fur les vafes.
1 18 . Plufieurs vafes tels qu’on les pofe fur la tournette
pour les colorer. 119. izo. iai ôcizi. Des moules en plâtre daflietes ou
E R I E.
de plats ronds 8c ovale«, feftorinés 8c guitlochés.
m . La table fut laquelle on garnit les mouler,A A font
plufieurs tablettes de terve di'pofées à mettre en
rotule, B eft un vafe rempli d’eau , Çune éponge
fervant à mouiller les tablettes lorfqu’on les étend
114. fUurn lee sb mattoeu flaeiste, p&o uDr buna tptreet ilta rtoeurlreea,u .A eft la batte
& B la manivelle. Elle eft citée dans l’ouvrage,
/? . *• . 1 i t . Un couteau, efpece de lame amincie en A , garnie
par chaque bout B B de manches. u 6. Une plane , morceau de bois méplat pour unir la
117. teUrnre rào muloeualue . de bois fait pour applat.ir la terre à
moule.
P L A N C H E V I I I .
iz8. Une billette faite pour applatir la terre à moule, &
laiendrc d’une égale épaiffeur ; c’eft une efpece de
rdoaunlse laeuq udeel ebnotries u,/n?e. b r1o1c9h,e aeunf lfîo drem beo idse canon, A B, /? .
131 , & au bout de laquelle en B, s’enfile un autre
canon,/?. 130, gros & court, que l’on arrête à
demeure avec une cheville. On s’en fert en le levant
des deux mains par les deux bouts A A ,/? • 118,
en le promenant fur la terre que l on veut applatir,
tandis que ce rouleau du milieu tourne de lui-
131 &m ê1m5 e3.. Des plateaux ou tuiles l’une ronde Ôc 1, autre
ovale faites, étant appuyées fur les pernettes
dans les gazettes pour porter les petits vafes.
134 & 13 y. Des gazettes faites pour fupponer les vafes
que l’on veut faire cuire# l’une ronde &1 autre ovale
, la première pour contenir des vafes ovales percés
de trous triangulaires A A , &c. en trois endroits.
.A 136 & 13 7 . La coupe des deux gazettes remplies de plâtre
B B , & c appuyées fur des pernettes AA , dont
l’une ronde porte des plats ronds, & 1 autre ovale
porte des plats ovales. - 13 8 & 13 9. La coupe de deux gazettes , 1 une ronde ôc
l’autre ovale , toutes deux remplies de plateaux
B B, garnies de petits Vafes appuyés fur les per140.
nLeet tmeso uAlAe .à gazette. C’eft une ta,b,l e AI , f-u r ,laquelle
pefeta aur reêftté uen u cnhea pfleîas ud fei nbeo ôisc bBi Ben, detaennsd lu’ien t;é rfiueru cre dtute
quel on met la terre propre à mouler les gazettes i
on l’y applatit en l’étendant avec le rouleau fin J ï?.
117. jufqu’à ce qu’il touche fur le chaflîs ainfi tait.
On pofe deflîis le tambour rond ,/?• 141. ou ovale
fin , 141. on y attache l’un des bouts de la terre,
ôc on la roule ainfi fur le tambour, jufqu’à ce que
les deux bouts viennent fe toucher, que 1 on arrête
alorsenfemble3 on laiffe enfuite fécher un peu#&
on ôte le tambour pour faire fécher plus prompte143.
Umnene tp. ernette,efpece de prifIm e triangulai. re que .1, on
144. fLaeit àp elarç moairi nà poeur anue tmero, ufaleit. pourpercer les trous l.ur
les gazettes, compofé d’un fer A triangulaire ÔC
14y. pLoai nptlua n,c ehme àm paenrcnheét eern, dB’.u ne longueur à la ,hauteur
des gazettes , percée de plufieurs trous triangulaipreosu
àr épgearlcee rd lieftsa tnrcocu sl eàs é guanlse ddeifst aanuctere fsu, r lreasit eg aazueiti
tes, afin que les vafes qui (ont appuyés lur les pernettes
dans les mêmes gazettes puiffent etre pôles
146. Udrno idtse.s piliers dféchappadc. 114487.. UUnnee ddeifsp toufiilteios no eun p élactheaapup dacdceh, ateplplea dqeu.ion 1 arrange
dans le four A A , tous les intervalles que Ion
garnit de cru.
P L A N C H E IX .
L’iatcriaut du foui compofé d’u0a voîteinfoteu'
F A Y A N C E R I E .
re AA percée de trous, au-deflous de laquelle on
place le calciné ôc le feu lorfque le four eft déjà un
pà elu’e néctrhcaeu effné Dp afur rc leal uvio qûutee. Al’o An a, ffoanitt qdueeulxq ume atnemiès
res d’enfourner, l’une en B avec gazette, l’autre en
qCu e’àn léac hhaapupteaudre d, eq ulae fle’ocnon édleev veo lû’uten eE ô Ec alu’afluî tpree rjcuéfee
de trous. Ce four, dont la /? . iyo. repréfente le
plan du deffous de la voûte inférieure, & la/? . i y i.
celui au - deffus eft ifolc ôc environné de quatre
murs F F# &c. dont la diftance en largeur eft de 8 à
9 pies intérieurement, ôc la profondeur de 9 à 10.
La hauteur de la petite voûte eft d’environ 4 à y
piés, ôc celle de la feconde de 10 à 11. La bouche
dpi’eésn -dbea sla Grg,e upro furtre e ennvviriroonn 1d8e àu xz op°i édse ôhca duetemuir 3ô co n3
y arrive en defeendant plufieurs marches H H , &c.
celle d’en-haut I, porte environ 1 S° de largeur fur
prefque la hauteur du four# & cela pour la facilité
de pouvoir l’emplir ; on y arrive par un petit échaf-
faud de madriers portant fur le fel K, &qui couvre
lliae fro dffaen. s Plerqèsu edle icl ee ffot uorr doinn aviroeimt uennet .partie de l’atte-
P L A N C H E X.
lyi. &L’ éllyévya tlieo np.l a1 yn 3 d. lua dceofluîipse d. e iyla4 . floeu prlnaent dteu ,d eefffpouecs#e
de four de reverbere, où on fait le calciné pour la
couverte. Elle eft compofée d’une voûte fupérieure
A, d’environ iy° d’élévation, y à 6 piés de largeur
lfeu rf oenndv ierfot nle t rpoliuss pfioéusv &endte emnif odnec ép rÔocf corneudfeëu vr,edros nlet
milieu , féparé par un petit mur de brique B, d’environ
8 à 9° de hauteur , derrière lequel eft une
grille C , fur laquelle on met le bois par la bouche
D # dont la braife Ôc la cendre tombent dans le fond
E, que l’on retire par la bouche F ; la flamme s’élevant
, parcourt toute la voûte A, en faifant fondre
le calciné, que l’on remue avec les râbles, rateaux,
&c. foit par la bouche G, ôc la fumée s’élève par le
tuyau de cheminée H , en forme de cône ovale 3 le
nfoeytteer. 1 fert à mettre le bois pour l’ufàge de la four-
ïy<5. Un rable fait pour remuer le calciné dans la four-
nette , compofé d’une platine courbe A, percée de
dpoluufiileleu resn t rCou,s d àa nl’se xlatrqéumelilteé def’ut naer rtêigtée udne fmera Bnc #h eà de bois D.
*Î7- Un rateau fait auflî pour remuer le calciné, coude &
méplat en A, à l’extrémité d’une tige B , à douille
en C , garnie d’un manche de bois lX
iy8. Un autre rateau côudé en A, à l’extrémité d’une tige
B, à douille en C , & garnie d’un manche de bois D.
gUanren ipee dl’luen, Am aennc ehfet ldae p beollies ,D B. la tige, C la douille
P L A N C H E XI .
La vignette de la Planche XI. reprefente un moulin à
cheval fait pour écrafer le blanc compofé d’un arbre
A, mu par les leviers B B tirés par des chevaux. I
Sur cet arbre A eft monté un grand rouet C C en
charpente d’affemblage, arrêté folidement de taC-
feaux D D , & foutenu de tirans E E , dont les al-
luchons faifànt tourner les lanternes F F , &c. font
lmeso fuovnodisr daeust aanutg dees meules qui écrafent le blanc dans gros , ôc que le moGu lGin. eLfot rrfuqduee l,e obnla npce euftt aernrcêoterer
une, deux ou trois lanternes en fupprimant deux ou
•trois des fuféaux A A # / ? . 1 60. dont chacune des
ldaenst elarnnteesr neefts cdoum mpooufélien. Cgaertntei ef idgeu rfeu rfeépauréxf Aen Ace, pulnae
teaux B B, arbre C, & meule échancrée D.
1 6 1 . Un des fuféaux mobiles de la précédente lanterne.
1 kbi lea/bcvlea ta*uoxn >p recédLene sp,l acno md’upno fmé ocuolminm àe b reausx, dfe’umn-e
meule echancrée A, àpivot en B, dans le fond d’une
auge C , garnie d’un arbre D , à manivelle en E ,
avec bourdonniere F , arrêtée fur une piece de bois
G , arrêtée -au plancher de l’attelier.
164. L’arbre du moulin précédent 3 A en eft le pivot, B 1 embafé ôc fà clavette fur laquelle pofé la meule ,
C la manivelle, & D le pivot à bourdonniere. i<>y. La bourdonniere à patte.
166. La crapaudine du pivot.
P L A N C H E X I I .
167 ôc 1*8. Des marteaux propres à différens ufages j A'
eCn leef mt laan ctêhtee. acérée, B la pomme auflî acérée , ôc
i*9 & 170. repréfentent des mafles propres à caflèr ÔC
teêctreasfé, r& l eB blela mnca npcohuer. la couverte, A A en font les
171 &let ;1 A7Z e. nL e’uftn lea tuêntee , mÔca iBll olec hmea#n côhce l.’autre un mailI7
3 - gJr7é4d i&en s* 7pof*u rD leess ccoreuulefeutrss ,p droopnrte lse àd efronniderr ee flte cs oinuvert
d’une tuile.
17* ôtec s 1d7e7u.x L f’auintees upnoeu fré cropueptteer& ôcl ’hauactrhee ur nlee fbéorips eojuto auu“
tres choies fémblablesà l’ufage du four# compofée
dch’uanc umnaen dch’uen B f.er acéré par le tranchant A, garni
178. Uponu cr rliebsle c eonu loefuîresr. fait pour cribler les ingrédiens
179. Ulen p rpéceétidt ecnritb. le à main, deftiné au même ufage que
18 0 . lUesn itnagmréisd fiaeint sp opuoru pra lfeles rc oouu lteaumrsi f,é r glaa rcnoiu dvee rtdee ouux poignées A A. 1S1. Un petit tamis plus fin deftiné au même ufage que
le précédent.
18z. Un mortier en A, garni de fon pilon B, fait pour
vpeilreter .les ingrédiens pour les couleurs ou la cou185.
Un marbre A , garni de fa molette B , fait pour
broyer les ingrédiens pour les couleurs.
184 & 1 ô y. Des houilles ou houes,l’une droite ôc l’autre
coudée, Elites pour remuer la couverte dans les baquets
compofé d’un fer A , a douille en B garni
d’un bâton C # qui lui fert de manche.