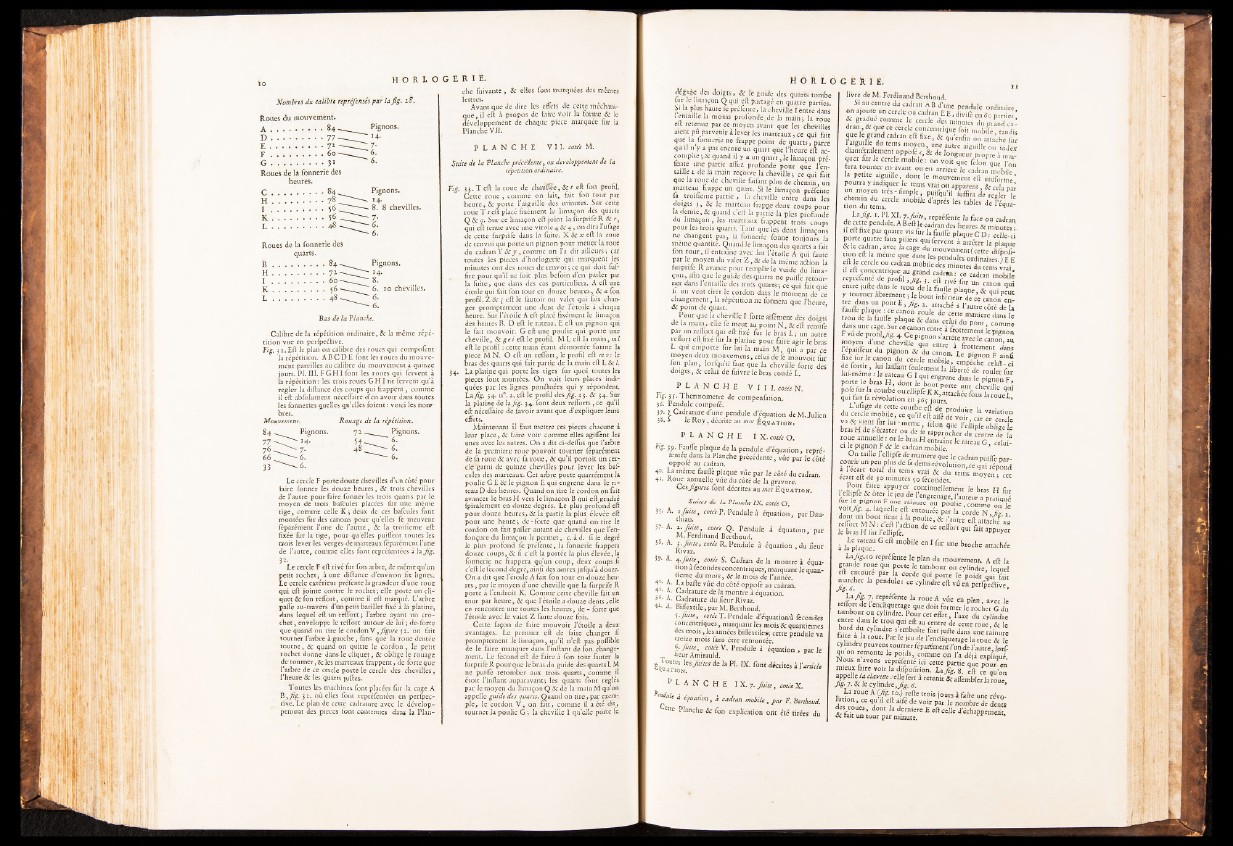
to H O R L O
Nombres du eâiibft riptéfehïé's pa r la fig. 28 .
R oues du mouvement.
A . . . • Pignons.
D . . • • 14 .
E . . . . . . . . 71 — ».■ £ 7-
6.
G . . . . . . . . 31 1 6 .
RoueS de là fonnerie des
heures.
C . . . . -------- 8.1 Pignons.
H . . . . -------- 7« ^ ^ 14 .
• • • • --------- 8 chevilles.
K . . . . . . . . 56 ------■— 7-
L . . . • — 4 8 ^
B 6.
Roues de la fonnerie des
quarts.
B . . . . Pignons.
H . . . . ^ 14-
8.
K . . . . 6. 1 0 chevilles
L . . . . . . . MH 6 .
Bas de la Blanche.
Calibre de la répétition ordinaire, Sc la même répétition
vue en pcrfpeétive.
Fig. 3 1 . Eft le plan ou calibre des roues qui compofênt
la répétition. A B C D E font les roues du mouvement
pareilles au calibre du mouvement à quinze
jours. PI. III. F G H I font les roues qui fervent à
la répétition : les trois roues G H I ne fervent qli’à
régler la diftance des coups qui frappent, comme
il eft abfolument néceffaire d’en avoir dans toutes
les fortneriesquelles quelles foient : voici les nombres.
Mouvement. Rouage de la répétition.
8 4 — Pignons. 71 _ Pignons.
77 \ 14 . ■ * 6.
7 6 48 6.
66 —■ 6.
33
Le cercle F porte douze chevilles d’un côté pour
faire fonner les douze heures, & trois chevilles
de l’autre pour faire fonner les trois quarts par le
moyen de trois bafcules placées fur une même
tig e , comme celle K ; deux de ces bafcules font
montées fur des canons pour qu’elles fe meuvent
féparément l’une dé l’autre, & la troifïeme eft
fixée fur la tige, pour qu’elles puiffent toutes les
QroiS lever les verges de marteaux féparément l'une
de l’autre, comme elles font repréfêntces à la fig.
Le cercle F eft rivé fur fon arbre, de même qu’un
petit röchet, à une diftance d’environ fix lignes.
Le cercle extérieur préfênte la grandeur d’une roue
qui eft jointe contre le röchet; elle porte un cliquet
Sc fon reffort, cçmme il eft marque. L ’arbre
paffe au-travers d’un petit barillet fixé à la platine,
dans lequel eft un reffort ; l’arbre ayant un crochet
, enveloppe le reffort autour de lui ; de-forte
que quand on tire le cordon V , figure 3 z. on fait
tourner l’arbre à gauche, fans que la roue dentée
tourne, Sc quand on quitte le cordon, le petit
röchet donne dans le cliquet, & oblige le rouage
de tourner ,& les marteaux frappent, de forte que
l’arbre de ce cercle porte le cercle dés chevilles,
l ’heure & les quarts juftés.
Toutes lés machines font placées fur la cage A
B , j f y - ï 1 ' où elles font repréfêntées en perfpec-
rive. Le plan de cette cadrature avec le développement
des pièces font contenues dans la Plàn-
G E R I Ê .
che fuivante , Sc elles font marquées des memes
lettres.
Avant que dé dire lés effets dé Cette ttiéchàhl-
q u e ,i l eft à propos de faite Voir la formé 6c le
développement de chaque pièce matqucé fut la
Planché V II.
P L A N C H E V I I . cotée M.
Suite de la Blanche précédente, ou développement de la
répétition ordinaire.
; Fig. 3 3. T eft la roue de chaulfée, & t eft fon profil,
j Cette roue , comme on fait, fait fon tour par
heure, & porte l’aiguille des minutes. Sur cette
roue T t eft placé fixément le limaçon des quavts
Q & q. Sur ce limaçon eft joint la furprife R & r ,
qui eft tenue avec une virole 4 Sc 4 ; on dira l’ufàge
de cette furprife dans la fuite. 3C 5c x eft la roue
de renvoi qui porte un pignon pour mener la roué
du cadran Y S c y , comme on l’a dit ailleurs; car
toutes les pièces d’horlogerie qui marquent les
minutes ont des roues de renvoi ; ce qui doit fuf-
fire pour qu’il ne foit plus befoin d’en parler par
la fuite, que dans des cas particuliers. A eft une
étoile qui fait fon tour en douze heures, & a fon
profil. Z Sc 1 eft le foutoic ou valet qui foit changer
promptement une dent de l’étoile à chaque
heure. Sur l’étoile A eft placé fixément le limaçon
des heures B. D eft le rateau. É eft un pignon qui
le fait mouvoir. G eft une poulie qui porte une
cheville, Sc g e i eft le profil. M L eft la main, ml
eft le profil : cette main étant démontée forme la
piece M N . O eft un reffort , le profil eft m o : le
bras des quarts qui fait partie de la main eft L & /.
34. La platine qui porte les tiges fur quoi toutes les
pièces font montées. On voit leurs places indiquées
par les lignes ponctuées qui y répondent.
La fig. 34. n°. 2. eft le profil des fig . * 3. & 34. Sur
la platine de la fig. 34. font deux refforts, ce qu’il
eft néceffaire de lavoir avant que d’expliquer leurs
effets.
Maintenant il fout mettre ces pièces chacune à
leur place, Sc faire voir comme elles agiffent les
unes avec les autres. On a die ci-defiùs que l’arbre
de la première roue pouvoit tourner féparément
de fo roue & avec fa roue, Sc qu’il portoit un cerclé'garni
de quinze chevilles pour lever les bafcules
des marteaux. Cet arbre porte quarrément la
poulie G E & le pignon E qui engrene dans le rateau
D des heures. Quand on;tire le cordon on fait
avancer le bras H vers le limaçon B qui eft gradué
fpiralement en douze degrés. Le plus profond eft
pour douze heures, Sc la partie la plus élevée eft
pour une heure ; de - forte que quand on tire le
cordon on fait palfer autant de chevilles que l’en-
fonçure du limaçon le permet, c. à d. fi le degré
le plus profond fe préfênte, la fbnnerie frappera
j douze coups, Sc fi c'eft la portée la plus élevée, la
fbnnerie ne frappera qu’un coup, deux coups.fî
c’eft le fécond degré, ainfi des autres jufqu’à douze.
, On a dit que l’étoile A foit fon tour en douze heures
, par le moyen d’une cheville que la furprife R
porte à l’endroit K. Comme cette cheville fait un
tour par heure, Sc que l’étoile a douze dents, elle
en rencontre une toutes les heures, de - forte que
l’étoile avec le valet Z foute douze fois.
Cette façon de foire mouvoir l’étoile a deux
avantages. Le premier eft de foire changer fi
promptement le limaçon, qu’il n’eft pas poffible
de le foire manquer dans l'inftant de fon changement.
Le fécond eft de faire à fon tour fouter la
furprife R pour que le bras du guide des quarts L M
ne puiffe retomber- aux trois quarts, comme il
étoit l'inftant auparavant; les quarts font réglés
par le moyen du limaçon Q & de la main M qu’on
appelle guide des quarcs. Quand on tire, par exern*,
p ie , le cordon V , on foie, comme il a été dit,
tourner la poulie G ; la cheville î qu’elle porte fe
fur lè lim.içon Q qui' éft partagé en quatre parties,
ht la plus haute fe préfente, la cheville î entré dans
lehtaillélà moins profonde.de la main; la rbue
eit retenue par ce moÿeh avâht que IeS chevilles
aient pûparvehir àle vet les marteâüi, ce qui fait
quc., ; onlaerie ne fraPPê point de quatts, parce
qu il n y a pas encore un quart que l’heure éft accomplie
; Sc quand il y a un quart, le limaçon piré-
féiite iine partie allez profonde pour que l’èn-
taillë z dé lâ iîiain rcçbive la cheville ; cé qui foit
que la roue de cheville foifont plus de chemiîi, un
marteau happe un quart. Si le limaçon préfehte
la troifïeme partie , fo cheville entre dans les
doigts 3 , Sc le itiàrtëau frappe deux fcôiips pour
la demie ,Sc quand c’eft la partie la plus profonde
du limaçon , les marteaux frappent trois coups
pour lés trois quarts. Tant que les deux limaçons
fte, changent pas, la fohnerie forme toujours J;
meme quantité. Quand le limaçon des quarts a fai
fon tour, il entraîné avec lui l'étoile A qui foute
par le moyen du valet Z , Sc de la même aétion la
lurprife R avance pour remplir le vuide du limaçon
, afin que le guide des quarts ne puiffe retoùr-
ner dans leiltaille dés trois quarts; ce qui fait que
ii on veut tirer le cordon dans le moment de ce
changement, la répétition ne fonneta que l’heure.
Sc point de quart.
Pour « H a c teftllé I fofte alternent des doigts
de la main, é lit fe meut au p om tN , k c â téitjifé
P. V ln in e “ ?U1,c ftlî,!' ful Il?lï * L , un autte
reflort eft hxe fur la platine pour foiré agir lé bras
L qui emporte fur lui la main M , qui a par ce
moyen deux Woüvemens, celui dé fe mouvoir fur
ion plan, lorfqu’il faut que la chevillé forte des
doigts, Sc celui de fuivre le bras coüdc L.
P L A N C H E V I I I. cotée N .
Big. 3 *. Thermomètre de compenfation.
3 6. Pendule compofc.
I ! Cadrature d’une pendule djiquation de M. Julien
i le R o y , décrite au mot É qu ATION.
P L A N C H E I X . votée O.
Kg. j * Fâuljè plaqué de la pendule d'équation, repré-
(entee dans la Planche présidente, vûé pat le côté
oppole au cadran.
4°- La même Etude plaque ŸÛépar le ■ du câdtaP. 41* Roue annuelle vue du côté de la gravure.
C es figures font décrites au moi É quation.
Suites de La Blanche IX. cotée Q,
3f. A. 1 fu ite y cotée P. Pendule à équation , parDàu-
thiau.
37- A. i . fiû te , cotée Q. Pendule à équation, par
M. Ferdinand Berrhoud;
|g! cotée R . Pendule à équation , du fîeur
Rivâz.
39- A. 4,.JüitCy cotée S. Cadran de la montre à équation
a fécondés concentriques, marquant Je quantième
du mois, Sc le m ois de l’année.
4° ’ La bafte vûé du coté oppofé au cadran.
m ^ ac*rature de fo Contre à équation.
>6‘ A. Cadrature dü fiéurRivaz.
41, A* BifTextile, par M. Berrhoud.
cozeeT. Pendule d’équation'à fécondes
concentriques, marquant lès mois & quantièmes
des mois, les années bifléxtile*; cette pendule va
treize mois lanS être remontée.
G. fuite, cotée V. Pendule à équation , par lé
hêiir Amirauld:
^ nt f r i t e s à l’article
• H a n c h e 1 x . 7 . , cotée x .
«tiule „ éjuatioit, à cadran mobile, par F. Berthoud.
Cette Planche & fon explication ont été tirées du
m:au centre au càdtall A 8 dupe pendulé ordinaire
on ajoute Un tefelé dil Cadran HE,divife en io parties’
9 B H H B D W S Ê Ê minutes du grantl^cà-
drau, & que ce ctttle concentrique foit itioBifè tiiidis
r . »n # antl Czdaa t fi f iî f aiguille du tems moHh cu> n&e aHutre ai ig üI ilf ea totalc Vhe Jfëuïr
& 1 B H ü i ü ü M
qtlet flir 1e cercle mobile: ori Ptlii q „ c félon que ?Ôn
■ H B D 9 ou m arriéré le cadian mobile
la peine aiguille dont le ttioutremeiit H Uhlfethie’
pourra y ,n iq u e r le tems vrai ou apparent, & “ la . S
un moyen trè s^îm ple , puifqu’ll de
^ n n d ü . t s . ettlS " bbifc d’^ S ^
F a fig . t. PI-XL i,fu it e , reprélènte la face ou cadran
de cette pendule. A B eft le cadran des heures & 1 1
.1 eft fixe par quatre vis für la fouffe plaqueCD: celfe-cî'
pott=.quatre taux p.lters qui fervent à arrêter la plaque
& !e cadran, avec .la cage du mouvement( cette
tret0d^bC1: I^br^^'t^^mm^if^ie^ir^e^ce^andrt^efft.
r * J o attache a I autre cote de la
h h h h h h
B I M iB liiW H B
L ufagè d e f ètté tourbe eft de produire la variation
du ectefe mobt e , ce qiffte ftaiféd e Voir, 1 1
■ H l i B « h n que l’èlJipfoobligefe
bras H de s écarter ou de lé rapprocher du centre de t
roue annuelle cor le bras H entraîne fe ra,éàu G ? c e fe -
Cl 1e pignon F S i 1e cadran
On faille lfelllpféde mamerèqùe le cadran puiffe parcouru:
un peu plus de fa demi-révolution,.ce qui épond
1 f l i * ' Kals H & A . tetxfo m o y en !“ «
écart eft de 30 minutes fo fecofidês. y J CC
I .nue appuyer continuellement le bras H fur
m m 1 ôtcr fe“ <1« l engtetïage, l'auteur a pratique'
fur le pignon F üné ramure ou poulie, comme ôn le
É n B B H W par la corde H , f i g a
dont Un bout tient à la p o u l ie ,* l'âütrè eft a t n X '
à f e p l a q u tG eft broché attachée
L a * i t o rèpréfenté lé plàH'du tnoitVcmenh A eft la
grande roue qu. porte le.tambour ou cylindre, lequel
eft entoure pat îa cordé qui porté fe pàlda qui fait
marcher la pendule: çe iÿlihdreéft v&cA pbffpeétiv e ,
L a ^ g . ■ fepréféftte la r é ie A v i e en plan', avec 1e
“ 5 dc lcn chqu«age que doit former le rochet G du
tambour ou cylindre. Pour cet effet, l’axé du cylindre
entre dans le trou qui eft au centre de cette rouc, & le
M H j m W m m dans une rainure
faï e Paf le jeu de l’encliquetage la roue & Je
cylindre peuvent tourner féparément l’un de l’autre lorfi
qu on remonte le poids, comme on l’a déjà expliqué.
Nous n avons reprefentc ici cette partie que pour- en
mieux foire voir la difpofiiion. La fig . g. èft ce qu’on
à retenir Ôc afiémblerlaroue,
fige 7- Sc le cylindre y fig . 6. *
H t t o » jours i foire urié révolution,
cc,qu il eft aile dc voir par fe nombre de dents
des roues, dont la dermere E eft celle dechappeftient
& fait un tour par minute. " >