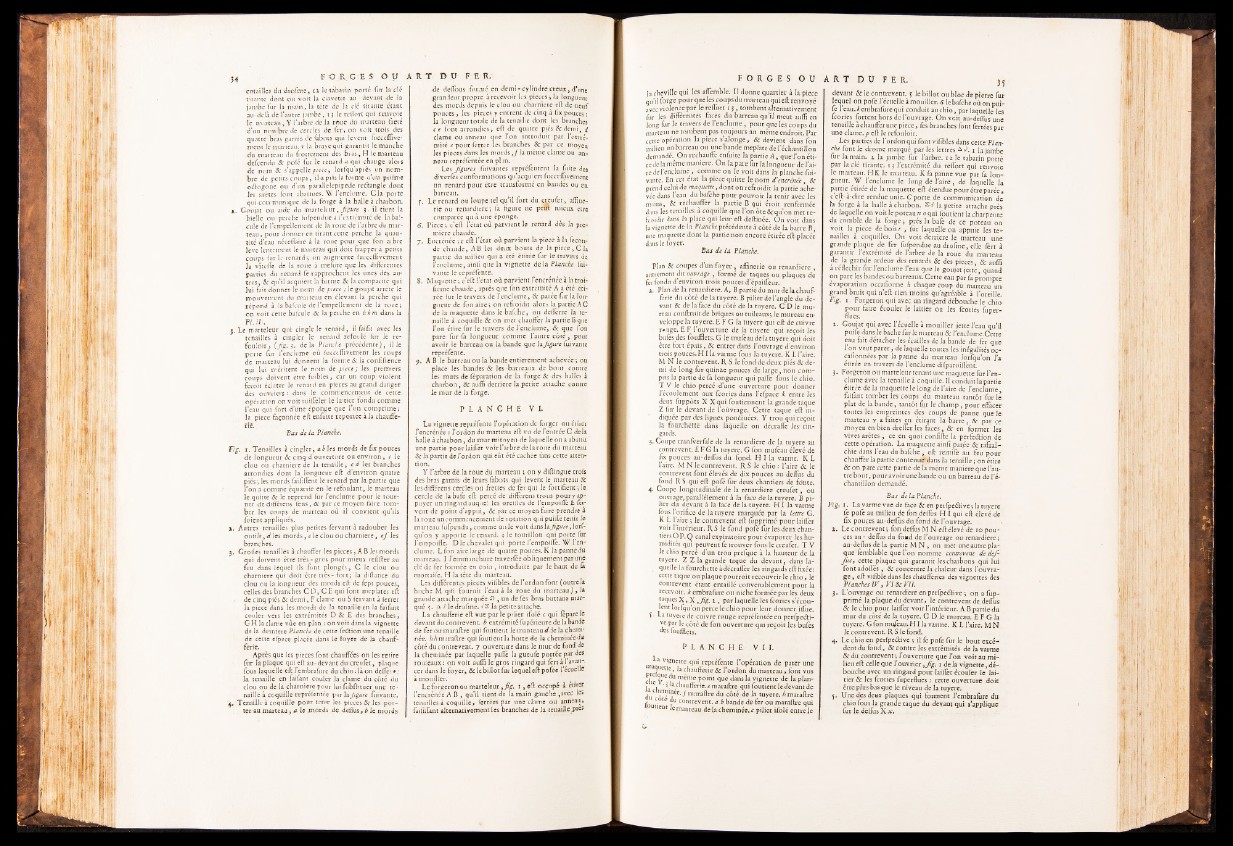
entailles du 'drofme, i 1 le tabavin porté fur la clé
tirante dont on voit la clavette au - devant .de la
jambe fur la main, la tête de la clé tirante étant
au-delà de l’autre jambe, 13 le rellort qui renvoie
le marteau, Y l’arbre de la roue du marteau frété
d’un nombre de cercles de 1er, on voit trois des
quatre bras garnis de fabots qui lèvent fuccéflive-
ment le marteau, v la brayequi garantit le manche
du marteau du frottemenc des bras, H le marteau
defeendu 8c polé fur le renard a qui change alors
de nom 8c s’appelle pièce, lorfqu’après un nombre
de petits coups, il a pris la foi me ci’uu prifme
oétogone ou d’un parallclepipede reétangle dont
les arêtes font abattues. "W l’enclume. C ia poite
qui communique de la forge à la halle à charbon.
i . Goujat ou aide du marteleur, figure 3. il tient la
bielle ou perche fufpendue à l'extrémité de labaf-
cule de l’cmpellement de Ja roue de l’arbre du marteau,
pour donner en tirant cette perche la quantité
d’eau néceflàire à la roue pour que (on aibrc
leve lentement le marteau qui doit frapper à petits
coups fur le renard ; on augmente fucceffivement
la vîteflé de la roue à mefure que les differentes
parties du renard fe rapprochent les unes des autres,
8c qu’il acquiert la forme 8c la compacité qui
lui frit donner le nom de puce ; le goujat arrête le
mouvement du matteau en élevant la perche qui
répond à la bafcule de l’cmpellement de la roue;
on voit cette bafcule & la perche en hkm dans la
Pl. !Ii.
j . Le marteleur qui cingle le renard, il faifit avec les
tenailles à cingler le renard refoulé fur Je re-
foulo ir, (fig. J. delà Planche précédente), il Je
perte fur l’enclume où fucceffivement les coups
de marteau lui donnent la forme & la confiftence
qui lui méritent le nom de pièce j les premiers
coups doivent être foibles, car un coup-violent
feroit éclater le renard en pièces au grand danger
des ouvriers : dans le commencement de cette
opération on voit ruiflèler le laitier tondu comme
l’eau qui fort d’une éponge que l’on comprime;
la piece façonnée eft enfuite reportée à la chaufferie.
Bas de la Planche.
Fig. i . Tenailles à cingler, a b 1rs mords de fix pouces
de longueur & c in q d’ouverture ou environ, c le
clou ou charnière de Ja tenaille, c d les branches
arrondies dont la longueur eft d’environ quatre
piés ; les mords faififfent le renard par la partie que
l’on a comme équarrie en le refoulant, le marteau
le quitte 8c le reprend fur l’enclume pour le tourner
de différens fens, 8c par ce moyen faire tomber
les coups de marteau où il convient qu’ils
(oient appliqués.
î . Autres tenailles plus petites fervant à radouber les
outils, d les mords, e le clou ou charnière, e j'le s
branches.
3. Grolles tenailles à chauffer les pièces, A B les mords
qui doivent être très - gros pour mieux refifter au
feu dans lequel ils font plongés, C le clou ou
charnière qui doit être très - fo rt; la diftance du .
clou ou la longueur des mords eft de.fept pouces,
celles des branches C D, C E qui font méplates eft
de cinq piés & demi, F clame ou S fervant à ferrer
la piece dans les mords de la tenaille en la faifànt
couler vers les extrémités D & E des branches,
G H la clame vue en plan : on voit dans Ja vignette
de la derniere Planche de cette feélion une tenaille
de cette cfpece placée dans le foyer de la chaufferie.
Après que les pièces font chauffées on les retire
for la plaque qui eft au-devant du creufèt, plaque
fous laquelle eft l’embrafure du chio: là on d effet •
la tenaille en faifant couler la clame du côté du .
clou, ou de la charnière pour lui fubftttuer une te naille
à coquille reprélèntée par lafigure fuivante.
4. Tenaille à coquille pour tenir les pièces 8c les porter
au marteau, a le mords de deffus, b le mords
de defioüs formé en demi - cylindre creux, d’une
grandeur propre à recevoir les pièces; la longueur
des mords depuis le clou ou charnière eft de neuf
pouces, les pièces y entrent de cinq à fix popces:
la longueur totale de la tenaille dont les branches
c e font arrondies, eft de quatre piés 8c demi, d
clame ou anneau que l’on introduit par l’extrémité
e pour ferrer les branches 8c par ce moyen
les pièces dans les mords , J la même clame ou anneau
repréfentée en plan. ■
Les figures fuivantes repréfèntent la fuite des
diverfes conformations qu’acqu’ert fucceffivement
un renard pour être transformé en bandes ou en
barreau.
j . Le renard ou loupe tel qu’il fort du creufet, affine-i
rie ou renardière; fa figure ne peut mieux être
comparée qu à une éponge.
6. Piece ; c’eft l’état où parvient le renard dès la première
chaude.
7 . Encrénée ; c eft l’état où parvient la piece à la fecon-,
de chaude, AB les deux bouts de Ja piece. C ia
partie du milieu qui a été étirée fur le travers de
l’enclume, ainfï que la vignette de la Planche fuivante
le repréfente.
8. Maquette ; c’eft l’état où parvient l’encrénée à la troifieme
chaude, après que fon extrémité A a été étirée
fur le travers de l’enclume, & parée fur la longueur
de fon aire; on refroidit alors la partie A C
de la maquette dans le bafehe, on defTerre la tenaille
à coquille & on met chauffer la partie B que
l’on étire fur le travers de l ’enclume, 8c que l’on
pare fur fa longueur comme l’autre cô té , pour
avoir le barreau ou la bande que la figure fuivante
repréfente.
p. A B le barreau ou la bande entièrement achevée ; on
place les bandes & les barreaux de bout contre
les murs de féparation de la forge 8c des halles à
charbon, & aufii derrière la petite attache contre
le mur de la forge.
P L A N C H E V I .
La vignette repréfente l’opération de forger ou étirer
l’encrénée : l’ordon du marteau eft vu de l’entrée C delà
halle à charbon, du mur mitoyen de laquelle on a abattu
une partie pour laiffer voir l’arbre de là roue du marteau
8c la partie de l’ordon qui eut été cachée lâns cette attention.
Y l’arbre de la roue du marteau ; on y diftinguc trois
des bras garnis de leurs frbots qui lèvent le marteau &
les différens cercles ou frettes de fer qui le fortifient ; le
cercle de labafe eft percé de différens trous pour y appuyer
un ringard auquel les oreilles de l’empoifïè E fervent
de point d’appui, & par ce moyen faire prendre à
la roue uncommencement de rotation qui puiflè tenir le
marteau fufpendu, comme on le voit àxnsh figure
qu’on y apporte le renard. 3 le tourillon qui porte fur
J’empoiffc. D le chevalet qui porte l’empoiffe. W l’enclume.
Lfon aire large de quatre pouces. K la panne du
marteau. I l’emmanchure traverfëe obliquement par une
clé de fer formée en coin , introduite par le haut de fa
mortaife. H la tête du marteau.
Les différentes pièces vifibles del’ordonfont (outre la
huche M qui fournit l’eau à la roue du marteau ) , la
grande attache marquée £ ) , un de (es bras buttans marqué
f . a J 'le drofme. -j'2 la petite attache.
La chaufferie eft vue par le pilier ifolé c qui fepare le
devant du contrevent, b extrémité fupérieure de la bande
de fer ou maraftre qui foutient le manteau d de la chenu*
née. h h maraftre qui foutient la hotte de la cheminée du
côté du contrevent. 7 ouverture dans le mur de fond de
la cheminée par laquelle paffe la gueufe portée par des
rouleaux : on voit auffi le gros ringard qui fertà l’avan-.
cer dans le foyer, & le billot fur lequel eft pofee l’écuelle
à mouiller. . m
Le forgeron ou marteleur, fig. 1 , eft occupé à etirer
l’encrénée A B , qu’il tient de la main gauche »avec les
tenailles à coquille, ferrées par une dame ou anneau,
faififfant alternativement les branches de la tenaille .près
la cheville qui les aflèmble. Il donne quartier à la piece
qu’il forge pour queles coups du marteau qui eft renvoyé
avec violence par lereffort 1 3 , tombent alternativement
fur les différentes faces du barreau qu’il meut auffi en
long fur le travers de l’enclume, pour queles coups du
marteau ne tombent pas toujours au même endroit. Par
cette opération la piece s’alonge, & devient dans fon
milieu un barreau ou une bande méplate de l’échantillon
demandé. On rechauffe enfuite la partie A , qucTon étire
de la même maniéré. On la pare fur la longueur de l’aire
de l’enclume , comme on le voit dans la planche fuivante.
En cet état la piece quitte le nom d'encrénée, &
prend celui de maquette, dont on refroidit la partie achevée
dans l'eau du bafehe pour pouvoir la tenir avec les
mains, 8c rechauffer la partie B qui étoit renfermée
dans les tenailles à coquille que l’on ôte & qu’on met refroidir
dans la place qui leur eft deftinée. On voit dans
la vignette de la Planche précédente à côté de la barre B
une maquette dont la partie non encore étirée eft placée
dans le foyer.
Bas de la Planche.
Plan 8c coupes d’un fo y e r , affinerie ou renardière ,
autrement dit ouvrage , formé de taques ou plaques de
fer fondu d’environ trois pouces d’épaiffeur.
a. Plan de la renardicre. A, B partie du mur de la chaufferie
du côté de la tuyere. B pilier de l’angle du devant
8c de la face du côté de la tuyere. C D le mu-
reau conftruit de briques ou tuileaux; le mureau enveloppe
la tuyere. E F G la tuyere qui eft de cuivre
r*uge. E F l’ouverture de la tuyere qui reçoit les
bufès des foufflets.G le mufèau de la tuyere qui doit
être fort épais, 8c entrer dans l’ouvrage d’environ
trois pouces. H I la varme fous la tuyere. K L l’aire.
M N le contrevent. R S le fond de deux piés 8c demi
de long fur quinze pouces de large, non compris
la partie de fà longueur qui paffe fous le chio.
T V le chio percé d’une ouverture pour donner
l’écoulement aux feories dans l’efpace k entre les
deux fuppôts X X q u i foutiennent la grande taque
Z fur le devant de l’ouvrage. Cette taque eft indiquée
par des lignes ponétuées. Y trou qui reçoit
la fourchette dans laquelle on décraffe les-ringards.
3. Coupe tranfverfàlc de la renardière de la tuyere au
contrevent. E F G la tuyere. G fon mufèau élevé de
fix pouces au-deffus du fond. H I la varme. K L
l’aire. M N le contrevent. R S le chio: l’aire & le
contrevent font élevés de dix pouces au-deffus du
fond R S qui eft pofé fur deux chantiers de fonte.
4. Coupe longitudinale de la renardière creufet, ou
ouvrage, parallèlement à la face de la tuyere. B pilier
du devant à la face de la tuyere. H I la varme
fous l’orifice de la tuyere marquée par la lettre G.
K L l’aire ; le contrevent eft fupprimé pour laiffer
voir l’intérieur. R S le fond pofé fur les deux chantiers
O P. Q canal expiratoire pour évaporer les humidités
qui peuvent fè trouver fous le creufet. T V
le chio percé d’un trou prefque à la hauteur de la
tuyere. Z Z la grande taque du devant, dans la-
„ Quelle la fourchette à décraflèr les ringards eft fixée:
cette taque ou plaque pourroit recouvrir le chio, le
contrevent étant entaillé convenablement pour la
recevoir, k embrafurc ou niche formée par les deux
taquesX, X ,fig. z , par laquelle les feories s’écoulent
lorfqu’on perce le chio pour leur donner iffue.
f . La tuyere de cuivre rouge repréfentée en perfpcéfci-
ve par le côté de fon ouverture qui reçoit les bufès
de s foufflets.
P L A N C H E V I I .
maif V*gnette §Sj] repréfènte l’opération de parer une
guette, la chaufferie 8c l’ordon du marteau, font vus
chc 1 m®me P ° ‘ nt que dans la vignette de la plan-
, V - f . 1*chauffe rie.e maraftre qui foutient ledevant de
du * ° 'Ij ec’ S tuaraffre du côté de la tuyere. A maraftre
fout ° tC 1U contrcvcnt- a b bande de fer ou maraftre qui
ICBt manteau de la cheminée, c pilier ifolé entre le
devant 8c le contrevent. f le billot ou bloc de pierre fur
lequel on pofe lecuelle à mouiller, 6 le bafehe où on ptti-
fè l’eau, fembrafure qui conduit au chio, par laquelle les
feories fortent hors de l’ouvrage. On voit au-deffus une
tenaille à chauffer une piece, fes branches font ferrées par
une clame, p eft le refouloir.
Les parties de l’ordon qui font vifibles dans cette Planche
font le drome marqué par les lettres A J'. 1 ja jambe
fur la main, z la jambe fur l’arbre. 1 1 le tabarin porté
par la clé tirante. 13 l’extrémité du reffort qui renvoie
le marteau. H K le marteau. K fa panne vue par fa longueur.
W l’enclume le long de l’aire , de laquelle la
partie étirée de la maquette eft étendue pour être parée,
c eft-a-dire rendue unie. C porte de communication de
la forge à la halle à charbon. E J 'la petite attache près
de laquelle on voit le poteau n oqui foutient la charpente
du comble de la forge ; près la bafe de ce poteau on
voit la piece de bois r , fur laquelle on appuie les tenailles
a coquilles. On voit derrière le marteau une
grande plaque de fer fufpendue au drofme, elle fèrt à
garantir l’extrémité de l’arbre de la roue du marteau
de la grande ardeur des renards & des pièces, & aufii
à réfléchir fur l’enclume l’eau que le goujat jette, quand
on pare les bandes ou barreaux. Cette eau par fà prompte
évaporation occafionne à chaque coup du marteau un
grand bruit qui n’eft rien moins qu’agréable à l’oreille.
Fig. 1. Forgeron qui avec un ringard débouche le chio
pour faire écouler le laitier ou les feories fuper-
flues.
i . Goujat qbi avec lecuelle à mouiller jette l’eau qu’il
puife dans le bâche fur le marteau 8c l'enclume. Cette
eau frit détacher les écailles de la bande de fer que
l’on veut parer, de laquelle toutes les inégalités oc-
cafionnées par la panne du marteau lorfqu’on l’a
étirée en-travers de l’enclume difparoiflènt.
3. Forgeron ou marteleur tenant une maquette fur l’enclume
avec la tenaille à coquille.il conduit la partie
étirée de la maquette le long de l’aire de l’enclume
faifant tomber les coups du marteau tantôt fur le
plat de la bande, tantôt fiir le champ , pour effacer
toutes les empreintes des coups de panne que le
marteau y a faites en étirant la barre, 8c par ce
moyen en bien dreffer les free s, 8c en former les
vives arêtes , ce en quoi confifte la perfeétion de
cette opération. La maquette ainfi par.ée & rafraîchie
dans l’eau du bafehe, eft remifè au feu pour
chauffer la partie contenu^dans la tenaille ; on étire
& on pare cette partie de la même maniéré que l’autre
bout, pour avoir une bande ou un barreau d el’ér
chantillon demandé.
Bas de la Planche.
Fig. 1 . La varme vue de free 8c en perfpeéHve ; la tuyere
fe pofè au milieu de fon deffus H I qui eft élevé de
fix pouces au-deffus du fond de l’ouvrage.
1 . Le contrevent ; fon deffus M N eft élevé de ro pouces
au - deffus du fond de l’ouvrage ou renardière ;
au-deffus de la partie M N , on met une autre plaque
fèmblable que l’on nomme contrevent de défi-
Ju s , cette plaque qui garantit les charbons qui lui
font adoffés , 8c concentre la chaleur dans l’ouvrage
, eft vifible dans les chaufferies des vignettes des
Planches IV , VI 8c VIL
3 . L ’ouvrage ou renardière en perfpeéHve ; on a fupprimé
la plaque du devant, le contrevent de deffus
& le chio pour laiffer voir l’intérieur. A B partie du
mur du côté de la tuyere. C D le mureau. E F G la
tuyere. G fon mufèau. H I la yarme. K L l’aire. M N
le contrevent. R S le fond.
4. Le chio en perfpeéHve ; il fè pofè fur le bout excédent
du fond, 8c contre les extrémités de la varme
& du contrevent ; l’ouverture que l’on voit au milieu
eft celle que l’ouvrier ,fig . 1 de la vignette, débouche
avec un ringard pour laiflèr écouler le laitier
8c les feories fuperflues : cette ouverture doit
être plus bas que le niveau de la tuyere.
f. Une des deux plaques qui forment l’embrafiire du
chio fous la grande taque du devant qui s’applique
fur le deffus X x .