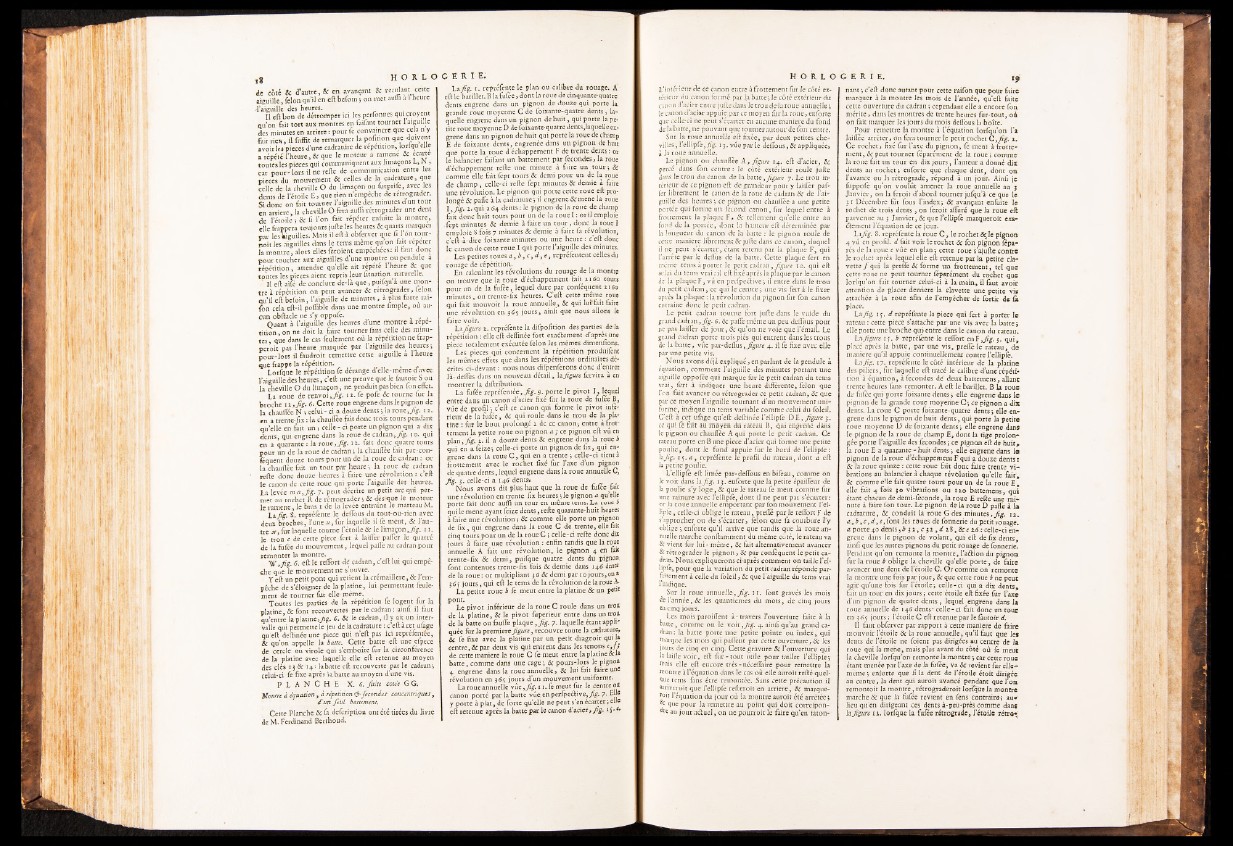
, j H O R L O
de côté & d’autre, & eh avançant 8c reculant cette
aiguille, félonquil en c ftbefoin; on met aum a» heure
4’aiguille des heures.
Il eft bon de détromper ici les perfonnes qui croyent
qu’on fait tort aux montres en faifant tourner 1 aiguille
des minutes en arriéré : pour fe convaincre que cela n y
•fait rien, il fuffit de remarquer la pofition que doivent
avoir les pièces d’une cadrature de répétition, torlqu elle
a répété l’heure, & que le moteur a ramene & écarté
toutes les pièces qui communiquent aux limaçons L, IN >
car pour-lors il ne refte de communication entre les
pièces du mouvement & celles de la cadrature, que
celle de la cheville O du limaçon ou furprile, avec les
dents de l'étoile E , que rien n’empêche de rétrograder.
S i donc on fait tourner l’aiguille des minutes d un tour
en arriéré | la cheville O fera aufli rétrograder une dent
de l’étoile ; & fi l’on fait répéter enfuite la montre,
elle frappera toujours jufte les heures & quarts marques
par lcsàiguillcs. Mais il eft à obferver que li l ôn tour-
noit les aiguilles dans le tems même qu’on fait repeter
la montre, alors elles feraient empêchées; il faut donp
pour toucher aux aiguilles d’une montre ou pendule a
répétition, attendre quelle ait répété l’heure & que
toutes les pièces aient repris leur fituation naturelle.
‘ Il eft aifé de conclure de-là que,puifqu’à une montre
à répétition on peut avancer & rétrograder, félon
qu’il eft befoin, l’aiguille de minutes, à plus forte rai-
fon cela eft-il poffible dans une montre fimple, où aucun
obftade ne s’y oppofe. x , ,
Quant à l’aiguille des heures dune montre a répétition
, on ne doit la faire tourner fans celle des minutes
, que dans le cas feulement où la répétitipn ne frap-
peroit pas l’heure marquée par l’aiguille des^ heures ;
pour-lors il faudrait remettre cette aiguille a 1 heure
que frappe la répétition.
Lorfque le répétition fe dérangé d elle-meme davec
l’aiguille des heures, c’ eft une preuve que le fautoir S o u
la cheville O du limaçon, ne produit pas bien fon effet.
La roue de renvo i,fig. 12 . fe pofe 6c tourne fur la
broche 1 1 ,f ig . (S. Cette roue engrène dans le pignon de
la chauffée N ; celui - ci a douze dents -, la roue, fig. i z.
en a trente-fix: la chauffée fait donc trois tours pendant
quelle en frit un * celle - ci porte un pignon qui a dix
dents, qui engrene dans la roue de cadran, fig. 10. qui
en a quarante : la rout , f ig . 12 . fait donc quatre tours
pour un de la roue de cadran -, la chauffée fait par-con-
fequent douze tours pour un de la roue de cadran : or
la chauflée fait un tour par heure ; la roue de cadran
refte donc douze heures à faire une révolution : c’eft ,
le canon de cette roue qui porte l’aiguille des heures.
La levée /n n ,fig . 7. peut décrire un petit arc qui per- j met au rochet R de rétrograder ; & dès que le moteur ;
le ramene, le bras 1 de la levée entraîne le marteau M. ;
La fig. S. repreiente le deffous du tout-ou-rien avec !
deux broches, l’une u , fur laquelle il fe meut, 8c l’au- ;
tre * , fur laquelle tourne l’étoile & le limaçon ,fig . 1 1. |
le trou c de cette pièce.-fert à laiffer paffer le quarré
de la fufée du mouvement, lequel paffe au cadran pour
remonter la montre. , .
^ , fig . 6. eft le reffbrt d é cadran, c eft lui qui empe-
she que le mouvement ne s’ ouvre.
Y eft un petit pont qui retient la crémaillère, & l’em-
pcche de s’éloigner de la platine, lui permettant feulement
de tourner fur elle-même.
Toutes les parties de la répétition fe logent fur la
platine, & font recouvertes par le cadran : ainfi il faut
qu’entre la platine,fig . 6. & le cadran, il y ait un intervalle
qui permette le jeu de la cadrature : c eft a cet ufàge
qu eft deftinéeune piece qui n’eft pas ici repréfentée,
& qn’on appelle la batte. Cette batte eft une efpece
de cercle ou virole qui s’emboîte fur la circonférence
de la platine avec laquelle elle eft retenue au moyen
des clés 15 & 14 : la batte eft recouverte par le cadran;
celui-ci fe fixe après la batte au moyen d’une vis.
P L A N C H E X . 6. fuite cotée G G.
Morvre à équation, à répétition & fécondés concentriques ,
d'un feu l battement.
Cette Planche 6c fr deferiptiou ont été tirées du livre
de M. Ferdinand Berthoud.
G E R I E.
L a fig . 1. reprefente le plan ou calibre du rouage. A
eft le barillet. B la fufée, dont la roue de cinquante-quatre
dents engrene dans un pignon de douze qui porte la
grande roue moyenne C de foixante-quatre dents, laquelle
engrene dans un pignon de huit, qui porte la petite
roue moyenne Dde foixante-quatre dents, laquelle engrene
dans un pignon de huit qui porte la roue de champ
E de foixante dents, engrenée dans un pignon de huit
que porte la roue d’cchappement F de trente dents : or
le balancier faifant un battement par fécondes, la roue
d’échappement refte une minute à faire un tou r; 6i
comme elle fait fept tours & demi pour un de la roue
de champ, celle-ci refte fept minutes & demie à faire
une révolution. Le pignon qui porte cette roue eft prolongé
& paffe à la cadrature ; il engrene & mene la roue
I ,fig . z. qui a 64 dents : le pignon de la roue de champ
fait donc huit tours pour un de la roue I : or il emploie
. fept minutes & demie à faire un tou r, donc la roue I
emploie 8 fois 7 minutes 6c demie à faire fa révolution,
c’ eft-à-dire foixante minutes ou une heure: c’eft donc
le canon de cette roue I qui porte l’aiguille des minutes.
Les petites roues a , b , c, d , e , repréfentent celles du
rouage de répétition.
En calculant les révolutions du rouage de la montre
on trouve que la roue d’échappement fait 1 16 0 tours
pour un de la fufee, lequel dure par confisquent 1160
minutes , ou trente-fix heures. C ’eft cette même rouç
qui fait mouvoir la roue annuelle, 8c qui luf-fait faire
une révolution en 36 j jours, ainfi que nous allons le
faire voir. _ '
Lu figure 1 . repréfênte la difpofîtion des parties de la
répétition : elle eft deffinée fort exa&ement d’après une
piece totalement exécutée félon les mêmes dimenfions.
Les pièces qui concernent la répétition produifent
les mêmes effets que dans les répétitions ordinaires décrites
ci-devant : nous nous difpcnfèrons donc d entrée
là-deflùs dans un nouveau détail, la figure fervira à en
montrer la diftribution.
La fufée repréfentée, f ig . 9. porte le pivot I , lequel
entre dans un canon d’acier fixé fur la roue de fufée B,
viie de profil ; c’eft ce canon qui forme le pivot inférieur
de la fufee, & qui roule dans-le trou de la platine
: fur le bout prolongé z de ce canon, entre à frottement
la petite roue ou pignon a j ce pignon eft vu en
p la n ,/g . z. il a douze dents & engrene dans la roue b
qui en a féize; celle-ci porte un pignon de fix , qui engrene
dans la ro u e C , qui en a trente ; cçlle-ci tient à
frottement avec le rochet fixé fur l’axe d’un pignon
de quatre dents, lequel engrene dans la roue annuelle C,
fig . 3. celle-ci a 14 6 dents*
Nous avons dit plus haut que la roue de fufee fait
une révolution en trente fix heures; le pignon a quelle
porte fait donc auffi un tour en même tems. L a roue b
qui le mene ayant feize dents, refte quarante-huit heures
à faire une révolution ; 6c comme elle porte un pignon
de f ix , qui engrene dans la roue C de trente, elle fait
cinq tours pour un de la roueC ; celle-ci refte donc dix
jours à faire une révolution : enfin tandis que la roue
annuelle A fait une révolution, le pignon 4 en fait
trente-fix & demi, puifque quatre dents du pignon^
font contenues trente-fix fois 6c demie dans 14 6 dents
de la roue : or multipliant 3 6 6c demi par 1 o jours, on a
3<>ï jours, qui eft le tems de la révolution de la roue A.
La petite roue b fe meut entre la platine 6c un petit
pont.
Le pivot inférieur de la roue C roule dans un trou
de la platine, & le pivot fuperieur entre dans un trou
de la batte ou fauffe plaque ,f ig . 7. laquelle,étant appliquée
fur la première figure, recouvre toute la cadrature,
& fe fixe avec la platine par un petit drageoir qui J*
centre, & par deux vis qui entrent dans les tenons «,ƒ/
de cette manière la roue C fe meut entre la platine
batte, comme dans une cage ; & pours-lors le pignon
4 engrene dans la roue annuelle, & lui fait faire une
révolution en 36$ jours d’un mouvement uniforme.
La roue annuelle v u e ,/ g . 1 i.femeut fur le centre oïl
canon porté par la batte vûeenperfpedtive, fig. 7- Eue
y porte à plat, de forte quelle ne peut s’en écarter ; elle
eft retenue apres la batte par le canon d’a c ie r ,/ g . i f *St
H O R L O
L’intérieur de ce canon entre à frottement fur fe côté extérieur
du canon formé par l.a batte ; le côté extérieur du
canon d’acier entre jufte dans le trou de la roue annuelle ;
le canon d’acier appuie,par ce moyen fur la roue, énfbrte
que celle-ci ne peut s’écarter en aucune maniéré du fond
de la barre, ne pouvant que tourner autour de fon centre.
Sur la roue annuelle eft fixée, par deux petites chevilles,
l’ellipfe, fig. 13 . vue par le deffous, 6c appliquée,
à la roue annuelle.
Le pignon ou chauffée A , figure 14 . eft d’acier, 6c
percé dans fon centre: le côté extérieur roule jufte
dans le trou du canon de la batte, figure 7. Le trou intérieur
de ce pignon.eft de grandeur pour y laiffer paffer
librement le canon de la roue de cadran 6c de l ’aiguille
des heures ; ce pignon ou chaufîee a une petite
portée qui forme un fécond canon, fur lequel entre à
frottement la plaque F , & tellement quelle entre au
fond de la portée, dont la hauteur eft déterminée par
la longueur du canon cte la ba,tte : le pignon .roule de
cette maniéré librement 6c jufte d^ns ce canon, duquel
il ne peut s’écarter, étant retenu par la plaque F , qui
l’arrête par le deffus de la batte. Cette plaque fert en
meme tems à porter le petit cadran, figure 10 . qui eft
celui du tems vrai : il eft fixé après la plaque par le canon
de la plaque F , vu en perfpeéiive; il entre dans le trou
du petit cadran, ce qui le centre ; une vis fert à le fixer
après la plaque : la révolution du pignon fur fon canon
cnrraine donc le petit cadran.
Le petit cadran tourne fort jufte dans le vuide du
grand cadran, fig. 6. 6c paffe même un peu deffous pour
ne pas laiffer de jo ur, 6c qu’on ne voie que l’émail. Le
grand cadran porte troispiés qui entrent dans les trous
de la batte, vue par-deffus,/gurc 4. il fè fixe avec elle
par une petite vis.
Nous avons déjà expliqué, en parlant de la pendule à
équation, comment l’aiguille des minutes portant une
aiguille oppofée qui marque fur le petit cadran du tems
vrai, fert à indiquer une heure différente, félon que
l’on fait avancer ou rétrograder ce petit cadran, & que
par ce moyen l’aiguille tournant d’un mouvement uniforme,
indique un tems variable Comme celui du fbleil.
C’eft à cet ufàge qu’eft deftinéc l’ellipfe D E , figure 3.
ce qui fè frit au moyen du rateau B , qui engrene dans
le pignon ou chauffée A qui porte le petit cadran. Ce
rateau porte en B une piece d’acier qui forme une petite
poulie, dont le fond appuie fur le bord de l’ellipfè :
la /g. i f . a , repréfente le profil du rateau, dont a eft
la petite poulie.
L’ellipfè eft limée par-deffous en bifeau, comme on
le voit dans la f ig . 13 . enforte que la petite épaiflèur de
la poulie s’y lo g e , 6c que le rateau fe meut comme fur
une rainure avec l’ellipfè, dont il.ne peut pas s’écarter:
or la roue annuelle emportant par fon mouvement l’ellipfe
, celle-ci oblige le rateau, preffe par le reflort F de
s approcher ou de s’écarter, félon que fa courbure l ’y
oblige ; enforte qu’il arrive que tandis que la roue annuelle
marche conftâmment du même, côté, le rateau va
& vient fur lui - même, 6c fait alternativement avancer
& rétrograder le pignon , & par confisquent le petit cadran.
Nous,expliquerons ci-après comment on taille l’ellipfe,
pour que la variation du petit cadran réponde parfaitement
à celle du fo leil, 6c que l ’aiguille du tems vrai
l’indique.
Sur la roue annuelle, f ig . 1 1 . font gravés les mois
de l’année, & les quantièmes du mo is , de cinq jours
en cinq jours.
Les mois paroiffent à-travers l’ouverture faite à la
bâtie, comme on le voit ,fig . 4. ajnfi qu’au grand cadran
: la batte porte une petite pointe ou index, qui
marque les mois qui partent par cette ouverture, & les
jours de cinq en cinq. Cette gravure 6c l’ouverture qui
la laiffe v o i r , eft fu r -tou t utile pour tailler l’elliplè;
mais elle eft encore très - néceffairc pour remettre la
montre à l’équation dans le cas où elle aiiroic refté quelque
tems fans être remontée. Sans cette précaution il
arriverait que l’ellipfè refteroit en arriéré, 6c marque-'
ro't l’cquation du jour où la montre auroit été arrêtée ;
y que pour la remettre au point qui doit correfpon-
•e au jour aétuel, on ne pourrait le faire qû’en taton-
G E R I E.
nant ; c’ eft donc autant pour cette raifon que pour faire
marquer à la montre les mois de l’année, qu’eft faite
cette ouverture du cadran ; cependant elle a encore fon
mérite, dans les montres de trente heures fur-tout, où
on fait marquer les jours du mois deffous la boîte.
Pour remettre la montre à l’équation lorfqu’on l’a
lai fiée arrêter, On fera tourner le petit rochet C ,f ig . z .
Ce rochet, fixé fur l’axe du pignon, fè ment à frottement,
& peut tourner féparément de la roue ; comme
la roue fait un tour en dix jours, l’auteur a donné dix
dents au rochet; enforte que chaque dent, dont on
l’avance ou la rétrograde, répond à un jour. Ainfi je
fuppofè qu’on voulût amener la roue annuelle au 3
Jan vie r, on la feroit d’abord tourner jufqu’à ce que le
3 1 Décembre fut fous l’ index ; & avançant enfuite le
rochet de trois dents, on feroit affuré que la roue eft
parvenue au 3 Janvier, & que l’ellipfè marquerait exactement
l’équation de ce jour.
Lafig . 8. repréfente la roue C , le rochet 6c lc pignon
4 vû en profil, d fait voir le rochet & fon pignon firpa-
rés de la roue e vue en plan ; cette roue s’ajufte contre
le rochet après lequel elle eft retenue par la petite clavette
/ q u i la preflè & forme un frottement, tel que
cette roue ne peut tourner féparément du rochet que
lorfqu’on Élit tourner celui-ci à la main, il faut avoir
attention de pjacer derrière la clavette une petite vis
attachée à la roue afin de l’empêcher de fortir de f i
place.
La fig . 1 f. </ repréfênte la piece qui fèrt à porter le
rateau : cette piece s’attache par une vis avec la batte ÿ
elle porte une broche qui entre dans le canon du rateau.
L a figure i f . b repréfênte le reffort en F ,fig . 3. qui,
placé après la batte, par utije vis, preffe le rateau, de
maniéré qu’il appuie continuellement contre l’ellipfè.
La fig. 17 . repréfênte le côté intérieur de la platine
des piliers, fiir laquelle eft tracé le calibre d’une répétition
à équation, à fécondes de' deux battemens, allant
trente heures fans remonter. A eft le barillet. B la roue
de fufée qui porte foixante dents ; clic engrene dans le
pignon de la grande roue moyenne C ; ce pignon a dix
dents. La roue C porte foixante:quatre dents ; elle engrene
dans le pignon de huit dents, qui porte la petite
roue moyenne D de foixante dents ; elle engrene dans
le pignon de la roue de champ E , dont la tige prolongée
porte l’aiguille des fécondés ; ce pignon eft de huit,
la roue E a quarante - huit dents ; elle engrene dans le
pignon de la roue d’échappement F qui a douze dents : 8c la roue quinze : cette roue fait donc Élire trente v ibrations
au balancier à chaque révôlution qu’elle fa it,
& comme elle fait quatre tours pour un de la roue E ,
elle fait 4 fois 30 vibrations ou iz o battemens, qui
étant chacun de demi-féconde, la roue £ refte une minute
à frire fon tour. Le pignon de la roue D paffe à la
cadrature, 6c conduit la roue G des minutes, fig. 12 .
a ,b ,c ,d ,e ,C ont les roues de fonnerie du petit rouage.
a porte40 d e n t s $ i , c , d , 8ce z 5 .-cclle-ci engrene
dans le pignon de volant, qui eft de fix dents,
ainfi que les autres pignons du petit rouage de fonnerie.
Pendant qu’on remonte la montre, l’aétion du pignoa
fur la roue b oblige la cheville qu’elle porte, de frire
avancer une dent de l’ctoile C. Or comme on remonte
la montre une fois par jo ur, & que cette roue b ne peut
agir qu’une fois fur l’étoile; celle-ci qui a dix dents,
fait un tour en dix jours ; cette étoile eft fixée fur l’axe
d’un pignon de quatre dents, lequel engrene dans ia
roue annuelle de 146 dents: c e lle -c i fait donc un tour
en 3 6f jours ; l’étoile C eft retenue par le fautoir d.
Il faut obfèrver par rapport à cette manière de frire
mouvoir l’étoile 6c la roue annuelle, qu’il frut que le*
dents de l’étoile ne foient pas dirigées au centre de la
roue qui la mene, mais plus avant du côté où fè meut
la cheville lorfqu’on remonte la montre ; car cette roue
étant menée par l’axe de la fufee, va & revient fur elle-
même ; enforte que fi la dent de l’étoile étoit dirigée
au centre, la dent qui auroit avancé pendant que l’on
remontoic la montre, rétrograderait lorfqùe la montre
marche & que la fufée revient en fens contraire; au^
lieu qu’en dirigeant ces dents à-peu-près comme dans
la figure 12 . lorfque la fufée rétrograde, l’étoile rétro«