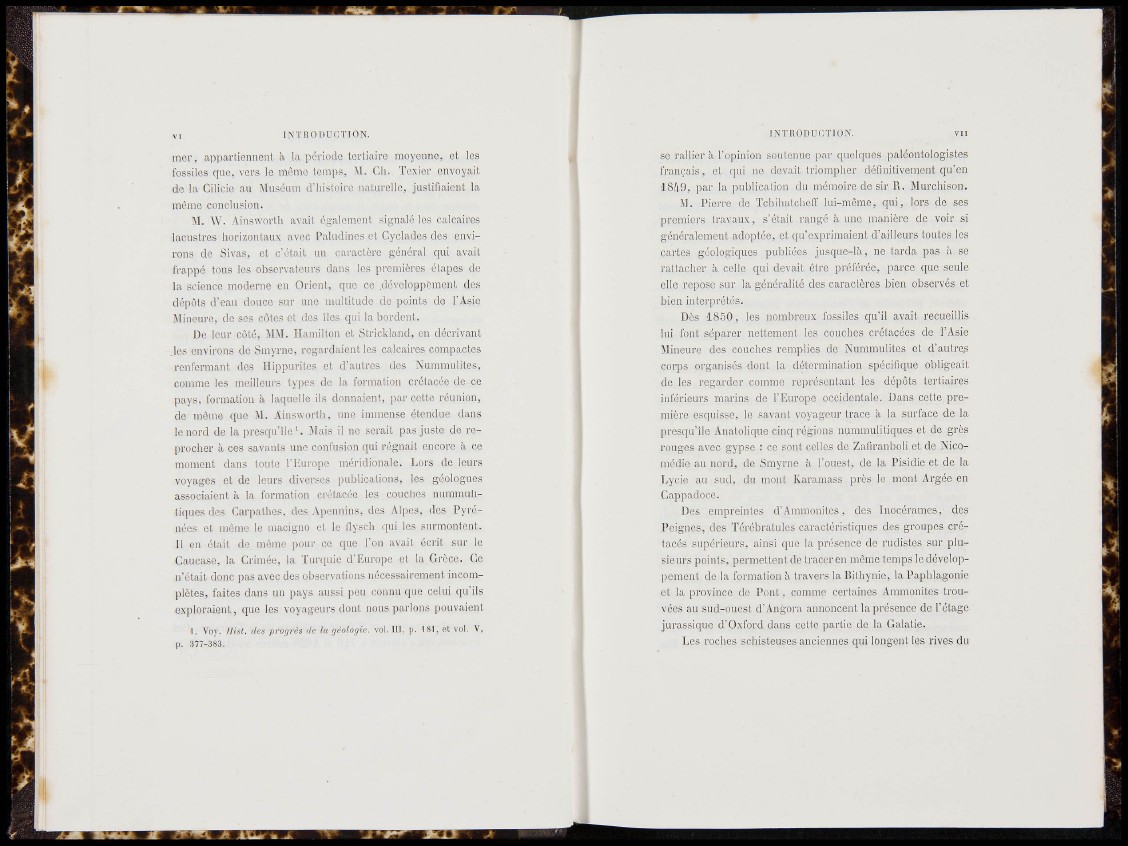
V, INTRODUCT ION.
mer, appartiennent à la période tertiaire moyenne, et les
fossiles que, vers le même temps, M. Ch. Texior envoyait
de la Cilicie au ;\Iuséura d'histoire naturelle, justifiaient la
même conclusion.
W. Ainsworth avait également signalé les calcaires
lacustres horizontaux, avec Paludines et Cyclades des environs
de Sivas, et c'était un caractère général qui avait
frappé tous les observateurs dans les premières étapes de
la science moderne en Orient, que ce .développement des
dépôts d'eau douce sur une nuiltitude de points de l'Asie
Mineure, de ses côtes et des îles qui la bordent.
De leur côté, i\M. Hamilton et Striclcland, en décrivant
.les environs de Smyrne, regardaient les calcaires compactes
renfermant dos llippurites et d'autres des Nummiilites,
comme les meilleurs types de la formation crétacée de ce
pays, formation à laquelle ils donnaient, i)ar cette réunion,
de même que M. Ainsworth, une immense étendue dans
le nord de la presqu'île', liais il ne serait pas juste de reprocher
à ces savants une confusion qui régnait encore à ce
moment dans toute l'Europe méridionale. Lors de leurs
voyages et de leurs diverses publications, les géologues
associaient à la formation crétacée les couches nummulitiques
des Carpathes, des Apennins, des Alpes, des Pyrénées
et même le macigno et le tlysch qui les surmontent.
11 en était de même pour ce que l'on avait écrit sur le
Caucase, la Crimée, la Turquie d'Europe et la Grèce. Ce
n'était donc pas avec des observations nécessairement incomplètes,
faites dans un pays aussi peu connu que celui qu'ils
exploraient, que les voyageurs dont nous parlons pouvaient
I. Voy. nist. des progrés de la géologie, vol. 111, p. 1 81, et vol. V,
p. 377-383.
INTIiODUCTIÛN. VII
se rallier à l'opinion soutenue par quelques paléontologistes
français, et qui ne devait triompher définitivement qu'en
1819, par la publication du mémoire de sir R. Murchison.
Si. Piei-re de Tchiliatchcff lui-même, qui, lors de ses
premiers travaux, s'était rangé à une manière de voir si
généralement adoptée, et qu'exprimaient d'ailleurs toutes les
cartes géologiques publiées jusque-là, ne tarda pas à se
rattacher à celle qui devait être préférée, parce que seule
elle repose sur la généralité des caractères bien observés et
bien interprétés.
Dès 1850, les nombreux fossiles qu'il avait recueillis
lui font séparer nettement les couches crétacées de l'Asie
¡Mineure des couches remplies de Nummulites et d'aulre.s
corps organisés dont la détermination spécificiue obligeait
de les regarder comme représentant les dépôts tertiaires
inférieurs marins de l'Europe occidentale. Dans cette première
esquisse, le savant voyageur trace à la surface de la
presqu'île Anatolique cinq régions nummuliliques et de grès
rouges avec gypse : ce sont celles de Zafiranboli et de Nicomédie
au nord, de Smyrne à l'ouest, de la Pisidie et de la
Lycie au sud, du mont Karamass près le mont Argée en
Cappadoce.
Des empreintes d'Ammonites, des Inocérames, des
Peignes, des Térébratules caractéristiques des groiqies crétacés
supérieurs, ainsi que la présence de rudistes sur plusieui's
points, permettent de tracer en môme temps le développement
de la formation à travers la Bithynie, la Paphlagonie
et la province de Pont, comme certaines Ammonites trouvées
au sud-ouest d'Angora annoncent la présence de l'étage
jurassique d'Oxford dans celte partie de la Galatie.
Les roches schisteuses anciennes qui longent les rives du