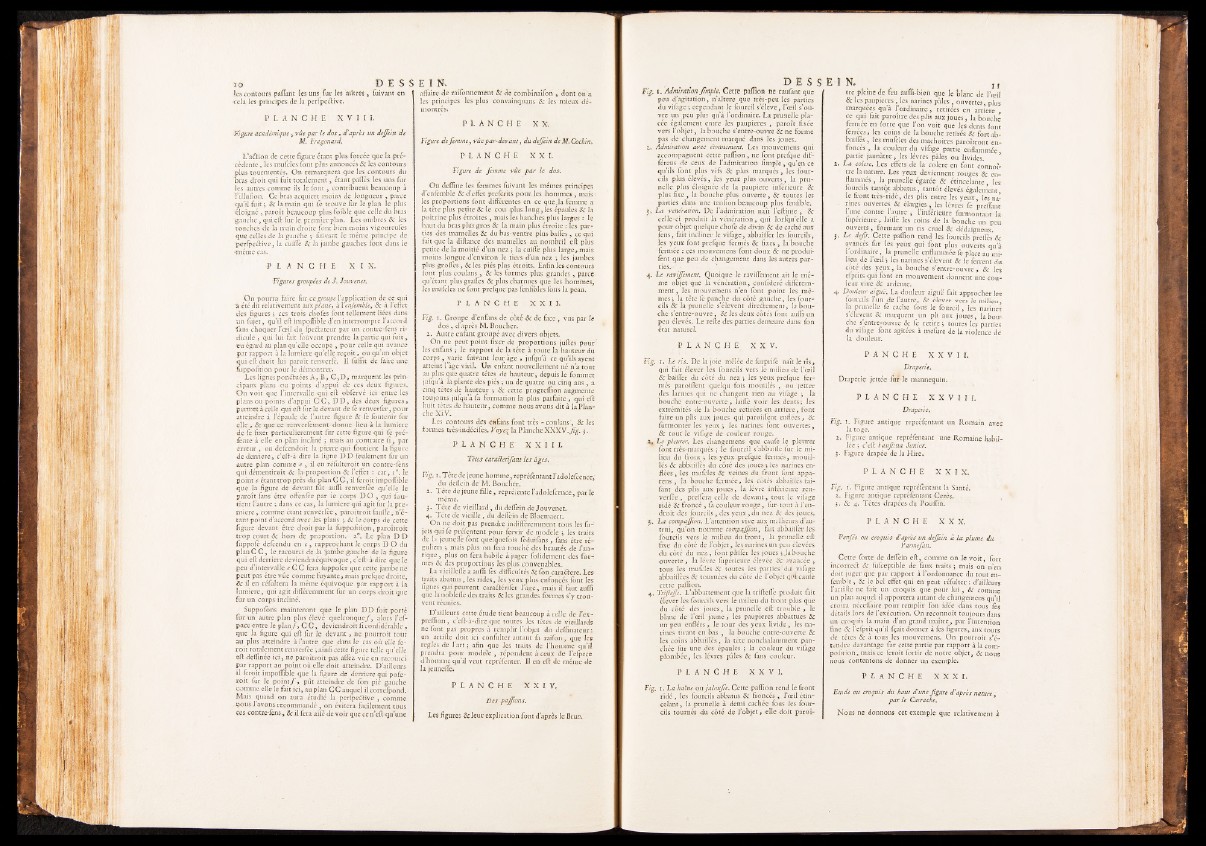
lô D E $ S
•les contours partant les uns fur les àiitres , fiiivant en
-cela les principes de la perfpeétive.
P L A N C H E X V I I E
figure academique > vûe par le dos, d!apres un dejfein 'de
M. Fragonard.
L’aétion de cette figure étant plus forcée que la précédente
, les 'mufcles font plus annoncés 8c les contours '
plus tourmentés. On remarquera que les contours du
bras droit qui fuit totalement, étant pafles les uns finies
autres comme ils le font, contribuent beaucoup à
l’illufion. Ce bras acquiert moins de longueur , parce
qu’il fuit ; 8c la main qui fe trouve fin le plan le plus
éloigné , paroît beaucoup plus foible que celle du bras
gauche , qui eft fur le premier plan. Les ombres 8c les
touches de la main droite font bien moins vigoureufes
que celles de la gauche ; fiiivant le même principe de
perfpeétive, la ciiiflè & la jambe gauches font dans le .
-»même-cas..
P L A N C H E X I X .
Figures groupées de J. Jouvenet.
On pourra faire fur, ce groupe f application dé ce qui
'a été dit relativement aux plans, à l'enfemble, 8c -à l’effet
des figures ; ces trois chofcs font tellement liées dans
un fujet, qu’il eft impoffible d’en interrompre l’accord
fans choquer l’oeil du fpectateur par un contre-fens ridicule
> -qui lui Élit foüvent prendre la partie qui fuit,
eu égard ail plan qu’elle occupe , pour celle qui avance
par rapport à la lumière qu’elle reçoit, ou qu’un objet
qui eft droit lui paroît renverfé. Il fuffit de faire une
fuppofition pour le démontrer.
Les lignesponctuées A , B, C ,D , marquent les principaux
plans ou points d’appui de ces deux figures.
On voit que l’intervalle qui eft obfervé ici entre les
plans ou points d’appui C C , D D , des deux figures,
permet à celle qui eft fur le devant de fe renverfer, pour
atteindre à l’épaule de l’autre figure & fe foutenir fur
elle , & que ce renverfèment donne lieu a là lumière
de fe fixer particulièrement fur cette figure qui fè préfente
à elle en plan incliné ; mais au contraire f i , par
erreur , on defeendoit la pierre qui fbutient la figure
de derrière, c’eft-à-diïe la ligne D D feulement fur un
autre plan comme e , il en réfulteroit un contre-fèns
qui démentiroit 8c la-proportion 8c l’effet : car, i°. le
point e étant trop près du plan C C , il feroit impoffible
que la figure de devant fut auffi renverfée qu’elle le
paroît fans être oftènfee par ie corps D O , qui fou-
tient l’autre ; dans ce cas, la lumière qui agit fur la première
, comme étant renverfée, paroîtroit fauflè, n’étant
point d’accord avec les plans ; 8c le corps de cette
figure devant être droit par la fuppofition, paroîtroit
trop court 8c hors de proportion.- z°. Le plan D D
fuppofé defeendu en e , rapprochant le corps D O du
plan C C , le racourci de la ‘jambe gauche de la figure
qui eft derrière deviendra équivoque, c’eft-à-dire que le
peu d’intervalle e C C fera fuppofer que cette jambe nè
peut pas être vûe comme fuyante, mais prefque droite,
8c il en réfultera la même équivoque par rapport à la
lumière, qui agit différemment fur un corps droit que
fur un corps incliné.
Suppofons maintenant que le plan DD foit porté
fur un autre plan plus élevé quelconque f , alors l’ef-
pace entre le plan ƒ , C C , deviendroit fi confidérable,
que la figure qui eft fur le devant, ne pourroit tout
au plus atteindre à l’autre que dans le cas où elle fe-
roit totalement renverfée ; ainfî cette figure telle qu’elle
eft deffméc ici, ne paroîtroit pas allez vûe en racourci
par rapport an point où elle doit atteindre. D’ailleurs
il feroit impoffible que la figure de derrière qui pofe-
roit fur le point/, pût atteindre de fon pié gauche
comme elle le fait ici, au plan C C auquel il correfpond.
Mais quand on aura étudié la perfpeébive , comme
çous 1 avons recommandé , on évitera facilement tous
çes contre-fèns, 8c il fera aifé de voir que ce n’eft qu’une
1mm
affaire de raifonnemént 8c de combînaifon , dont oii'a
les principes les plus convainquans 8c les mieux démontrés
»
P L A N C H E XX.
Figure de femme, vûe par-devant, du dejfein de M, Cochin»
P L A N C H E XXI .
Figure de femme vûe par le dos-.
On deffine les femmes fuiVant les mêmes principes
d’enfemble & d’effet preferits pour-les hommes , mais-
les proportions font différentes en ce que.la femme a
la tête plus petite 8c le cou plus long-, les épaules 8c la
poitrine plus étroites > mais les hanches plüs larges : le
haut du bras plus gros 8c la main plus étroite : les parties
des mamelles, 8c du bas-ventre plus baffes, ce qui
fait que la diftancc des mamelles aü nombril eft plus
petite de la moitié d’un nez ; la cuiflè plus large, mais
moins longue d’environ le tiers d’ün nez ; les jambes
plus groffes > 8c les piés plus étroits. Enfin les contours
font plus coulans, 8c lès formes plus grandes , parce
qu’étant plus graffes 8c plus charnues que les hommes,
les mufcles ne font prefque pas fenfibles fous la peau»
P L A N C H E X X I L
Fig. i. Groupe d’enfans de côté & de face, vus par le
dos , d’après M. Boucher-.
z. Autre enfant groupé avec divers objets»
On ne peut point fixer de proportions juftes polir*
les enfans ; le rapport de la tête à toute la hauteur du
corps , varie fuivant leur âge , jufqu’à ce qu’ils ayent
atteint l’âge viril. Un enfant nouvellement né n’a tout
au plus que quatre têtes de hauteur, depuis le fommet
jufqu’à la plante des piés. j un de quatre ou cinq ans , a
cinq têtes de hauteur ; 8c cette progrelfion augmente
toujours jufqu’à fa formation la plus parfaite, qui eft
huit têtes de hauteür, comme nous avons dit à la Planche
XIV.
Les contours des enfaiis font très - coulans', & les
formes très-indécifes. Voyei la Planche XXXV. Jîg. 3.
P L A N C H E ' X X I I I .
Têtes caràclerifant les âges*
Fig. 1. Tête de jeune homme, repréfentant fadolefcence,
du deftèin de' M. Boucher.
z. Tête de jeune fille, repréiènte fadolefcence, par le
même.
3 . -Tête dé vieillard, du deftèin de Jouvenet.
4. Tête de vieille, du deftèin de Bloemaert.
On ne doit pas prendre indifféremment tous les lu-
jets qui fe préfentent pour fervir de modèle ; les traits
de la jeuneffe font quelquefois feduifàns , fans être réguliers
; mais plus on fera touché des beautés de l’an-
tique, plus on fera habile à juger foiidemcnt des fort'
mes 8c des proportions les plus convenables..
La vieilleftè a auffi les difficultés & fbn caraétere. Les
traits abattus, les rides, les yeux plus enfoncés font les
figues qui peuvent caraétcrilèr l’âge, mais il faut auffi
que la noblefle des traits 8c les grandes formes s’y trouvent
réunies.
D’ailleurs cette étude tient beaucoup à celle de l’ex-
preffion, c’eft-à-dirc que toutes les têtes de vieillards
ne font pas propres à remplir l’objet du deffinateur :
un artifte doit ici confulter autant fa raifon, que les
réglés de l’art-, afin que les traits de l’homme qu’il
prendra pour modèle , répondent à ceux de l’efpece
d’homme qu’il veut repréfenter. Il en eft de même de
la jeuneffe.
P L A N C H E X X I V ,
Des pajffions.
Les figures & leur explication font d’après le Brun.
D È S S
Fig. t. Admiration Jïmple. Cette paffion ne caufànt que
peu d’agitation, n’altere que très-peu les parties
du vifàge ; cependant le fourcil s’élève, l’oeil s’oii-
vre un peu plus qu’à l’ordinaire. La prunelle placée
également entre les paupières , paroît fixée
vers l'objet, la bouche s’entre-ouvre & ne forme
pas de changement marqué dans les joues.
2» Admiration avec étonnement. Les mouvemens qui
accompagnent cette paffion, ne font prefque différons
de ceux de l’admiration fimple, qu’en ce
qu’ils font plus vifs & plus marqués, les four-
cils plus,élevés, les yeux plus ouverts, la prunelle
plus éloignée de la paupière inférieure &
plus fixe, la bouche plus ouverte, &r toutes les
parties dans une tenfion beaucoup plus fenfîble.
3» La vénération. De l’admiration naît l’eftinle , &
celle-ci produit la vénération, qui lorfqu’elle a
pour objet quelque chofe de divin 8c de caché aux
fens, fait incliner le vifàge, abbaiftèr les fourcils,
les yeux font prefque fermés & fixes , la'bouche
fermee : ces mouvemens font doux 8c ne produi-
fènt que peu de changement dans les autres parties.**'
*
4. Le raviffement. Quoique le raviflèment ait le mê- '
me objet que la vénération, confideré différemment
, les mouvemens n’en font point les mêmes;
la tête fè panche du côté gauche, les four-
cils 8c la prunelle s’élèvent directement, la bou--
che s’entre-ouvre, 8c les deux côtés font auffi un
peu élevés. Le refte des parties demeure dans fon
état naturel.
P L A N C H E X X V .
Fig. -1. Le ris. De la joie mêlée de furprifè naît le ris,
qui fait élever les ' fourcils vers le milieu de l’oeil
8c baiflèr du côté du nez ; les yeux prefque fermés
paroiflènt quelquefois mouillés , ou jetter
des larmes qui ne changent rien au vifàge -, la
bouche entre-ouverte, laiflè voir les dents; les
extrémités de la bouche retirées en arriéré, font
faire un plis aux joues qui paroiftènt enflées, 8c
furmonter les yeux.; les narines font ouvertes,
8c tout le vifàge de couleur rouge.
à. Le pleurer; Les changemens que caufe le pleurer
font très-marqués '; le fourcil s’abbaifle fur le milieu
du front ; les yeux prefque fermés, mouillés
8c abbaiffés du côté des joues ; les narines enflées
, les mufcles 8c veines du front font appa-
rens, la bouche fermée, les côtés abbaiflës tai-
fànt des plis aux joues, la levre inférieure renverfée
, preflera celle de devant, tout le vifàge
ridé 8c froncé , là couleur rouge, fur-tout à l’endroit
des fourcils , des yeux ,du nez §c des joues.
5, La compaffion. L’attention vive aux malheurs d’autrui,
qu’on nomme compajjion, fait abbailler les
foulxils vers le milieu du front, la prunelle eft
fixe du côté de l’objet, les narines un peu élevées
du côté du nez, font pliflèr les joues ; vlâbouche
ouverte, la lèvre fupérieure élevée 8c avancée ,
tous les mufcles 8c toutes les parties'du'^vifàge
abbaiffées & tournées du côté de l’objet qui caufe
cette paffion.
4. Trifieffe. L’abbattement que la trifteffe produit fait
élever les fourcils vers le milieu du front plus que
du côté des joues, la prunelle eft trouble , le
blanc de l’oeil jaune,' les paupières abbattues &
un peu enflées, le tour des yeux livide, les narines
tirant en bas , la bouche entre-ouverte &
les coins abbaiflës, la tête nonchalamment pan-
chée fur une des épaules ; la couleur du vifàge
plombée, les lèvres pâles 8c fàns couleur.
P L A N C H E X X V I .
Fig. 1. La haine ou jaloifîe. Cette paffion rend le front
ridé, les fourcils abbatus & froncés , l’oeil étincelant,
la prunelle à demi cachée fous les four-
çils tournés du côté de l’objet, elle doit paroî-
■ ■ H i tre pleine de feu auffi-bien qtie le blanc de l’oeil
& les paupières , les narines pâles, ouvertes, plus
marquées qu’à l’ordinaire, retirées en arrière ,
ce qui fait paroître des plis aux joues, la bouché
fermée en forte que l’on voit que les dents font
ferrées, les coins de la bouche retirés 8c fort abeilles
-, les mufcles dés mâchoires paroîtront enfonces
, la^ couleur du vifàge partie enflammée
partie jaunâtre, -les lèvres pâles ou livides. *
1. La colere. Les effets.de la colere en font cônnoî*
tre la nature. Les yeux deviennent rouges 8c enflammés
, h prunelle égarée 8c étincelante, les
fourcils tantqt abbatus, tantôt élevés également
le front très-ridé, des plis entre les yeux, les na-
- rines ouvertes & élargies > les lèvres fc prcffanc
1 une contre 1 .autre , 1 inférieure fin-montant la
fupérieure, laiflè les coins de la bouche un peu
ouverts, formant un ris cruel 8c dédaigneux.
3. Le dejîr. Cette paffion rend les fourcils preffés 8c
avancés fur les yeux qui font plus ouverts qu’à
l’ordinaire, la prunelle enflammée fe place au milieu
de l’oeil; les narines s’élèvent 8c fe ferrent du
côté des yeux, la bouche s’entre-ouvre, 8c les
efprits qui font en mouvement donnent une couleur
vive & ardente.
4. Douleur aiguë. La douleur aiguë fait approcher les
fourcils l’un de l’autre, 8c élever vers le milieu
la prunelle fè cache fous le fourcil, les narines
s5élevent 8c marquent un pli aux joues, la boii^.
che s’entre-ouvre & fe retire ; toutes les parties
du vifàge font agitées à mefure de la violence de
la douleur.
P A N C H E X X V I I .
Draperie.
Draperie jettée fur le mannequin»
P L A N C H E X X V I I I .
Draperie»,
Fig. 1. Figure antique repréfentant un Romain avec
la toge.
z. Figure antique repréfèntant une Romaine habillée
; c’eft Faufina Junior.
3. Figure drapée de la Hire.
P L A N C H E X X I X ,
Fig. 1. Figure antique repréfèntant la Santé.'
z. Figure antique repréfentant Cerès.
3. & 4. Têtes drapées du Pouffin.
P L A N C H E X XX.
Fenfée ou croquis d’après un dejfein à la plume du
Farmefan.
Cette forte de deftèin eft, comme on le voit, fore
incorrect 8c fufceptible de faux traits ; mais on n’en
doit juger que par rapport à l’ordonnance du tout enfemble
, 8c 1e bel effet qui en peut réfulter : d’ailleurs
l’artifte ne fait un croquis que pour lui , &■ comme
un plan auquel il apportera autant de changenjens qu’il
croira néceflairc.pour remplir fon idée dans tous fes
détails lors de l’exécution. On rcconnoît toujours dans
un croquis la main d’un grand maître, par l’intention
fine & l’cfprit qu’il fçait donner à fes figures, aux tours
de têtes 8c à tous les mouvemens. On pourroit s’étendre
davantage fur cette partie par rapport à la com-
pofition, mais ce feroit fortir de notre objet, 8c nous
nous contentons de donner un exemple.
P L A N C H E X X X I .
Etude ou croquis du haut dune figure d après nature '
parle Carrache.
Nous ne donnons cet exemple que relativement à