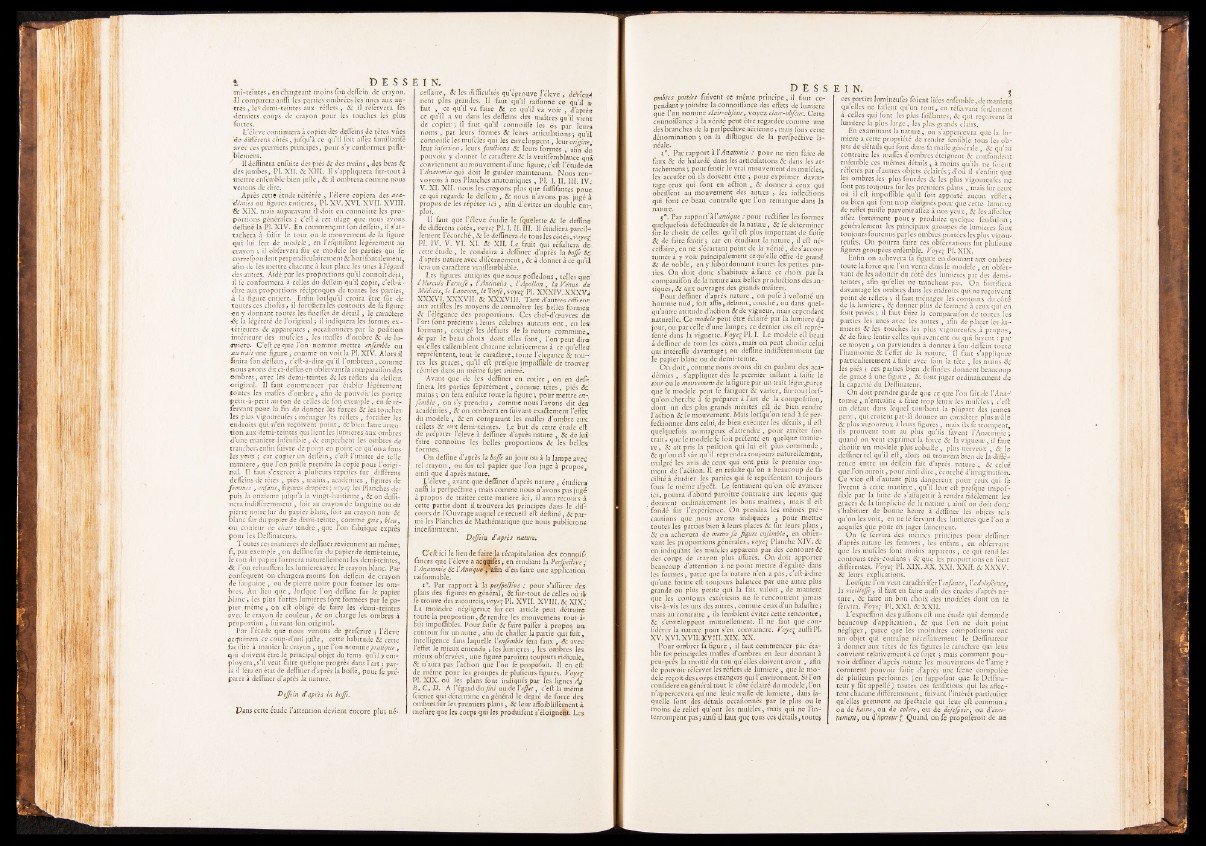
D E S S E I N .
ïm-tëïntes, en chargeant moins (on deiïein de crayon.
Il comparera auffi les parties ombrées lés unes aux autres
., les demi-teintes aux reflets , 8c il réfèrvera ïès
•derniers coups de crayon pour les .touches les plus
"fortes.
L’éleve continuera à copier des deflèins de têtes vues
<le différens côtés, jufqu’à ce qu’il foit a (fez familiarîfe
avec ces premiers principes, pour s’y conformer paffa-
Iblement.
^ Il deflînera enfuite des pics & des mains, des bras &
■ des jambes, PI. XII. &XIII. Il s’appliquera fùr-tout à
•mettre enfemble bien jufte, 8c il ombrera comme nous
venons de dire.
Après cette étude réitérée , l’éleve copiera des academies
ou figures entières, PI. XV. XVI. XVII. XVIII.
■ & XIX. mais auparavant il doit en connoître les proportions
générales ïÀc’cftà cet ulàge que nous avons
deftiné la PI. XIV. En commençant fon deflèin , il s’attachera
à fàifir le tour ou le mouvement de la figure
qui lui fert de modèle, en l’efquiflànt légèrement au
■ crayon ; il obier ver a fur ce modèle les parties qui le
correlpondent perpendiculairement &horifontalemcnt,
afin de les mettre chacune à leur place les unes à l’égard
des autres. Aidé par les proportions qu’il connoît déjà,
•il fe .conformera à celles du deflein qu’il copie, c’cft-à •
dire aux proportions réciproques de toutes les parties,
à la figure entière. Enfin lorfqu’il croira être fur de
toutes ces choies , il fortifiera les contours de là figure
•en y donnant toutes les fiucffes de détail , le caradere
iôc la légéretc de l’original ; il indiquera les formes extérieures
8c apparentes , occafîonnées par la pofition
intérieure des mufcles , les mafles d’ombre 8c de lumière.
C ’eft ce que l’on nomme mettre enfemble ou
au trait une figure , comme on voit la PI. XIV. Alors il
finira fon dcflèin, .c’eft-à-dire qu’il l’ombrera, comme
tious avons dit ci-deffus enobfèrvantla comparailbn des
•ombres, avec les demi-teintes &les réflets du deflein
■ original. Il faut commencer par établir légèrement
joutes les maires d’ombre, afin de pouvoir les porter
petit-à-petit au ton de celles de fon exemple , en fè réservant
pour la fin de donner les forces 8c les touches
les plus vigoureufes ; ménager les réflets, fortifier les
'endroits qui n’en reçoivent point, SC bien faire attention
aux demi-teintes qui lient les lumières aux ombres
d’une maniéré infenfibic, 8c empêchent les ombres de
trancher; enfin fiiivre de point en point ce qu’on a fous
les yeux ; car copier un deiïein, c’eft l’imiter de telle
manière, que l’on puiflè prendre la copie pour l'original.
Il faut s'exercer à plufieurs reprifes fur différens
deflèins de têtes , pics , mains , académies , figures de
femmes , enfans, figures drapées ; voyei les Planches depuis
la onzième jufqu’à la vingt-huitieme, 8c on deffi-
nera indifféremment, foie au crayon de lànguine ou de
pierre noire fur du papier blanc, foit au crayon noir 8c
blanc fur du papier de demi-teinte, comme gris , bleu,
eu couleur de chair tendre , que l’on fabrique exprès
pour les Deflinateurs.
Toutes ces maniérés de defliner reviennent au même;
fi, par exemple , on deffinefur du papierdedemi-teinte,
le ton du papier formera naturellement les demi-teintes,
■ 6c l’on rehauflèra les lumières avec le crayon blanc. Par
•confisquent on chargera moins fon deflein de crayon
de fanguine , ou de pierre noire pour former les ombres.
Au lieu que , lorfque l’on deflïne fiir le papier
blanc, les plus fortes lumières font formées par le papier
même , on eft obligé de faire les demi-teintes
avec le crayon de couleur, 8c on charge les ombres à
proportion , fiiivant fon original.
Par l’étude que nous venons de prelcrire ; l’éleve
acquérera ce coup-d’oeil jufte, cette habitude 8c cette
facilité à manier le crayon , que Ton nomme pratique ,
qui doivent être le principal objet du tems qu’il y em-
ployera,s’il veut faire quelque progrès dans l’art : parla
il fera en état de defliner d’après la boflè, pour fe préparer
à defliner d’après la nature.
Dejfein d'après la boffe.
pans cette étude l’attention devient encore plus néceflàire,
8c les difficultés qu‘éprouve l’élevé ; deVïerH
nent plus grandes. Il faut qu’il raifonne ce qu’il *
fait 3) ce qu’il va faire & ce qu’il va voir , d’après
ce qu’il a vu dans les deflèins des maîtres qu’il vient
1 de copier ; il faut qu’il connoiflc les os par leurs
noms , par leurs formes 8c leurs articulations ; qu’iï
connoiflc les mufcles qui les enveloppent, leur origine±
leur infertion, leurs fonctions 8c leurs formes , afin de
pouvoir y donner le caradere 8c la vraisemblance- qui
conviennent au mouvement d’une figure; c’eft l’étude de
l’Anatomie qui doit le guider maintenant. Nous ren-:
voyons à nos Planches anatomiques, PI. I. II. III. IV.'
V. XI. XII. nous les croyons plus que fuffilàntes pour
ce qui regarde le deflèin , 8c nous n’avons pas jugé a
propos de les répéter ic i , afin d’éviter un double em-,
ploi.
Il faut que l’éleve étudie le fquêlette 8c le deflïne
de différens côtés, voye% PI. I. II. III. Il étudiera pareil-!
lement l’écorché, & le deflînera de tous les côtés, voyez
PI. IV. V. VI. XI. 8c XII. Le fruit qui rélùltera de
cette étude , le conduira à defliner d’après lu bojfe 8c
d’après nature avec difeernement, 8c à donner à ce qu’il
fera un caradere vraiflèmblable.
Les figures antiques que nous pofledons, telles que
l’Hercule Farnefè , VAntinous , l'Apollon , la Venus de.
Mëdicis, le Laocoon, le Torfe ,voye^ PI. XXXIV. XXX V«J
XXXVI. XXXVII. 8c XXXVIII. Tant d’autres offrent
aux artiftes les moyens de connoître les belles formes
8c l’élégance des proportions. Ces chef-d’oeuvres der
l’art font précieux ; leurs célébrés auteurs ont, en les
formant, corrigé les défauts de la nature commune,'
& par le beau choix dont elles font !,, l’on peut diro
qu’elles raflcmblent chacune relativement à ce qu’elleÿ
repréfèntent, tout le caradere, toute l’élegance 8c tou-'
tes les grâces, qu’il eft prcfque impoffible de trouve^
réunies dans un même fujet animé.
Avant que de les defliner en entier , on en def—;
finera les parties feparément, comme têtes, pies 8c
mains ; on fera enfuite toute la figure ; pour mettre en
femble , on s’y prendra, comme nous l’avons dit des
académies, 8c on ombrera en fiiivant exactement l’effec
du modèle, & en comparant les maflès d’ombre aux
réflets 8c aux demi-teintes. Le but de cette étude eft
de préparer l’éleve à defliner d’après nature , & de lu*
faire connoître les belles proportions & les belles
formes.
On deflïne d’après la boffe au jour ou à la lampe avec
tel crayon, ou fur tel papier que l’on juge à propos
ainfi que d’après nature.
b’éleve , avant que defliner d’après nature, étudiera-
auffi la pcrfpedive ; mais comme nous n’avons pas jugé
à propos de traiter cette matière ici, il aura recours à
cette partie dont il trouvera les principes dans le discours
de l’Ouvrage auquel ce recueil eft deftiné, 8c parmi
les Planches de Mathématique que nous publierons
inceffamment.
Dejfein. diaprés nature.
C’eft ici le lieu de faire la récapitulation des eonnpif,
fànccs que l’éleve a acqôifès, en étudiant la ¥ effective ,
l’Anatomie 8c ï Antiqu^frifvn d’en faire une application
raifonnable.
i°. Par rapport à la perjpeclive : pour s affurer des
plans des figures en général, & fur-tout de celles où il
fè trouve des racourcis, voyez PI. XVII. XVIII. & XIXJ
La moindre négligence fur cet article peut détruire
toute la proportion, 8c rendre les mouvemens tout-à-
fait impofîibles. Pour fàifir 8c faire paflèr à propos un
contour fur un autre, afin de chafler la partie qui fuit,
intelligence fans laquelle l’enfemble fera faux , 8c avec
l’effet le mieux entendu , les lumières , les ombres les
mieux obfcrvées, une figure paroîtra toujours ridicule,
& n’aura pas l’adion que l’on fe propofoit. Il en eft
de même pour les groupes de plufieurs figures. Vyyeç
PI. XIX. où les plans font indiqués par les lignes Aj
B, Cf D. A l’égard du fini ou de f effet, c’eft la même
fcience qui détermine en général le degré de force des
ombres fur les premiers plans, 8c leur affoibliflèment à
mefîirç que les corps qui les produifènt s’éloignent. Les
ombres portées füîvent ce même principe, il faut cependant
y joindre la connoiflànce des effets de lumière
que l’on nomme clair-obfcur, voyez clair-obfcur. Cette
connoiflànce à la vérité peut être regardée comme une
des branches de la perfpedive aerienne, mais fous cette
dénomination ; on la diftingue de la perfpedive li-
néale.
i°. Par rapport à f Anatomie : pour ne rien faire de
faux 8c de hafardé dans les articulations 8c dans les at-
tachemens ; pour fentir le vrai mouvement des mufcles,
les accufèr où ils doivent être ; pour exprimer davantage
ceux qui font en adion , 8c donner à ceux qui
obéiffent au mouvement des autres , les inflexions
qui font ce beau contrafte que l’on remarque dans la
nature.
5°. Par rapport àl'antique : pour redificr les formes
quelquefois défedueufès de la nature, 8c fe déterminer
fur le choix de celles qu’il eft plus important de fàifir
8c de faire fèntir ; car en étudiant la nature, il eft né-
ceffaire, en ne s’écartant point de la vérité, de s’accoutumer
à y voir principalement ce qu’elle offre de grand
8c de noble, en y fiibordonnant toutes les petites parties.
On doit donc s’habituer à faire ce choix par la
comparaifon de la nature aux belles productions des an •
tiques, 8c aux ouvrages des grands maîtres.
Pour deffiner d’après nature , on pofè à volonté un
homme nud, foit aflis, debout, couché, ou dans qucl-
qu’autre attitude d’adion & de vigueur, mais cependant
naturelle. Ce modèle peut être éclairé par la lumière du
jour, ou parcelle d’une lampe; ce dernier cas eft repré-
fènté dans la vignette. Voyei PI. I. Le modèle eft beau
à deffiner de tous les côtés, mais on peut choifir celui
qui intéreffe davantage ; on deflïne indifféremment fur
le papier blanc ou de demi-teinte.
On doit, comme nous avons dit en parlant des académies
, s’appliquer dès le premier inftant à fàifir le
tour ou le mouvement de la figure par un trait léger,parce
que le modèle peut fè fatiguer & varier, fur-tout lorf*
qu’on cherche à fè préparer à l’art de la compofition,
dont un des plus grands mérites eft de bien rendre
l'action & le mouvement. Mais lorfqu’on tend à fè perfectionner
dans celuijde bien exécuter les détails, il eft
quelquefois avantageux d’attendre , pour arrêter fon
trait, que le modèle fe foit préfenté en quelque maniéré
, 8c ait pris la pofition qui lui eft plus commode ,
& qu’on eft sûr qu’il reprendra toujours naturellement,
malgré les avis de ceux qui ont pris le premier moment
de faction. Il en refùlte qu’on a beaucoup de facilité
à étudier les parties qui fè repréfèntent toujours
fous le même afpeCt. Le fentiment qu’on ofè avancer
ici, pourra d’abord paroître contraire aux leçons que
donnent ordinairement les bons maîtres ; mais il eft
fondé fur l’expérience. On prendra les mêmes précautions
que .nous avons indiquées , pour mettre
toutes les parties bien à leurs places 8c fur leurs plans,
8c on achèvera de mettre fa figure enfemble, en obfèr-
vant les proportions générales, voyei Planche XIV. 8c
en indiquant les mufcles apparens par des contours 8c
des coups de crayon plus affurés. On doit apporter
beaucoup d’attention à ne point mettre d’égalitc dans
les formes, parce que la nature n’én a pas, c’eft-à-dire
qu’une forme eft toujours balancée par une autre plus
grande ou plus petite qui la fait valoir, de manière
que les contours extérieurs ne fe rencontrent jamais
vis-à-vis les uns des autres, comme ceux d’un baîuftre;
mais au contraire , ils fèmblent éviter cette rencontre,
8c s’enveloppent mutuellement. Il ne faut que con-.
fidérer la nature pour s’en convaincre. Voyei auffi PI.
XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.
Pour ombrer fà figure , il faut commencer par établir
fès principrdes mafles d’ombres en leur donnant à
peu-près la moitié du ton qu’elles doivent avoir , afin
de pouvoir réfèrver les reflets de lumière , que le modèle
reçoit des corps étrangers qui l’environnent. Si l’on
confidere en général tout le côté éclairé du modèle, l’on
n’appercevera qu’une fèule rnaffe de lumière, dans laquelle
font des détails occàfîonnés par le plus ou le
moins de relief qu’ont les mufcles, mais qui ne l’in-
îerrompenc pas ; ainfi il &ut quç tçus çes détails, toutej
E î N. ?
ces parties lumîneufès fbient liées enfemble, de maniérés
qu elles ne faflènt qu un tout, en réfèrvant fèulemenc
à celles qui font les plus fàillantes, 8c qui reçoivent la
lumière la plus large, les plus grands clairs.
En examinant la nature, on s’appercevra que la lumière
a cette propriété de rendre fenfible tous les objets
de détails qui font dans fa maflè générale , 8c qu’au
contraire les maflès d’ombres éteignent & confondent
enfemble ces mêmes détails, à moins qu’ils ne foienc
réfletés par d’autres objets éclairés ; d’où il s’enfuie que
les ombres les plus lourdes 8c les plus vigoureufès ne
font pas toujours fur les premiers plans , mais fur ceux
ou il eft impoffible qu’il foit apporté aucun réflet ;
ou bien qui font trop éloignés pour que cette lumière
de reflet puiffe parvenir aflez à nos yeux, 8c les affeder
aflèz fortement pour y produire quelque fenfation ;
généralement les principaux groupes de lumières font
toujours fbutenus parles ombres portées les plus vigoureufes.
On pourra faire ces obfervations fur plufieurs
figures groupées enfemble. Voyeç PI. XIX.
Enfin on achèvera fà figure en donnant aux ombres
toute la force que l’on verra dans le modèle , en obfèu-
vant de les adoucir du côté des lumières par des demi-
teintes, afin qu’elles ne tranchent pas. On fortifiera
davantage les ombres dans les endroits qui ne reçoivent
point de réflets ; il faut ménager les contours du côté
de la lumière , 8c donner plus de fermeté à ceux qui cm
font privés ; il faut faire la comparaifon de toutes les
parties les unes avec les autres , afin de placer les lumières
&les touches les plus vigoureufes à propos,’
8c de faire fentir celles qui avancent ou qui fuyent : parce
moyen, on parviendra à donner à fon deflèin toute
l’harmonie 8c l’effet de la nature. Il faut s’appliquer
particulièrement à finir avec foin la tête , les mains 8c
les piés ; ces parties bien deffinées donnent beaucoup
de grâce à une figure , 8c font juger ordinairement de
la capacité du Deffinateur.
On doit prendre garde que ce que l’on fait de l’Anatomie
, n’entraîne à fàire trop fentir les mufcles ; c’eft
un defaut dans lequel tombent la plupart des jeunes
gens, qui croient par-là donner un caradere plus mâle
8c plus vigoureux à leurs figures , mais ils fe trompent,
ils prouvent tout au plus qu’ils favent l’Anatomie;
quand on veut exprimer la force 8c la vigueur, il faut
choifir un modèle plus'robufte , plus nerveux 8c le
deffiner tel qu’il eft, alors on trouvera bien de la différence
entre un deflèin fait d’après nature , & celui
que l’on auroit, pour ainfi dire, écorché d’imagination.
Ce vice eft d’autant plus dangereux pour ceux qui fè
livrent à cette maniéré, qu’il leur eft prefque impoffible
par la fuite de js’affujettir à rendre fidèlement les
grâces & la fimplicité de la nature ; ainfi on doit donc
s’habituer de bonne heure à deffiner les objets tels
qu’on les voit, en ne fe fèrvant des lumières que l’on a
acquifes que pour en juger fàinement.
On fe fèrvira des mêmes principes pour deffiner
d’après nature les femmes, les enfans,, en obfervanc
. que les mufcles font moins apparens, ce qui rend les
contours très-coulans ; & que les proportions en fonc
différentes. Voye[ PI. XIX. XX. XXI. XXII. 8c XXXV.
& leurs explications.
Lorfque l’on veut caradérifer Y enfance, f adolefcenceÿ
la vieilleffe, il faut en taire auffi des études d’après nature,
8c faire un bon choix des modèles dont on fe
fervirâ. Voyef PI. XXI. 8c XXII.
L’expremon des pallions eft une étude qui demande
beaucoup d’application, 8c que l’on ne doit point
négliger, parce que les moindres compofitions onc
un- objet qui entraîne néceflàirement le Deffinateur
à donner aux têtes de fes figures le caradere qui leur
convient relativement à ce fujet ; mais comment pouvoir
deffiner d’après nature les mouvemens de Tame î
comment pouvoir fàifir d’après une feene compofée
de plufieurs perfonnes (en fuppofànt que le Deffinateur
y fût appellé ) toutes ces fenfàtions qui les aftèc.-
tent chacune différemment, fiiivant l’intérêt particulier
qu’elles prennent au fpedade qui leur eft commun,
ou de haine y ou de colère , ou de defèjpoir, ou d'eton-
nement, ou i ’hçrre^r £ Quand on fe propoferoit de n®