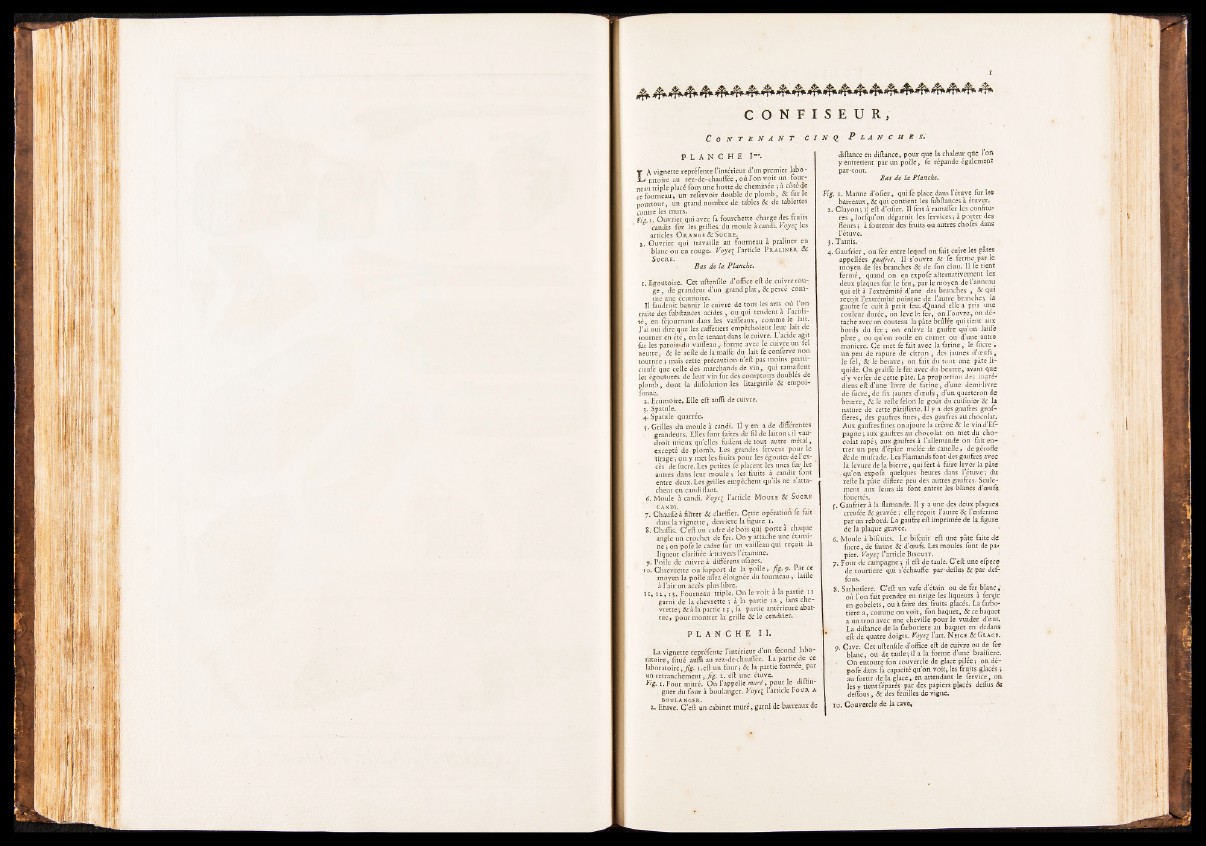
C O N F I S E U R ,
C o n t e n a n t c i n q P l a n c h e si
H A N C H E I er*.
LA vignette repré fente l’intérieur d'un premier labo*
ratoire au rez-de-chauflee, où l’on voit un four-
neau triple placé fous une hotte de cheminée ; à cote de
ce fourneau, un- refèrvoir double de plomb, & fur le
pourtour, un grand nombre de tables & de tablettes
contre les murs. ' . .
Fig. i. Ouvrier qui avec fa fourchette charge des rruits
candis fur les grilles» du moule à candi. Voye[ les
articles O range & Sucre.
x. Ouvrier qui travaille au fourneau à praliner en
blanc pu en rouge. Voye^_ l’article Praliner 8c
Sucre.
Bas de la. Planche.
i. Egoütoire. Cet uften file d’office eft de cuivré rôü-
g c , de grandeur d’un grand plat, 8c percé comme
une écumoire»
Il faudroit bannir le cuivre de tous les arts^ ou 1 on
traite des fùbftances acides , ou qui tendent a 1 acidité
, en Ajournant dans les vailfeaux, comme le lait.
J’ai oui dire que les caffetiers empêchoient leur lait de
tourner en été, en le tenant dans le cuivre. L’acide agit
fur les parois*du vailfeau ,• forme avec le cuivre un fel
neutre, & le refte de la malle du lait fè confèrve non
tournée ; mais cette précaution n’eft pas moins perni-
cieufè que celle des marchands de vin, qui ramaflent
les égouturcs de leur vin fur des comptoirs doubles de
plomb, dont la diffolution les litargirife 8c empoi-
fonne.
x. Ecumoire. Elle eft âuffi de cuivre.
3. Spatule.
4. Spatule-quarrée.
f. Grilles du moule à càndi. il y eft a de différentes
. grandeurs. Elles font faites de fil de laiton j il vau*
droit mieux qu’elles fuflènt de tout autre métal,
excepté de plomb. Les grandes fervent pour le
tirage j on y met les fruits pour les égouter de l’ex- >
cès de fucre. Les petites fe placent les unes fur les
autres dans leur moule 5 les fruits à candir font
entre deux. Les grilles empêchent qu’ils ne s’attachent
en candi fiant.
'6. Moule à candi. Voyei l’article Moule & Sucre
7. Chauffe à filtrer & clarifier. Cette operation le fait
dans la vignette, derrière la figure 1. ^
8. Chaflis. C’eft un cadre de bois qui porte a chaque
angle un crochet de fer. On y attache une étamine
; on pofe le cadre fur un vaiffeau qui reçoit la
liqueur clarifiée à-travers l’étamine.
9. Poîle de cuivre à différens ufages.
10. Chrcvrette ou fupport de la poîle, fig.9- Par c*
moyen la poîle affez éloignée du fourneau, laifie
à l’air un accès plus libre.
i i , 11,13. Fourneau triple. On le voit a la partie 11
garni de la chevrette ; à la partie 11 , frns chevrette
j & à la partie 13, fa partie anterieure abattue,
pour montrer la grille & le cendrier.-
P L A N C H E I I .
La vignette repréfènte l’intérieur d un fécond labô*
ràtoire, fîtué aufii au rez-de-chauflée. La partie de ce
laboratoire ,fg- 1. eft un four •, & la partie formée,, par
un retranchement, fig. i. eft une étuve.
Fig. 1. Four mitré. On l’appelle muré, pour le diftin-
gucr du four à boulanger. Voye[ l’article Four a
BOULANGER.
1. Etuve. C ’eft un cabinet muré, garni de barreaux de
diftance en diftance, pour que la chaleur que 1 on
y entretient pâr Un poîlè, fè répande également
par-tout.
Bas de la Planche.
Fig. 1. Manne d’ofier, quifè place dans l’étuve fur les
barreaux, & qui contient les fùbftances à étuver.
1, Clayon; il eft d’ofier» Il fert à ramaffer les confitu*
res , lorfqu’on dégarnit les fervices ; à porter des
fleurs ; à foutenir des fruits ou autres chofes dans
l’étuve.
3. Tamis.
4. Gaufrier, ou fer entre lequel on fait Cuire les pâtes
appellées gaufres. Il s’ouvre 8c fe ferme par le
moyen de fès branches 8C de fon clou. Il fe tient
ferme, quand on en expofe alternativement les
deux plaques fur le feu', par le moyen de 1 anneau
qui eft à l’extrémité d’une des branches , & qui
reçoit l’extrémité pointue de l’autre branche ; la
gaufre fe cuit à petit feu. »Quand elle a pris une
couleur dorée, oft leve le fer, on l’ouvre, on détache
avec un couteau la pâte brûlée qui tient aux
bords du fer ; on enleve la gaufre qu’on laiffe
plate, ou qu’on roule pn cornet ou d’une autre
maniéré. Ce met fè fait avec la farine, le fucre ,
un peu de rapure de citron , des jaunes d’oeufs,
le fel, & le beurre ; on fait du tout une pâte liquide.
On graiffe le fer avec du beurre, avant que
d’y verfèr de cette pâte. La proportion des ingré-
diens eft d’une livre de farine, d’ühe demi-livre
de fucre, de fix jaunes d’oeufs, d’un quarteron de
beurre, 8t le refte feloft le goût du cuifinier & la
nature de cette pâtiflèrie. Il y a des gaufres grofv
fieres, des gaufres fines, des gaufres au chocolat;
Aux gaufres fines on ajoute la crème & le vin d’Ef*.
pagne ; aux gaufres au chocolat on met du chocolat
râpé; aux gaufres à l’allemande on fait entrer
un peu d’épice mêlée de canelle, de'gérofle
&de mufeade. Les Flamands font des gaufres avec
la levure de la bierre, qui fèrt à faire lever la pâte
- .qu’on expofè quelques heures dans l’étuve; du
refte là pâte diffère peu des autres gaufres. Seulement
aux leurs ils font entrer les blancs d’oeufs
fouettés.
j. Gaufrier à la flamande. Il y a une des deux plaques
creuféc & gravée ; elle reçoit l’autre & l’enferme
par un rebord. La gaufre eft imprimée de la figure
de la plaque gravée.
6. Moule à bifeuits. Le bifeuit eft une pâte faite de
fucre, de farine 8c d’oeufs. Les moules font de papier.
Voyei l'article Biscuit.
7. Four de campagne ; il eft de taule. C ’eft une efpece
de tourtiere qui s’échauffe par-deffüs & par- defr
fous.
8. Sarbotiere. C’eft un vafe d’étain ou de fer blanc ;
ou l’on fait prendre en neige les liqueurs à fer^ir
en gobelets, ou à faire des fruits glacés. La farbo-
tiere a, comme on voit, fbn baquet, & ce baquet
a un trou avec une cheville pour le vüider d’eau.
La diftance de la farbotiere au baquet en dedans
eft de quatre doigts. Voyc[ l'art. N eige & Glace.
9. Cave. Cet uftenfile d’office eft de cuivre ou de fer
blanc, ou de taule; il a la forme d’une' hraifiere.
■ On entoure fon couvercle de glace pilée; on dé-
pofè dans fa capacité qu’on voit, les fruits glacés ;
au fortir de la glace, en attendant le fervice, on
les y tient féparés par des papiers placés deffus 8e
deffous, & des feuilles de vigne.
10. Couvercle de la cave*