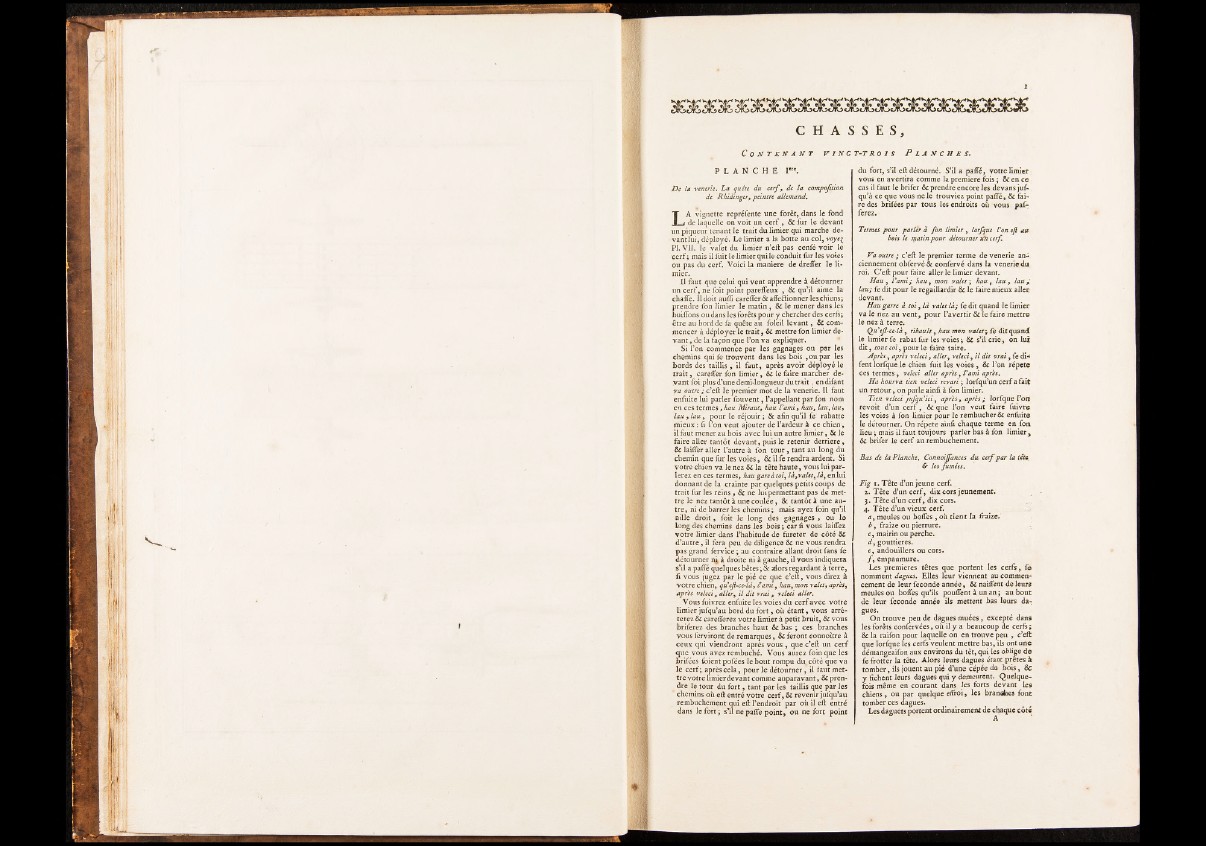
C H A S S E S
C o n t e n a n t v i n g r-r r o i s P l a n c h e s •
P L A N C H E Ier*.
De la vtnerie. La quête du cerf, de la compojition
de Rhidinger, peintre allemand.
T A vignette repréfente une forêt, dans le fond
1—< de laquelle on voit un cerf , & fur le devant
du fort, s’il eft détourné. S’il a pafle, votre limier
vous en avertira comme la première fois ; & en ce
cas il faut le brifer & prendre encore les de vans juf-
qu’à ce que vous ne le trouviez point pafle, 6c faire
des brifées par tous les endroits où vous paf-
ferez.
un piqueur tenant le trait du limier qui marche de-
vantlui, déployé. Le limier a la botte au col, voye^
PL VIL le valet du limier n’eft pas cenfé voir le
Termes pour parler à fon limier, lorfque Von ejl au
bois le rpatin pour détourner un cerf.
cerf ; mais il fuit le limier qui le conduit fur les voies
ou pas du cerf. Voici la maniéré de dreffer le limier.
Il faut que celui qui veut apprendre à détourner
un ce rf, ne foit point pareffeux , & qu’il aime la
chaffe. Il doit aufli careiTer & affectionner leschiens;
prendre fon limier le matin, 6c le mener dans les
huilions ou dans les forêts pour y chercher des cerfs;
être au bord de fa quête au foleil levant, 6c commencer
à déployer le trait, & mettre fon limier devant
, de la façon que l’on va expliquer.
Si l’on commence par les gagnages ou par les
chemins qui fe trouvent dans les bois , ou par les
bords des taillis , il faut, après avoir déployé le
tra it, careffer fon limier, & le faire marcher devant
foi plus d’une demi-longueur du tra it , endifant
va outre ; c ’eft le premier mot de la venerie. Il faut
enfuit e lui parler fou vent, l’appellant par fon nom
en ces termes, hau Miraut, hau l'ami, hau, lau, lau,
lau , lau, pour le réjouir ; & afin qu’il fe rabatte
mieux : fi l’on veut ajouter de l’ardeur à ce chien,
il faut mener au bois avec lui un autre limier, St le
faire aller tantôt devant, puis le retenir derrière,
& laiffer aller l’autre à fon tour, tant au long du
Va outre ; c’eft le premier terme de venerie anciennement
obfervé & confervé dans la venerie du
roi. C ’eft pour faire aller le limier devant.
Hau, l'ami; hau, mon valet ; hau , lau , lau ;
lau; fe dit pour le regaillardir 6c le faire mieux aller
devant.
Hau garre à toi, là valet là; fe dit quand le limier
va le nez au vent, pour l’avertir 6c le faire mettre
le nez à terre.
Qu'ef-ce-là, ribault, hau mon valet fe dit quand
le limier fe rabat fur les voies ; 6c s’il crie, on lux
dit, tout coi, pour le faire taire.
Après, après veleci, aller, veleci, il dit vrai, fe di-
fent lorfque le chien fuit les voies , 6c l ’on répété
ces termes, veleci aller après, l'ami après.
Ha hourva tien veleci revari ; lorfqu’un cerf a fait
un retour, on parle ainfi à fon limier.
Tien veleci jufqu'ici, après, après ; lorfque l’on
revoit d’un c e r f , 6c que l’on veut faire fuivre
les voies à fon limier pour le rembucher& enfuite
le détourner. On répété ainfi chaque terme en fon
lieu ; mais il faut toujours parler bas à fon limier,
6c brifer le cerf au rembuchement.
chemin que fur les voies, & il fe rendra ardent. Si
votre chien va le nez 6c la tête haute, vous lui parlerez
en ces termes, hau gare à toi, là,valet, là, en lui
Bas de la Planche. Connoijfances du cerf par la te ta
& les fumées.
donnant de la crainte par quelques petits coups de
trait fur les reins, 6c ne lui permettant pas de mettre
le nez tantôt à une coulée, & tantôt à une autre,
ni de barrer les chemins; mais ayez foin qu’il
aille droit, foit le long des gagnages , ou la
long des chemins dans les bois ; car fi vous laiffez
votre limier dans l’habitude de fureter de côté 6c
d’autre, il fera peu de diligence 6c ne vous rendra
pas grand fervice ; au contraire allant droit fans fe
détourner nj à droite ni à gauche, il vous indiquera
s’il a paffé quelques bêtes ; & «dors regardant à terre,
fi vous jugez par le pié ce que c’eft, vous direz à
votre chien, qiiefi-ce-là, Vami, hau, mon valet, après,
après veleci, aller, il dit vrai , veleci aller.
Vous fuivrez enfuite les voies du cerf avec votre
limier jufqu’au bord du for t, où étant, vous arrêterez
6c carefferez votre limier à petit bruit, & vous
briferez des branches haut 6c bas ; ces branches
vous ferviront de remarques, 6c feront eonnoître à
ceux qui viendront après vous , que c’eft un cerf
que vous avez rembuché. Vous aurez foin que les
brifées foient pofées le bout rompu dt^côté que va
le cerf ; après cela, pour le détourner, il faut mettre
votre limier devant comme auparavant, & prendre
le tour du fo r t , tant par les taillis que par les
’ chemins où eft entré votre cerf, 6c revenir jufqu’au
rembuchement qui eft l’endroit par où il eft entré
dans le fort ; s’il ne pafle point, ou ne fort point
Fig i. Tête d’un jeune cerf.
2. Tête d’un cerf, dix cors jeunement.
3. Tête d’un cerf, dix cors.
4. Tête d’un vieux cerf.
a, meules ou bofles , où tient la fraize«'
b , fraize ou pierrure.
c, mairin ou perche.
d , gouttières.
e , andouillers ou cors.
ƒ , empaumure.
Les premières têtes que portent les cerfs, fe
nomment dagues. Elles leur viennent au commencement
de leur fécondé année, 6c naiffent de leurs
meules ou bofles qu’ils pouffent à un an; au bout
de leur fécondé année ils mettent bas leurs da-
gues.
On trouve peu de dagues muées, excepté dans
les forêts confervées, où il y a beaucoup de cerfs ;
6c la raifon pour laquelle on en trouve peu , c’eft
que lorfque les cerfs veulent mettre bas, ils ont une
démangeaifon aux environs du têt, qui les oblige de
fe frotter la tête. Alors leurs dagues étant prêtes à
tomber, ils jouent au pié d’une cépée de bois, 6c
y fichent leurs dagues qui y demeurent. Quelquefois
même en courant dans les forts devant les
chiens, ou par quelque effroi, les branatoes font
tomber ces dagues.
Les daguets portent ordinairement de chaque côté
A