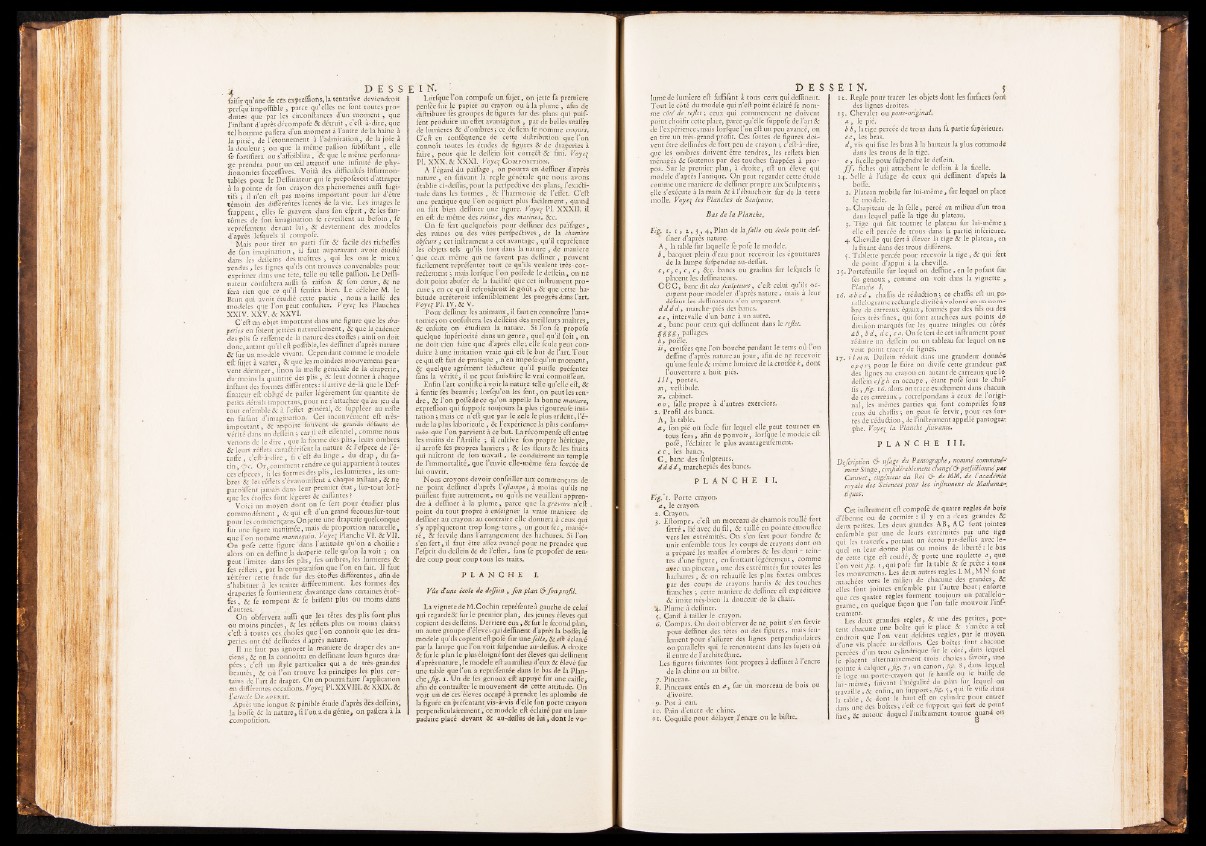
lâUir qu'une îc « s expreffions,!» tentative deviendroit
ÿreïqu’impoffibfe , parce qu’ elfes ne font toutes proJ
duites que par les circonftances d’un' moment, que
l’inftant d’après décompofe & détruit, c’eft-à-dirë, que
*el homme paffera d’un moment à l’autre de la haine à
la pitié, de l’étonnement à l’admiration, de la joie à
la douleur ; ou que la même paffion fubfiftant elle
fe fortifiera ou s’affoiblira, 8c que le même perfonna-
ge prendra pour un oeil attentif une infinité de phy-
fionomies fucceflîves. Voiià des difficultés infurmon-
tables pour lé Deffinâtcur qui fe prépoferoit d’attraper
à la pointe de Ton crayon des phénomènes auffi fugitifs
; il n’en eft j>as moins important pour lui' d’être
témoin des'differèntésTcenès de la vie. Les images le
frappent, elles fe gravent dans fon ëfprit, & les fantômes
de fon imagination fe réveillent au befoin, fé
Tepréfentent devant lui ^ 8c deviennent des modèles
d’après lesquels il compofo. ^
Mais pour tirer un parti fur 8c facile des richeflès
de fon imagination, il faut auparavant avoir étudié
dans les deffein? des maîtres , qui les ont le mieux
rendus, les lignes qu’ils ont trouvés convenables pour
exprimer dans une tête, telle ou telle paffion. Le Deffi-
nateur confulteraauffi fa raifon & fon coeur, 8c ne
fera rien que ce qu’il fentira bien. Le célèbre M. le
Brun qui avoit étudié cette partie , nous a lailfé des
modèles qqe l’on peut confulter. Voyei les Planches
XXIV. XXV. & XXVI.
C’eft un objet important dans une figure que les draperies
en foient jettées naturellement, & que la cadence
des plis fe rèffente de la nature des étoffes ; ainfi on doit
donc, autant qu’il eft poffible,les deffiner d’après nature
ôc fur un modèle vivant. Cependant comme le modelé
eft fujet à varier, &que les moindres mouvemens peuvent
déranger, finon la malfe générale de la draperie,
du-moins la quantité des plis , 8c leur donner à chaque
inftant des formes différentes : il arrive de-là que le Def-
finateur eft obligé de paflér légèrement fur quantité de
petits détails importans, pour ne s attacher qu au jeu du
tout enfemble & à l’effet général, & fuppléer au refte
en faifant d’imagination. Cet inconvénient eft très-
important , ÔC apporte fouvent de grande defauts de
vérité dans un deffein ; car il eft eflentiel, comme nous
venons de le dire , que la forme des plis, leurs ombres
Ôc leurs reflets caraélérifent la nature & 1 elpece de 1 e-
toffe , c’eft-à-dire , fi c’eft du linge , du drap H du fa-
tin &c. Or, comment rendre ce qui appartient à toutes
ces efpeces, fi les formes des plis, les lumières, les ombres
8c les réflets s’évanouiflent à chaque inftant, & ne
paroiffent jamais dans leur premier état, fur-tout lorfque
les étoffes font légères & caftantes ? ^
Voici un moyen dont on fe fert pour etudier plus
commodément, & qui eft d’un grand fecours fur-tout
pour les commcnçans. On jette une draperie quelconque
fur une figure inanimée, mais de proportion naturelle,
que l’on nomme mannequin. Voyez Planche VI. 8c Vil.
On pofe cette figure dans l’attitude qu’on a choifie :
alors on en deffine la draperie telle qu on la voit ; on
peut l’imiter dans fes plis, fes ombres, fes lumières &
les réflets , par la comparaifon que l’on en fait. Il faut
réitérer cette étude fur des étoffes différentes, afin de
s’habituer à les traiter différemment. Les formes des
draperies te foutiennent davantage dans certaines étoffes
, & fe rompent & fe brifent plus ou moins dans
d’autres.- -. . • . . , . ,,
On obfervera auffi que les tetes des plis font plus
ou moins pincées, & les reflets plus ou^moins clairs;
.c’eft à toutes ces. chofes que l’on connoit que les draperies
ont été deffinées d après nature.
Il ne faut pas ignorer la maniéré de draper des anciens
, 8c on la connoîtra en deffinant leurs figures drapées
; c’eft un ftyle particulier qui a de tres-grandes
beautés, & où l’on trouve les principes les plus certains
de l’art de draper. On en pourra faire 1 application
en différentes occafions. Voyez PI. XXVIII. 8c XXIX. &
l’article Draperie. j
Après une longue & pénible étude d’après des defteins,
la boffe 8c la nature, fi l’on a du génie, on paffera à la
compofition,
Lorlqueïon compofé un fujet , on jette fa première
penféë-fur le papier au crayon ou à la plume , afin de
diftribtierTes groupes de figures fur des plans qui puif-
fent produire un effet avantageux , par de belles maffes
de lumières 8c d’ombres; ce deflèin fe nomme croquis.
C’eft en conféquence de cetie fdiftr-ibution que l’on
connoît toutes les études de figures & de draperies à
faire, pour que le deffein Toit correct 8c fini. Voye£
PI. XXX. & XXXI. V o y ei C o m p o s it io n .
A l’égard du païfàge , on pourra en deffiner d’après
nature, en fiiivant la réglé générale que nous avons
établié ci-deffus, pour la perfpeélive des plans, l’exaéti-
'tude dans les formes , & l’harmonie de l’effet. C’eft
une pratique que l’on acquiert plus-facilement, quand
on fait bien deffiner une figure. Voyez PI. XXXIL il
en eft de même dés ruines, des marines, 8cc.
On fe fert quelquefois pour deffiner des païfàges,
des ruines ou des vues perüpeétives, de la chambre
ôbfcure j cet infiniment a cet avantage, qu'il repréfente
les objets tels qu’ils font dans la nature , de maniéré
‘ que ceux même qui ne favent pas deffiner , peuvent
facilement repréfénter tout ce qu’ils veulent trcs-cor-
reélerpent ; mais lorfque l’on poffede le deffein, on ne
doit point abiifer de la facilité que cet infiniment procure
; en ce qu’il refroidiroit le gôut, & que cette habitude
arrêteroit infenfiblement lès progrès dans l’art.
VcyeiVl.IV.8c V.
Pour deffiner les animaux, il faut en connoître l’anatomie;
on confultera les deffein? des meilleurs maîtres,
êc enfuite on étudiera la nature. Si l’on fè propofe
quelque fupériorité dans un genre, quel qu’il foit, on
ne doit rien faire que d’après elle; elle feule peut conduire
à une imitation vraie qui eft le but de l’art. Tout
ce qui eft fait de pratique , n’en impofe qu’un moment,
& quelque agrément lédudleur qu’il puiflè préfenter
fans la vérité, il ne peut fatistaire le vrai connoiflèur.
Enfin l’art confifteà voir la nature telle qu’elle eft, &
à fèntir fes beautés; lorfqu’on les fent, on peut les rendre
, 8c l’on poflède ce qu’on appelle la bonne maniéré,
expreffion qui fùppofe toujours la plus rigoureufe imitation
; mais ce n’eft que par le zele Je plus ardent, l’étude
la plus laborieufe, 8c l’expéri'ence la plus confom-
mée que l’on parvient à ce but. Larécompenféeft entre
les mains de l’Artifte ; il cultive fon propre héritage,
il arrofè lès propres lauriers ; & les fleurs & les fruits
qui naîtront de Ion travail , le conduiront au temple
de l’immortalité, que l’envie elle-même fera forcée de
lui ouvrir.
Nous croyons devoir confeiller aux commençans de
ne point deffiner d’après l'ejlampe, à moins qu’ils ne
puiflènt faire autrement, ou qu’ils ne veuillent apprendre
à deffiner à la plume, parce que la gravure n’eft .
point du tout propre à enfeigner la vraie maniéré de
deffiner au crayon:au contraire elle donnera à ceux qui
s’y appliqueront trop long-tems , un goût fec, maniéré,
& fervile dans l’arrangement des hachures; Si l’on
s’en fert, il faut être affez avancé pour ne prendre‘que
pâ’efprit du deflèin 8c de l’effet, fans fè propofer de rendre
coup pour coup tous les traits.
P L A N C H E I.
Vûe dune école de deffein , fon flan & fon profil.
LavignetedeM.Cochin reprélènteà gauche de celui
qui regardeôc fur le premier plan, des jeunes élevés qui
copient des defteins. Derrière eux, & fur le fécond plan,
un autre groupe d’éleves quideffinent d’après la boflè; le
modèle qu’ils copient eft pofé fur une fille, & eft éclairé
par la lampe que l’on voit fufpendue au-defliis. A droite
8c furie plan le plus éloigné font des élevés qui deffinenc
d’après nature, le modèle eft au milieu d’eux & élevé fur
une table que l’on a.repréfèntée dans le bas de la Planche,./?#.
i. Un de fes genoux eft appuyé fur une caiflè,
afin de contràfter’Ié mouvement de cette attitude. On
vôit un de ces'élèves occupé à prendre les aplombs de
la figure en préféntant vis-à-vis d’elle fon porte’crayon
perpendiculairement, ce modèle eft éclairé par un lampadaire
placé devant ôc au-deffus de lui, dont le va-.
D E S
lume de lumière eft fuffifant à tous ceux qui deffinent.
Tout le côté du modèle qui n’eft point éclairé fe nomme
côté de reflet ; ceux qui commencent ne doivent
point choifir cette place, parce qu’elle fuppofe de l’art 8c
de l’expérience; mais lorfque l’on eft un peu avancé, on
en tire un très-grand profit. Ces fortes de figures doivent
être deffinées de fort peu de crayon ; c’eft-à-dire,
que les ombres doivent être tendres, les reflets bien
ménagés & foutenus par des touches frappées à propos.
Sur le premier plan, à droite, eft un éleve qui
modèle d’après l’antique. On peut regarder cette étude
comme une maniéré de deffiner propre aux Sculpteurs ;
elle s’exécute à la main 8c à l’ébauchoir fur de la terre
molle. Voyez les Planches de Sculpture.
Bas de la Planche.
Fig. i . i , i y j , 4, Plan de la falle ou école pour def-
* finer d’après nature.
A , la table fut laquelle fè pofè le modèle.
b, bacquet plein d’eau pour recevoir les égouttures
de la lampe fufpendue au-deflus.
c t CyCy c , c y ôcc. bancs ou gradins fur lefquels fè
placent les deffinateurs.
CGC, banc dit des fculpteurs, c’eft celui qu’ils occupent
pour modeler d’après nature, mais à leur
defaut les deffinateurs s’en emparent.
ddddy marche-piés des bancs.
e e y intervalle d’un banc à un autre.
a , banc pour ceux qui deffinent dans le reflet,
gggg, partages.
h y poêle.
i i , croifées que l’on bouche pendant le tems ou 1 on
deffine d’après nature qu jour, afin de ne recevoir
qu’une feule 8c même lumière de la croifée k, dont
l’ouverture a huit piés.
l l l y portes^
m, veftibule.
ii y cabinet.
ooy fàlle propre à d’autres exercices.
а. Profil des bancs.
A , la table.
a y fon pié ou focle fur lequel elle peut tourner en
tous fèns, afin de pouvoir, lorfque le modèle eft
pofé, l’éclairer le plus avantageufèment.
c e y les bancs.
C , banc des fculpteurs.
dddd y marchepics des bancs.
P L A N C H E I I .
Fig.'i. Porte crayon.
a y le crayon.
1. Crayon. .
3. Eftompe, c’eft un morceau de chamois roulle fort
ferré, lié avec du fil, & taillé en pointe émourtée
vers les extrémités. On s’en fèrt pour fondre 8c
unir enfèmble tous les coups de crayons dont on
a préparé les maffes d’ombres 8c les demi - teintes
d’une figure, en frottant légèrement, comme
avec un pinceau, une des extrémités fur toutes les
hachures, ôc on rehauflè les plus fortes ombres
par des coups de crayons hardis & des touches
franches ; cette maniéré de deffiner eft expeditive
& imite très-bien la douceur de la chair.
ît. Plume à deffiner.
y. Canif à tailler le crayon.
б. Compas. On doit obfèrver de ne point s’en fervir
pour deffiner des têtes ou des figures, mais feulement
pour s’afl'urcr des lignes perpendiculaires
ou parallèles qui fe rencontrent dans les fujets où
il entre de l’architeélure..
Les figures fuivantes font propres à deffiner a 1 encre
de la chine ou au biftre.
7. Pinceau. . .
8. Pinceaux entés en a y fur un morceau de bois ou
d’ivoire.
Çf. Pot à eau.
10. Pain d’encre de chine.
ai. Coquille pour délayer l’encre ou le biftre»
S Ë I N. .5
îz. Réglé pour tracei* les objets dont les furfaces font
des lignes droites*
15. Chevalet ou porte-originaU
a y le pié.
b b y la tige percée de trous dans fâ partie fuperieuife«
ce y les bras.
dy vis qui fixe les bras à la haüteür la plus commode
dans les trous de la tige.
e y ficelle pour fufpendre le défteiri.
ffy fiches qui attachent le dëflèin à la ficelle.
14. Selle à l’ufàge de ceux qui deffinent d’après la
boflè;
1. Plateau mobile fur lui-même, fur lequel on place
le modèle.
Zi Chapiteau de la fèlle, percé aü milieu d’un trou
dans lequel paflè la tige du plateau.
3. Tige qui fait tourner le plateau fur lui-même j
elle eft percée de trous dans fa partie! inférieure*
4. Cheville qui fert à élever la tige 8c le plateau, en
la fixant dans des trous différens.
ç. Tablette percée pour recevoir la tige} Ôc qui fèrt
de point d’appui à la cheville,
i f . Portefeuille fur lequel on deffine, en le pofant fut
fès genoux, comme on voit dans la yignette ,
Planche I.
16. abedy chaffis de rédu&ion ; ce chaffis eft un pa-
rallelograme reétangle divifé à volonté en un nombre
de carreaux égaux, formés par des fils ou des
foies très- fines, qui font attachées aux points dè
divifion marqués fur les quatre tringles où côtés
ab ybdy dcyca. On fe lèrt de cet inftrument pout
réduire un deffein ou un tableau fur lequel on ne
veut point tracer de lignes.
17. i l mn. Deflein réduit dans une grandeur donnée
opqr-y pour le faire on divifè cette grandeur pa<
des lignes au crayon en autant de carreaux que le
deffein efgh en occupe , étant pofé fous le chafi fis yfig" !<»•■ alors on trace exactement dans chacun
de ces carreaux, correfpondans à ceux de l’original,
les mêmes parties qui font comprifes fous
ceux du chaffis ; on peut fe fervir, pour ces fortes
de réduction, de l’inftrument appellé pantogra*
phe. Voyez la Planche Juivante.
P L A N C H E I I I .
Defiription & ufage du Pantographe, nommé commun/*'
ment Singe, conjidèrablement changé & perfectionné p a t
Canivet, ingénieur du Roi & de MM. de l'académie
royale des Sciences pour les inflrumens de Mathema*
tiques.
Cet inftrument eft compofé de quatre réglés dé bois
d’ébenne ou de cormier : il y en a deux grandes 8C
deux petites. Les deux grandes AB, AC (ont jointes
enfemble par une de leurs extrémités par une tige
qui les traverfe, portant un écrou par-deffus avec lequel
on leur donne plus ou moins de liberté : le bas
de cette tige eft coudé, 8c porte une roulette e , que
l’on voitfig. i,qui pofe fur la table & fe prête à tous
Iles mouvemens. Les deux autres réglés L M, M M font
attachées vers le milieu de chacune des grandes, 8c
elles font jointes enfemble par l’autre bout; enforte
que ces quatre règles forment toujours un parallelo-
grame, en quelque façon que l’on faffe mouvoir l’infr.
trument. .
Les deux grandes réglés, 8c une des petites, portent
chacune une boîte qui fe place 8c s arrête a tel
endroit que l’on veut defdites réglés, par le moyen
d’une vis placée au-deffous. Ces boîtes font chacune
percées d’un trou cylindrique fiir le côté, dans lequel
fe placent alternativement trois chofes; favoir, une
pointe à calquer, fig. 7 > f l canon, fie. 8, dans lequel
fe loge un porte-crayon qui fe hauffe ou fe baille de
lui-même, fuivant l’inégalité du plan lur lequel on
travaille, & enfin, un fupport,^?#. S, qui fe vide dans
m tabic I Sc dont le haut eft en cylindre pour enuet
dans une des boîtes ; c’eft ce fupport qui fert de point
fixe 8c autour duquel l’inftrument tourne guand on