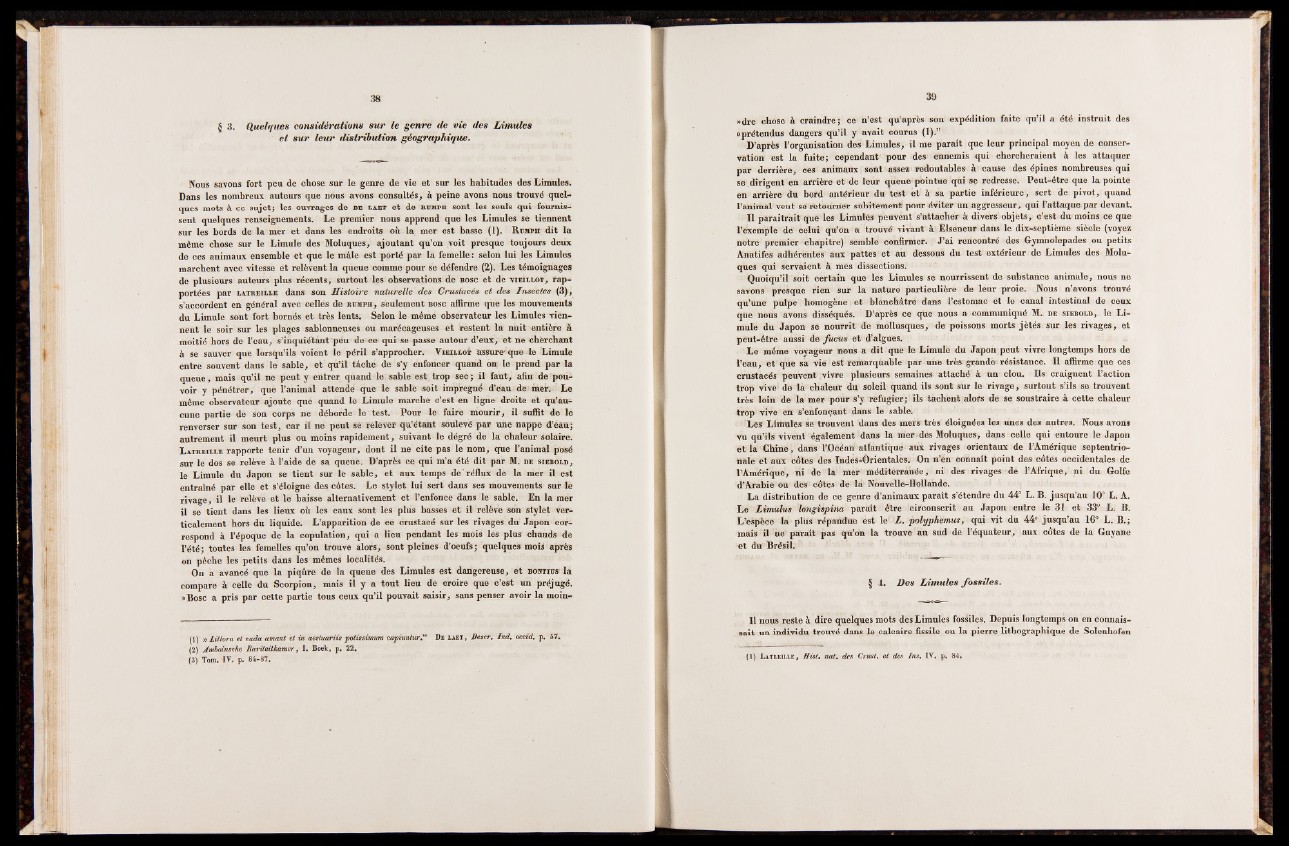
S 3 . Quelques considérations sur le genre de vie des Limules
et sur leur distribution géographique.
Nous savons fort peu de chose sur le genre de vie et sur les habitudes des Limules.
Dans les nombreux auteurs que nous avons consultés, à peine avons nous trouvé quelques
mots à ce sujet; les ouvrages de de laet et de rumph sont les seuls qui fournissent
quelques renseignements. Le premier nous apprend que les Limules se tiennent
sur les bords de la mer et dans les endroits oh la mer est basse (1). Rumph dit la
même chose sur le Limule des Moluques, ajoutant qu’on voit presque toujours deux
de ces animaux ensemble et que le mâle est porté par la femelle : selon lui les Limules
marchent avec vitesse et relèvent la queue comme pour se défendre (2). Les témoignages
de plusieurs auteurs plus récents, surtout les observations de bosc et de v ie il lo t , rapportées
par latr e il l e dans son Histoire naturelle des Crustacés et des Insectes ( 3 ) ,
s’accordent en général avec celles de rumph, seulement bosc affirme que les mouvements
du Limule sont fort bornés et très lents. Selon le même observateur les Limules viennent
le soir sur les plages sablonneuses ou marécageuses et restent la nuit entière &
moitié hors de l’eau, s’inquiétant peu dece qui se passe autour d’eux, et ne cherchant
à se sauver que lorsqu’ils voient le péril s’approcher. V ie il lo t assure'que le Limule
entre souvent dans le sable, et qu’il tâche de s’y enfoncer quand on; le prend par la
queue, mais qu’il ne peut y entrer quand le sable est trop sec; il faut, afin de pouvoir
y pénétrer, que l’animal attende que le sable soit imprégné d'eau de meir. Le
même observateur ajoute que quand le Limule marche c’est en ligne droite et qu’aucune
partie de son corps ne déborde le test. Pour le faire mourir, il suffit de le
renverser sur son test, car il ne peut se relever qu’étant soulevé par une nappe d’eau;
autrement il meurt plus ou moins rapidement, suivant lé dégré de la chaleur solaire.
L a treille rapporte tenir d’un voyageur, dont il ne cite pas le nom, que l’animal posé
sur le dos se relève à l’aide de sa queue. D’après ce qui m’a été dit par M. de siebold,
le Limule du Japon se tient sur le sable, et aux temps de'réflux de la mer il est
entraîné par elle et s’éloigne des côtes. Le stylet lui sert dans ses mouvements sur le
rivage, il le relève et le baisse alternativement et l’enfonce dans le sable. En la mer
il se tient dans les lieux où les eaux sont les plus basses et il relève son stylet verticalement
hors du liquide. L’apparition de ce crustacé sur les rivages du Japon correspond
à l’époque de la copulation, qui a lieu pendant les mois les plus chauds de
l’été; toutes les femelles qu’on trouve alors, sont pleines d’oeufs; quelques mois après
on pêche les petits dans les mêmes localités.
On a avancé que la piqûre de la queue des Limules est dangereuse, et bontius la
compare à celle du Scorpion, mais il y a tout lieu de croire que c’est un préjugé.
»Bosc a pris par cette partie tous ceux qu’il pouvait saisir, sans penser avoir la moin-
(1) » Liitora et vada amant et in aestuariis potîesimxm capiuntur." De laet, Descr. Ind. occid. p. 57.
(2) Amboinscke Bariteitkamer, I. Boek, p. 22,
(3) Tom. IV. p. 84-87.
»dre chose à craindre; ce n’est qu’après son expédition faite qu’il a été instruit des
»prétendus dangers qu’il y avait courus (1).”
D’après l’organisation des Limules, il me parait que leur principal moyen de conservation
est la fuite; cependant pour des- ennemis qui chercheraient à les attaquer
par derrière, ces animaux sont assez redoutables à cause des épines nombreuses qui
se dirigent en arrière et de leur quéuepbintue qui se redresse. Peut-être que la pointe
en arrière du bord antérieur du test- et à sa partie inférieure, sert de pivot, quand
l’animal veut së retourner subitement! pour éviter un aggresseur, qui l’attaque par devant.
Il paraîtrait que les LimttlèS peuvent s'attacher à divers' objets, c’est du moins ce que
l’exemple de celui qu'on a trouvé' vivant â Elseneur dans le dix-septième siècle (voyez
notre premier chapitre) semble confirmer. ] ■ J’ai rencontré des Gymnolepades ou petits
Anatifes adhérentes aux pattes et aii dessous du test extérieur de Limules des Moluques
qui servaient & mes dissectioüs.
Quoiqu’il soit certain que les Limules se nourrissent de substance animale, nous ne
savons presque rien sur la nature particulière de leur proie. Nous n’avons trouvé
qu’une pulpe homogène : et blanchâtre dans l’estomac et le canal intestinal de ceux
que nous avons disséqués. D’après ce qUe nous a communiqué M. de siebold, le Limule
du Japon se nourrit de mollusques, de poissons morts jétés sur les rivages, et
peut-être aussi dé fucits et d’algues.
Le même voyageur nous a dit que le Limule du Japon peut vivre longtemps hors de
l’eau, è t que sa vie est remarquable par une très: grande résistance. Il affirme que ces
crustacés peuvent ; vivre plusieurs semaines attaché à un clou. Ils craignent l’action
trop vive1 2 3 1 de la chaleur du soleil quand ils sont sur le rivage, surtout s’ils se trouvent
très loin de la mer pour s’y, réfugier; ils tâchent alors de se soustraire à cette chaleur
trop vive en s’enfonçant dans le sable.
Les Limules se trouvent dans des mers: très éloignées les unes des autres. Nous avons
vu qu’ils vivent également dans la mer des Moluques, dans celle qui entoure le Japon
et la Chine, dans l’Océan atlantique aux rivages orientaux de l’Amérique septentrionale
et aux côtes des IndéS-Orientalês.' On n’en connaît point des côtes occidentales de
l’Amérique, ni de la mer méditerrâhée, ni des rivages de l’Afrique, ni du Golfe
d’Arabie ou des côtes de hu Nouvelle-Hollande.
La distribution de ce genre d’animaux parait s’étendre du 44° L. B. jusqu’au 10° L. A.
Le Limulus longispina paraît être circonscrit au Japon entre lé 31 et 33° L. B.
L’espèce la plus répandue est le L . polyphemus, qui vit du 44° jusqu’au 16° L.B.;
mais il ne parait pas qu’on la trouve au sud de l’équateur, aux côtes de la Guyane
et du Brésil.
§ 4 . Des Limules fossiles.
Il nous reste à dire quelques mots des Limules fossiles. Depuis longtemps on en connaissait
un individu trouvé dans le calcaire fissile ou la pierre lithographique de Solenhofen
(1) Latreille, Hist. nat. des Crust. et des Ins. IV. p. 84.