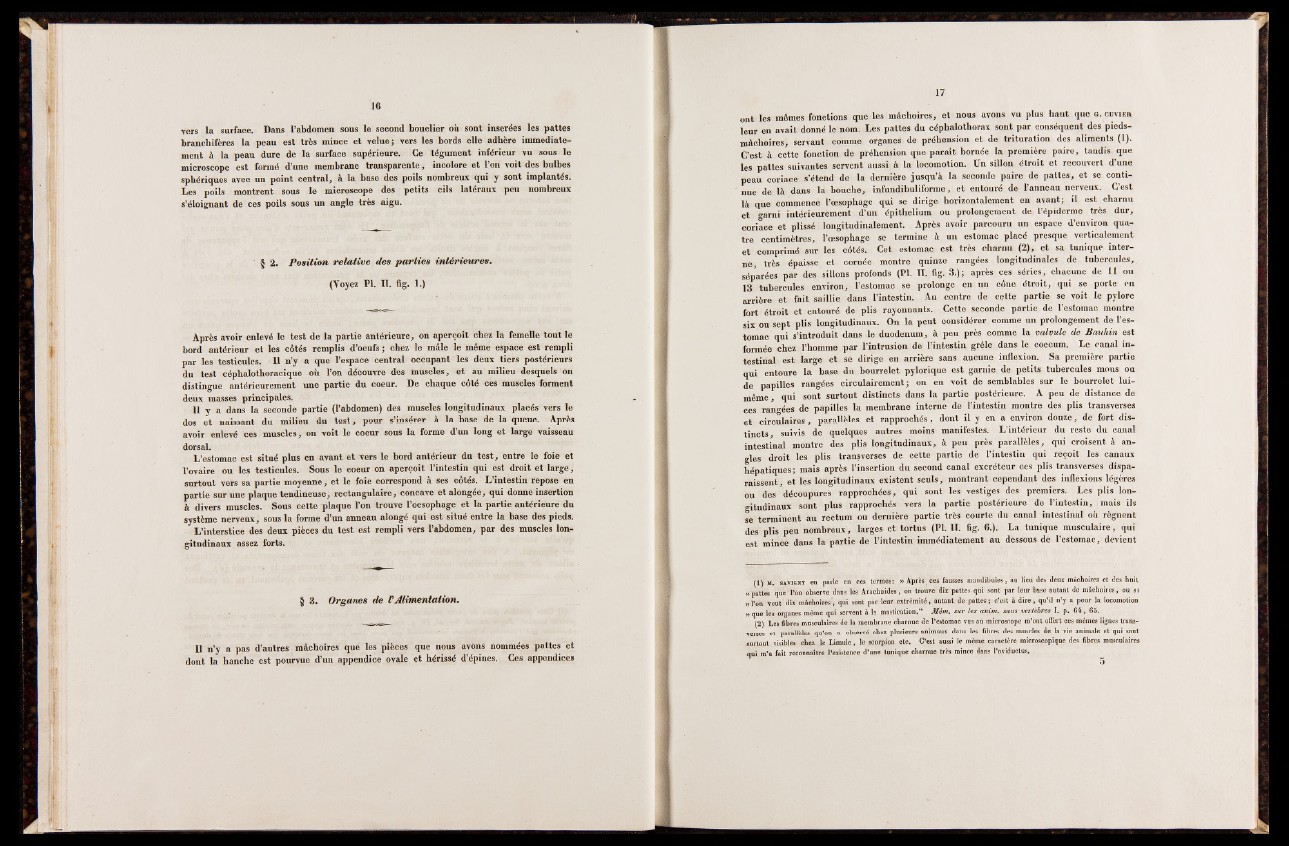
16
vers la surface. Dans l’abdomen sous le second bouclier où sont insérées les pattes
branchifères la peau est très mince et relue; vers les bords elle adhère immédiatement
à la peau dure de la surface supérieure. Ce tégument inférieur ru sous le
microscope est formé d’une membrane transparente, incolore et l’on roit des bulbes
sphériques arec un point central, à la base des poils nombreux qui y sont implantés.
Les poils montrent sous le microscope des petits cils latéraux peu nombreux
s’éloignant de ces poils sous un angle très aigu.
§ 2. Position relative des parties intérieures.
(Voyez PI. II. 6g. 1.)
Après aroir enleré le test de la partie antérieure, on aperçoit chez la femelle tout le
bord antérieur et les côtés remplis d’oeufs ; chez le mâle le même espace est rempli
par les testicules. Il n’y a que l’espace central occupant les deux tiers postérieurs
du test céphalothoracique oh l’on découvre des muscles, et au milieu desquels on
distingue antérieurement une partie du coeur. De chaque coté ces muscles forment
deux masses principales.
Il y a dans la seconde partie (l’abdomen) des muscles longitudinaux placés vers le
dos et naissant du milieu du test, pour s’insérer à la base de la queue. Après
avoir enlevé ces muscles, on voit le coeur sous la forme d’un long et large vaisseau
dorsal.
L’estomac est situé plus en avant et Vers le bord antérieur du test, entre le foie et
l’ovaire ou les testicules. Sous le coeur on aperçoit l’intestin qui est droit et large,
surtout vers sa partie moyenne, et le foie correspond à ses côtés. L’intestin repose en
partie sur une plaque tendineuse, rectangulaire, concave et alongée, qui donne insertion
à divers muscles. Sous cette plaque l’on trouve l’oesophage et la partie antérieure du
système nerveux, sous la forme d’un anneau alongé qui est situé entre la base des pieds.
L’interstice des deux pièces du test est rempli vers l’abdomen, par des muscles longitudinaux
assez forts.
§ 3. Organes de VAlimentation.
Il n’y a pas d’autres mâchoires que les pièces que nous avons nommées pattes et
dont la hanche est pourvue d’un appendice ovale et hérissé d’épines. Ces appendices
ont les mêmes fonctions que les mâchoires, et nous avons vu plus haut que » .cuvier
leur en avait donné le nom. Les pattes du céphalothorax sont par conséquent des pieds-
mâchôires, servant comme organes de préhension et de trituration des aliments (1).
C’est à cette fonction de préhension que parait bornée la première paire, tandis que
les pattes suivantes servent aussi à la locomotion. Un sillon étroit et recouvert d’une
peau coriace s’étend de la dernière jusqu’à la seconde paire de pattes, et se continue
de là dans la bouche, infundibuliforme, et entouré de l’anneau nerveux. C’est
là que commence l’oesophage qui se dirige horizontalement en avant; il est charnu
et «•ami intérieurement d’un épithélium ou prolongement de l’épiderme très dur,
coriace et plissé longitudinalement. Après avoir parcouru un espace d’environ quatre
centimètres, l’oesophage se termine à un estomac placé presque verticalement
et comprimé sur les côtés. Cet estomac est très charnu (2), et sa tunique interne
très épaisse et cornée montre quinze rangées longitudinales de tubercules,
séparées par des sillons profonds (PI. II. fig. 3.); après ces séries, chacune de II ou
13 tubercules environ, l’estomac se prolonge en un cône étroit, qui se porte en
arrière et fait saillie dans l’intestin. Au centre de cette partie se voit le pylore
fort étroit et entouré de plis rayonnants. Cette seconde partie de l’estomac montre
six ou sept plis longitudinaux. On la peut considérer comme un prolongement de l’estomac
qui s’introduit dans le duodénum, à peu près comme la valvule de Bauhin est
formée chez l’homme par l’intrusion de l’intestin grêle dans le coecum. Le canal intestinal
est large et se dirige en arrière sans aucune inflexion. Sa première partie
qui entoure la base du bourrelet pylorique est garnie de petits tubercules mous ou
de papilles rangées circulairement ; on en voit de semblables sur le bourrelet lui-
même, qui sont surtout distincts dans la partie postérieure. A peu de distance de
ces rangées de papilles la membrane interne de l’intestin montre des plis transverses
et circulaires, parallèles et rapprochés, dont il y en a environ douze, de fort distincts
suivis de quelques autres moins manifestes. L’intérieur du reste du canal
intestinal montre des plis longitudinaux, à peu près parallèles, qui croisent à angles
droit les plis transverses de cette partie de l’intestin qui reçoit les canaux
hépatiques; mais après l’insertion du second canal excréteur ces plis transverses disparaissent
et les longitudinaux existent seuls, montrant cependant des inflexions légères
ou des découpures rapprochées, qui sont les vestiges des premiers. Les plis longitudinaux
sont plus rapprochés vers la partie postérieure de l’intestin, mais ils
se terminent au rectum ou dernière partie très courte du canal intestinal où régnent
des plis peu nombreux, larges et tortus (PI. II. 6g. 6.). La tunique musculaire, qui
est mince dans la partie de l’intestin immédiatement au dessous de l’estomac, devient
(1) M. sa VIGNY en parle en ces termes: »Après ces fausses mandibules, au lieu des deux mâchoires et des huit
»pattes que l’on observe dans les Arachnides, on trouve dix pattes qui sont par leur base autant de mâchoires, ou si
» l ’on veut dix mâchoires', qui sont par leur extrémité, autant de pattes; c’est à d ire, qu’il n’y a pour la locomotion
»que les organes même qui servent à la mastication.’’ Mém. sur les anim. sans vertèbres I. p. 6 4 , 65.
(2) Les fibres musculaires de la membrane charnue de l’estomac vus au microscope m’ont offert ces mêmes lignes trans-
verses et parallèles qu’on a observé chez plusieurs animaux dans les fibres des muscles de la vie animale et qui sont
surtout visibles chez le Limule, le scorpion etc. C’est aussi le même caractère microscopique des fibres musculaires
qui m’a fait reconnaître l’existence d’une tunique charnue très mince dans l’oviductus.