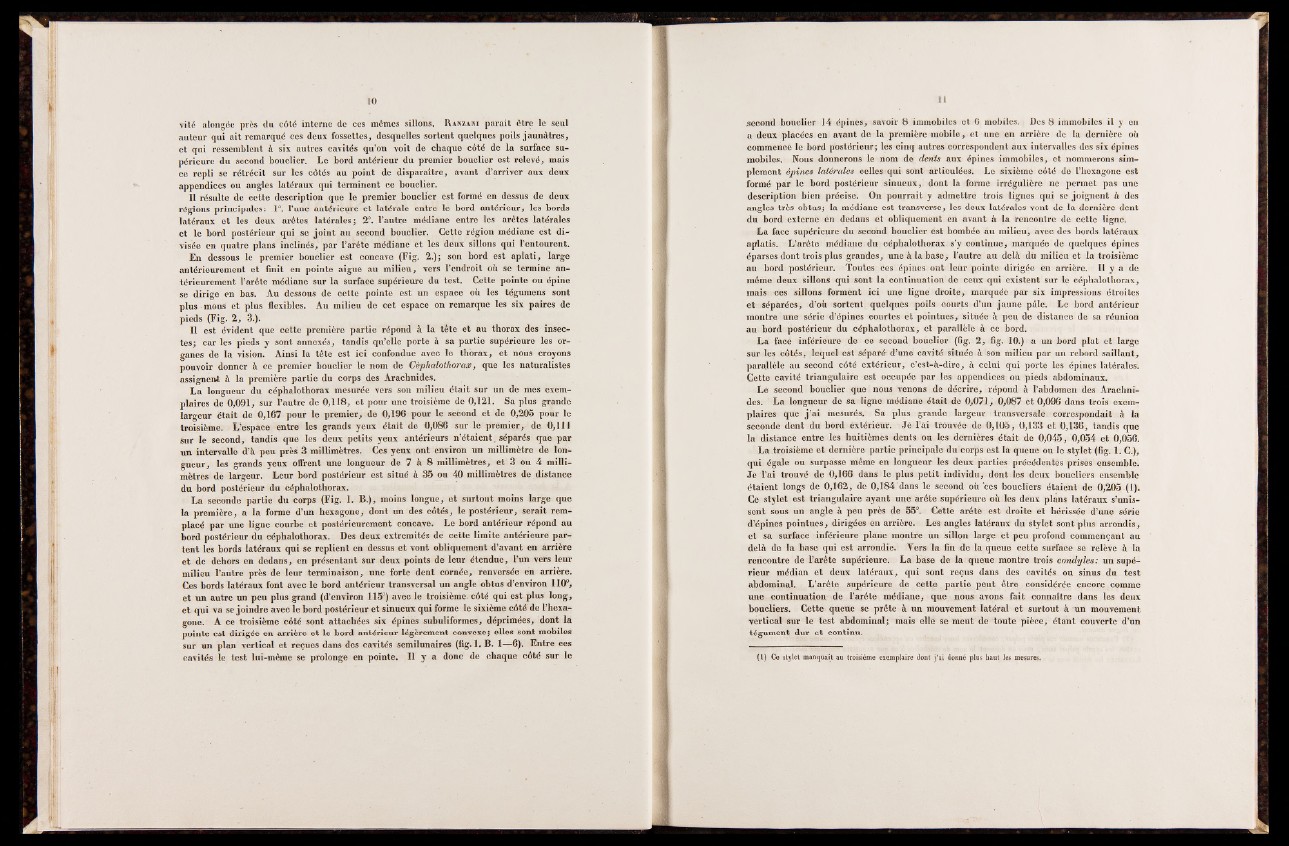
vité alongée près du côté interne de ces mêmes sillons. Ranzawi parait être le seul
auteur qui ait remarqué ces deux fossettes, desquelles sortent quelques poils jaunâtres,
et qui ressemblent à six autres cavités qu’on voit de chaque côté de la surface supérieure
du second bouclier. Le bord antérieur du premier bouclier est relevé, mais
ce repli se rétrécit sur les côtés au point de disparaître, avant d’arriver aux deux
appendices ou angles latéraux qui terminent ce bouclier.
Il résulte de cette description que le premier bouclier est formé en dessus de deux
régions principales: 1°. l’une antérieure et latérale entre le bord antérieur, les bords
latéraux et les deux arêtes, latérales; 2°. l’autre médiane entre les arêtes latérales
et le bord postérieur qui se joint au second bouclier. Cette région médiane est divisée
en quatre plans inclinés, par l’arête médiane et les deux sillons qui l’entourent.
En dessous le premier bouclier est concave (Fig. 2.); son bord est aplati, large
antérieurement et finit en pointe aigue au milieu, vers l’endroit où se termine antérieurement
l’arête médiane sur la surface supérieure du test. Cette pointe ou épine
se dirige en bas. Au dessous de cette pointe est un espace où les tégumens sont
plus mous et plus flexibles. Au milieu de cet espace on remarque les six paires de
pieds (Fig. 2, 3.).
Il est évident que cette première partie répond à la tête et au thorax des insectes;
car les pieds y sont annexés, tandis qu’elle porte à sa partie supérieure les organes
de la vision. Ainsi la tête est ici confondue avec le thorax, et nous croyons
pouvoir donner à ce premier bouclier le nom de Céphalothorax, que les naturalistes
assignent à la première partie du corps des Arachnides.
La longueur du céphalothorax mesurée vers son milieu était sur un de mes exemplaires
de 0,091, sur l’autre de 0,118, et pour une troisième de 0,121. Sa plus grande
largeur était de 0,167 pour le premier, de 0,196 pour le second et de 0,205 pour le
troisième. L’espace entre les grands yeux était de 0,086 sur le premier, de 0,111
sur le second, tandis que les deux petits yeux antérieurs n’étaient, séparés que par
un intervalle d’à peu près 3 millimètres. Ces yeux ont environ un millimètre de longueur,
les grands yeux offrent une longueur de 7 à 8 millimètres, et 3 ou 4 millimètres
de largeur. Leur bord postérieur est situé à 35 ou 40 millimètres de distance
du bord postérieur du céphalothorax.
La seconde partie du corps (Fig. 1. B.), moins longue, et surtout moins large que
la première, a la forme d’un hexagone, dont un des côtés, le postérieur, serait remplacé
par une ligne courbe et postérieurement concave. Le bord antérieur répond au
bord postérieur du céphalothorax. Des deux extrémités de cette limite antérieure partent
les bords latéraux qui se replient en dessus et vont obliquement d’avant en arrière
et de dehors en dedans, en présentant sur deux points de leur étendue, l’un vers leur
milieu l’autre près de leur terminaison, une forte dent cornée, renversée en arrière.
Ces bords latéraux font avec le bord antérieur transversal un angle obtus d’environ 1109,
et un autre un peu plus grand (d’environ 115°) avec le troisième, côté qui est plus long,
et qui va se joindre avec le bord postérieur et sinueux qui forme le sixième côté de l’hexagone.
A ce troisième côté sont attachées six épines subuliformes, déprimées, dont la
pointe est dirigée en arrière et le bord antérieur légèrement convexe; elles sont mobiles
sur un plan vertical et reçues dans des cavités semilunaires (fig. 1. B. 1—6). Entre ces
cavités le test lui-même se prolonge en pointe. Il y a donc de chaque côté sur le
.second bouclier 14 épines, savoir 8 immobiles et 6 mobiles. Des 8 immobiles il y en
a deux placées en avant de la première mobile, et une en arrière de la dernière où
commence le bord postérieur; les cinq autres correspondent aux intervalles des six épines
mobiles. Nous donnerons le nom de dents aux épines immobiles, et nommerons simplement
épines latérales celles qui sont articulées. Le sixième côté de l’hexagone est
formé par le bord postérieur sinueux, dont la forme irrégulière ne permet pas une
description bien précise. On pourrait y admettre trois lignes qui se joignent à des
angles très obtus; la médiane est transverse, les deux latérales vont de la dernière dent
du bord externe en dedans et obliquement en avant à la rencontre de cette ligne.
La face supérieure du second bouclier est bombée au milieu, avec des bords latéraux
aplatis. L’arête médiane du céphalothorax s’y continue, marquée de quelques épines
éparses dont trois plus grandes, une à la base, l’autre au delà du milieu et la troisième
au bord postérieur. Toutes ces épines ont leur pointe dirigée en arrière. Il y a de
même deux sillons qui sont la continuation de ceux qui existent sur le céphalothorax,
mais ces sillons forment ici une ligne droite, marquée par six impressions étroites
et séparées, d’où sortent quelques poils courts d’un jaune pâle. Le bord antérieur
montre une série d’épines courtes et pointues, située à peu de distance de sa réunion
au bord postérieur du céphalothorax, et parallèle à ce bord.
La face inférieure de ce second bouclier (fig. 2, fig. 10.) a un bord plat et large
sur les côtés, lequel est séparé- d’une cavité située à son milieu par un rebord saillant,
parallèle au second côté extérieur, c’est-à-dire, à celui qui porte les épines latérales.
Cette cavité triangulaire est occupée par les appendices ou pieds abdominaux.
Le second bouclier que nous venons de décrire, répond à l’abdomen des Arachnides.
La longueur de sa ligne médiane était de 0,071, 0,087 et 0,096 dans trois exemplaires
que j ’ai mesurés. Sa plus grande largeur transversale correspondait à la
seconde dent du bord extérieur. Je l’ai trouvée de 0,105 , 0,133 et 0,136, tandis que
la distance entre les huitièmes dents ou les dernières était de 0,045 , 0,054 et 0,056.
La troisième et dernière partie principale du corps est là queue ou le stylet (fig. 1. C.),
qui égale ou surpasse même en longueur les deux parties précédentès prises ensemble.
Je l’ai trouvé de 0,166 dans le plus petit individu, dont les deux boucliers ensemble
étaient longs de 0,162, de 0,184 dans le second où ces boucliers étaient de 0,205 (1).
Ce stylet est triangulaire ayant une arête supérieure où les deux plans latéraux s’unissent
sous un angle à peu près de 55°. Cette arête est droite et hérissée d’une série
d’épines pointues, dirigées en arrière. Les angles latéraux du stylet sont plus arrondis,
et sa surface inférieure plane montre un sillon large et peu profond commençant au
delà de la base qui est arrondie. Vers la fin de la queue cette surface se relève à la
rencontre de l’arête supérieure. La base de la queue montre trois condyles: un supérieur
médian et deux latéraux, qui sont reçus dans des cavités ou sinus du test
abdominal. L’arête supérieure de cette partie peut être considérée encore comme
une continuation de l’arête médiane, que nous avons fait connaître dans les deux
boucliers. Cette queue se prête à un mouvement latéral et surtout à un mouvement
vertical sur le test abdominal; mais elle se meut de toute pièce, étant couverte d’un
tégument dur et continu.
(1) Ce stylet manquait au troisième exemplaire dont j’ai donné plus haut les mesures.