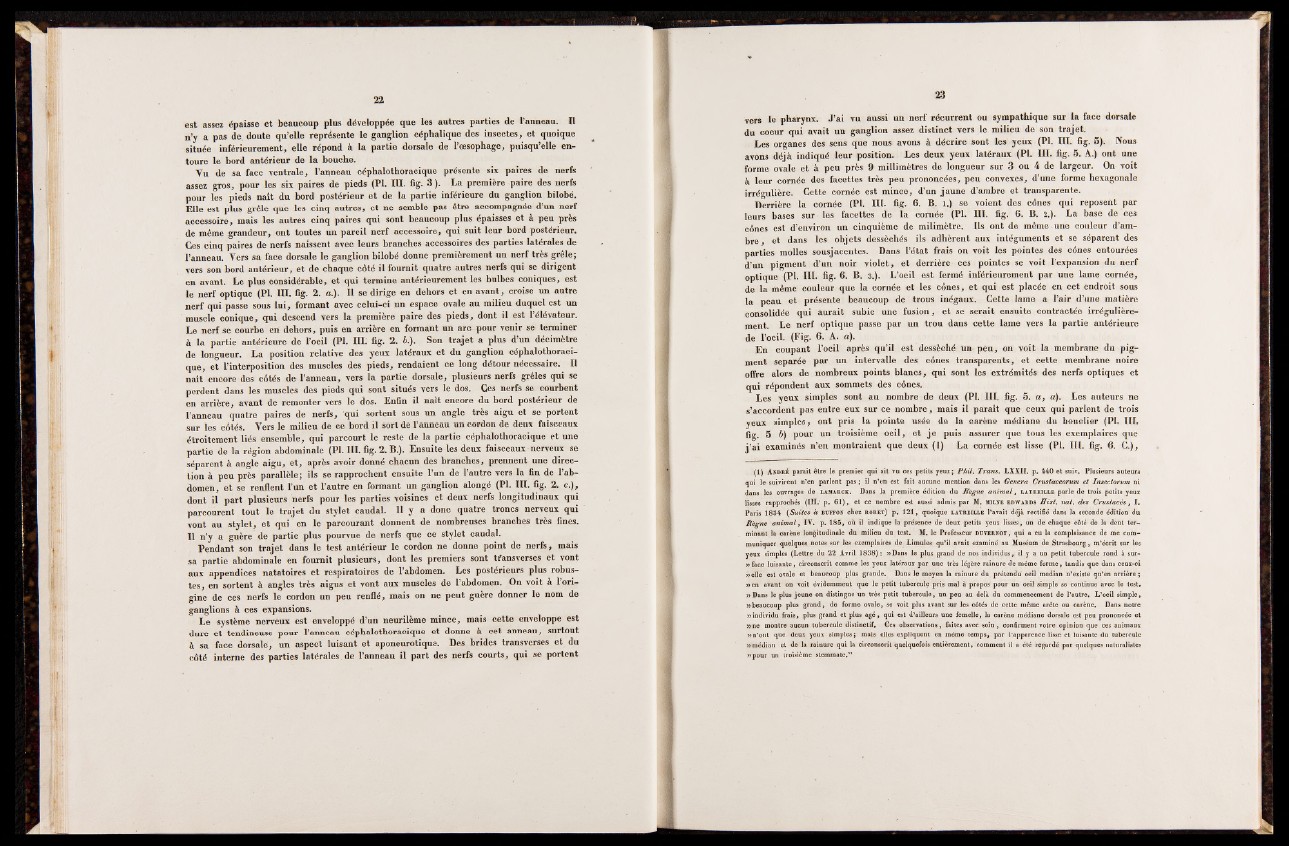
est assez épaisse et beaucoup plus développée que les autres parties de l’anneau. Il
n’y a pas de doute qu’elle représente le ganglion céphalique des insectes, et quoique
située inférieurement, elle répond à la partie dorsale de l’oesophage, puisqu’elle entoure
le bord antérieur de la bouche.
Vu de sa face ventrale, l’anneau céphalothoracique présente six paires de nerfs
assez gros, pour les six paires de pieds (PI. III. fig. 3 ). La première paire des nerfs
pour les pieds naît du bord postérieur et de la partie inférieure du ganglion bilobé.
Elle est plus grêle que les cinq autres, et ne semble pas être accompagnée d’un nerf
accessoire, mais les autres cinq paires qui sont beaucoup plus épaisses et à peu près
de même grandeur, ont toutes un pareil nerf accessoire, qui suit leur bord postérieur.
Ces cinq paires de nerfs naissent avec leurs branches accessoires des parties latérales de
l’anneau. Vers sa face dorsale le ganglion bilobé donne premièrement un nerf très grêle;
vers son bord antérieur, et de chaque côté il fournit quatre autres nerfs qui se dirigent
en avant. Le plus considérable, et qui termine antérieurement les bulbes coniques, est
le nerf optique (PI. III. fig. 2. a.). Il se dirige en dehors et en avant, croisé un autre
nerf qui passe sous lui, formant avec celui-ci un espace ovale au milieu duquel est un
muscle conique, qui descend vers la première paire des pieds, dont il est l’élévateur.
Le nerf se courbe en dehors, puis en arrière en formant un arc pour venir se terminer
à la partie antérieure de l’oeil (PI. III: fig. 2. b.). Son trajet a plus d’un décimètre
de longueur. La position relative des yeux latéraux et du ganglion céphalothoracique,
et l’interposition des muscles des pieds, rendaient ce long détour nécessaire. Il
naît encore des côtés de l’anneau, vers la partie dorsale, plusieurs nerfs grêles qui se
perdent dans les muscles des pieds qui sont situés vers le dos. Ces nerfs se courbent
en arrière, avant de remonter vers le dos. Enfin il naît encore du bord postérieur de
l’anneau quatre paires de nerfs, 'qui sortent sous un angle très aigu et se portent
sur les côtés. Vers le milieu de ce bord il sort de l’anneau un cordon de deux faisceaux
étroitement liés ensemble, qui parcourt le reste de la partie céphalothoracique et une
partie de la région abdominale (PI. III. fig. 2. B.). Ensuite les deux faisceaux nerveux se
séparent à angle aigu, et, après avoir donné chacun des branches, prennent une direction
à peu près parallèle; ils se rapprochent ensuite l’un de l’autre vers la fin de l’abdomen,
et se renflent l’un et l’autre en formant un ganglion alongé (PI. III. fig. 2. c.),
dont il part plusieurs nerfs pour les parties voisines et deux nerfs longitudinaux qui
parcourent tout le trajet du stylet caudal. 11 y a donc quatre troncs nerveux qui
vont au stylet, et qui en le parcourant donnent de nombreuses branches très fines.
11 n’y a guère de partie plus pourvue de nerfs que ce stylet caudal.
Pendant son trajet dans le test antérieur le cordon ne donne point de nerfs, mais
sa partie abdominale en fournit plusieurs, dont les premiers sont tfansverses et vont
aux appendices natatoires et respiratoires de l’abdomen. Les postérieurs plus robustes,
en sortent à angles très aigus et vont aux muscles de l’abdomen. On voit à l’origine
de ces nerfs le cordon un peu renflé, mais on ne peut guère donner le nom de
ganglions à ces expansions.
Le système nerveux est enveloppé d’un neurilème mince, mais cette enveloppe est
dure et tendineuse pour l’anneau céphalothoracique et donne à cet anneau, surtout
à sa face dorsalé, un aspect luisant et aponeurotique. Des brides transverses et du
côté interne des parties latérales de l’anneau il part des nerfs courts, qui se portent
vers le pharynx. J ’ai vu aussi un nerf récurrent ou sympathique sur la face dorsale
du coeur qui avait un ganglion assez distinct vers le milieu de son trajet.
Les organes des sens que nous avons à décrire sont les yeux (PI. III. fig. 5). Nous
avons déjà indiqué leur position. Les deux yeux latéraux (PI. III. fig. 5. A.) ont une
forme ovale et à peu près 9 millimètres de longueur sur 3 ou 4 de largeur. On voit
à leur cornée des facettes très peu prononcées, peu convexes, d’une forme hexagonale
irrégulière. Cette cornée est mince, d’un jaune d’ambre et transparente.
Derrière la cornée (PI. III. fig. 6. B. 1.) se voient des cônes qui reposent par
leurs bases sur les facettes de la cornée (PI. III. fig. 6. B. 2.). La base de ces
cônes est d’environ un cinquième de milimètre. Ils ont de même-une couleur d’ambre
et dans les objets desséchés ils adhèrent aux intéguments et se séparent des
parties molles sousjacentes. Dans l’état frais on voit les pointes des cônes entourées
d’un pigment d’un noir violet, et derrière ces pointes se voit l’expansion du nerf
optique (PI. III. fig. B. B. 3.). L’oeil est fermé inférieurement par une lame cornée,
de la même couleur que la cornée et les cônes, et qui est placée en cet endroit sous
la peau et présente beaucoup de trous inégaux. Cette lame a l’air d’une matière
consolidée qui aurait subie une fusion, et se serait ensuite contractée irrégulièrement.
Le nerf optique passe par un trou dans cette lame vers la partie antérieure
de l’oeil. (Fig. 6. A. a).
En coupant l’oeil après qu’il est desséché un peu, on voit la membrane du pigment
séparée par un intervalle des cônes transparents, et cette membrane noire
offre alors de nombreux points blancs, qui sont les extrémités des nerfs optiques et
qui répondent aux sommets des cônes.
Les yeux simples sont au nombre de deux (PI. III. fig. 5. a3 a). Les auteurs ne
s’accordent pas entre eux sur ce nombre, mais il paraît que ceux qui parlent de trois
yeux simples, ont pris la pointe usée de la carène médiane du bouclier (PI. III.
fig. 5 b) pour un troisième oeil, et je puis assurer que tous les exemplaires que
j ’ai examinés n’en montraient que deux (I) La cornée est lisse (PI. III. fig. 6. C.),
(1) André parait être le premier qui ait vu ces petits yeux ; PAil. Traits. LXXII. p. 440 et suiv. Plusieurs auteurs
qui le' suivirent n’en parlent pas ; il n'en est fait aucune mention dans les Généra Crustaceorum et Insectorum ni
dans les ouvrages de laharck. Dans la première édition du Régné animal, latreille parle de trois petits yeux
lisses rapprochés (111.’ p. 6 1 ), et ce nombre est aussi admis par M. milne edwards Hist. nat. des Crustacés, I.
Paris 1834 (Suites à ruffon chez roret) p. 12 1 , quoique latreille l’avait déjà rectifié dans la seconde édition du
Règne animal, IV. p. 18 5 , où il indique la présence de deux petits yeux lisses, un de chaque côté de la dent terminant
la carène longitudinale du milieu du test. M. le Professeur duvernot, qui a eu la complaisance de me communiquer
quelques notes sur les exemplaires de Limules qu’il avait examiné au Muséum de Strasbourg, m’écrit sur les
yeux simples (Lettre du 22 Avril 1838): »Dans le plus grand de nos individus, il y a un petit tubercule rond à sur-
»face luisante, circonscrit comme les yeux latéraux par une très légère rainure de même forme, tandis que dans ceux-ci
»elle est ovale et beaucoup plus grande. Dans le moyen la rainure du prétendu oeil médian n’existe qu’en arrière ;
» en avant on voit évidemment que le petit tubercule pris mal à propos pour un oeil simple se continue avec le test,
»Dans le plus jeune on distingue'un très petit tubercule, un peu au delà du commencement de l’autre. L’oeil simple,
»beaucoup plus grand, de forme ovale, se voit plus avant sur les côtés de cette même arête ou carène. Dans notre
»individu frais, plus grand et plus âgé, qui est d’ailleurs une femelle, la carène médiane dorsale est peu prononcée et
»n e montre aucun tubercule distinctif. Ces observations, faites avec soin, confirment votre opinion que ces animaux
» n ’ont que deux yeux simples; mais elles expliquent en même temps, par l’apparence lisse et luisante du tubercule
»médian et de la rainure qui la circonscrit quelquefois entièrement, comment il a été regardé par quelques naturalistes
»pour un troisième stemmate."