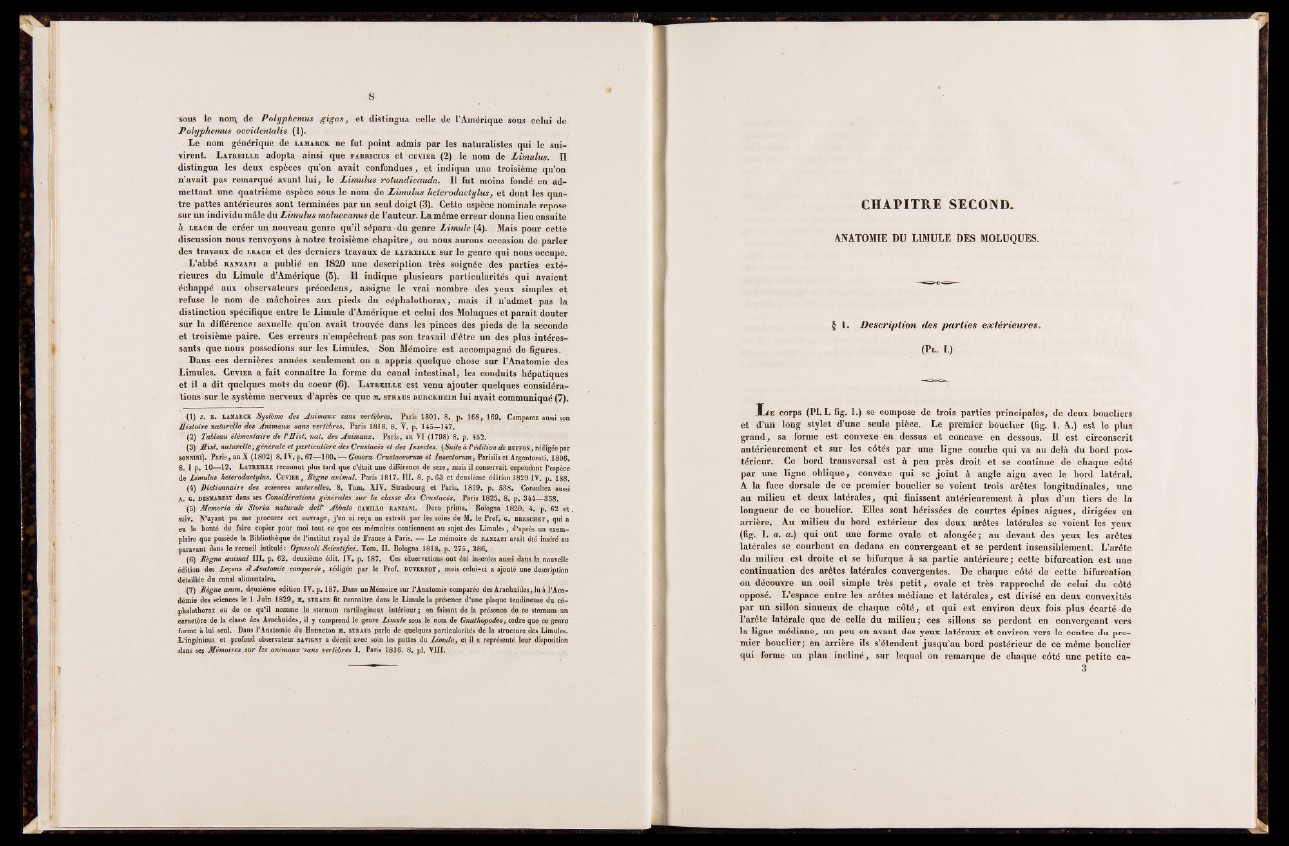
sous le non\ de Polyphemus gigas, et distingua celle de l’Amérique sous celui de
Polyphemus occidentalis (1).
Le nom générique de lamarck ne fut point admis par les naturalistes qui le suivirent.
L atreille adopta ainsi que fabricius et cuvier (2) le nom de Limulus. Il
distingua les deux espèces qu’on avait confondues, et indiqua une troisième qu’on
n’avait pas remarqué avant lui, le Limulus rotundicauda. Il fut moins fondé en admettant
une quatrième espèce sous le nom de Limulus heterodactylus, et dont les quatre
pattes antérieures sont terminées par un seul doigt (3). Cette espèce nominale repose
sur un individu mâle du Limulus moluccanus de l’auteur. La même erreur donna lieu ensuite
à leach de créer un nouveau genre qu’il sépara • du genre Limule (4 ). Mais pour cette
discussion nous renvoyons à notre troisième chapitre, ou nous aurons occasion de parler
des travaux de leach et des derniers travaux de la treille sur le genre qui nous occupe.
L’abbé ranzari a publié en 1820 une description très soignée des parties extérieures
du Limule d’Amérique (5). Il indique plusieurs particularités qui avaient
échappé aux observateurs précedens, assigne le vrai nombre des yeux simples et
refuse le nom de mâchoires aux pieds du céphalothorax, mais il n’admet pas la
distinction spécifique entre le Limule d’Amérique et celui des Moluques et parait douter
sur la différence sexuelle qu’on avait trouvée dans les pinces des pieds de la seconde
et troisième paire. Ces erreurs n’empêchent pas son travail d’être un des plus intéressants
que nous possédions sur les Limules. Son Mémoire est accompagné de figures.
Dans ces dernières années seulement on a appris quelque chose sur l’Anatomie des
Limules. Cuvier a fait connaître la forme du canal intestinal, les conduits hépatiques
et il a dit quelques mots du coeur (6). L a treille est venu ajouter quelques considérations
sur le système nerveux d’après ce que m. straus durckheim lui avait communiqué (7).
(1) J. B. lama R ck Système des Animaux sans vertèbres. Paris 1801. 8. p. 1 6 8 , 169. Comparez aussi son
Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres. Paris 1818. 8. V. p. 145—147.
(2) Tableau élémentaire de VHist. nal. des Animaux. Paris, an VI (1798) 8. p. 452.
(3) Hist. naturelle, générale et particulière des Crustacés et des Insectes. (Suite à Védition de buffon , rédigée par
sONNTNl). Paris , an X (1802) 8. IV. p. 67— 100. — Généra Crustaceorum et Insectorum, Parisiis et Argentorati. 1806.
8. I p. 10— 12. Latreille reconnut plus tard que c'était une différence.de sexe, mais il conservait cependant l'espèce
de Limulus heterodactylus. Cuvier, Règne animal. Paris 1817. III. 8. p. 63 et deuxième édition 1829 IV. p. 188.
(4) Dictionnaire des sciences naturelles. 8. Tom. XIV. Strasbourg et Paris. 1819. p. 538. Consultez aussi
a. 6. desmarest dans ses Considérations générales sur la classe des Crustacés. Paris 1825. 8. p. 344— 358.
'(5) Memorie de Storia naturale deW Abbate camillo ranzani. Deçà prima. Bologna 1820. 4. p. 62 e t .
suiv. N’ayant pu me procurer cet ouvrage, j ’en ai reçu un extrait par les soins de M. le Prof. G. breschet , qui a
eu la bonté de faire copier pour moi tout ce que ces mémoires contiennent au sujet des Limules, d’après un exemplaire
que possède la Bibliothèque de l’institut royal de France à Paris. — Le mémoire de ranzani avait été inséré au
-parafant dans le recueil intitulé: Opuscoli Scientifioi. Tom. II. Bologna 1818. p. 2 7 5 , 286.
(6) Règne animal III. p. 62. deuxième édit. IV, p. 187. Ces observations ont été insérées aussi dans la nouvelle
édition des Leçons A Anatomie comparée, rédigée par le Prof, duyernot, mais celui-ci a ajouté une description
détaillée du canal alimentaire.
(7) Régne anvm. deuxième édition IV. p. 187. Dans un Mémoire sur l’Anatomie comparée des Arachnides, lu à l’Académie
des sciences le 1 Juin 1829, M. straus fit connaître dans le Limule la présence d’une plaque tendineuse du céphalothorax
ou de ce qu'il nomme le sternum cartilagineux intérieur ; en faisant de la présence de ce sternum un
caractère de la classe des Arachnides, il y comprend le genre Limule sous le nom de Gnathopodes, ordre que ce genre
forme à lui seul. Dans l’Anatomie du Hanneton H. straus parle de quelques particularités de la structure des Limules.
.L’ingénieux et profond observateur savignt a décrit avec soin les pattes du Limule, et il a représenté leur disposition
.dans se? Mémoires sur les animaux'sans vertèbres I. Paris 1816. 8. pl. VIII.
CHAPITRE SECOND,
ANATOMIE DU LIMULE DES MOLUQUES.
§ 1. Description des parties extérieures.
(Pl. I.)
L e corps (Pl. I. fig. 1.) se compose de trois parties principales, de deux boucliers
et d’un long stylet d’une seule pièce. Le premier bouclier (fig. 1. A.) est le plus
grand, sa forme est convexe en dessus et concave en dessous. Il est circonscrit
antérieurement et sur les cêtés par une ligne courbe qui va au delà du bord postérieur.
Ce bord transversal est à peu près droit et se continue de chaque coté
par une ligne oblique, convexe qui se joint à angle aigu avec le bord latéral.
A la face dorsale de ce premier bouclier se voient trois arêtes longitudinales, une
au milieu et deux latérales, qui finissent antérieurement à plus d’un tiers de la
longueur de ce bouclier. Elles sont hérissées de courtes épines aigues, dirigées en
arrière. Au milieu du bord extérieur des deux arêtes latérales se voient les yeux
(fig. 1 . a.) qui ont une forme ovale et alongée ; au devant des yeux les arêtes
latérales se courbent en dedans en convergeant et se perdent insensiblement. L’arête
du milieu est droite et se bifurque à sa partie antérieure ; cette bifurcation est une
continuation des arêtes latérales convergentes. De chaque cêté de cette bifurcation
on découvre un oeil simple très p etit, ovale et très rapproché de celui du côté
opposé. L’espace entre les arêtes médiane et latérales, est divisé en deux convexités
par un sillon sinueux de chaque côté, et qui est environ deux fois plus écarté de
l’arête latérale que de celle du milieu; ces sillons se perdent en convergeant vers
la ligne médiane, un peu en avant des yeux latéraux et environ vers le centre du premier
bouclier; en arrière ils s’étendent jusqu’au bord postérieur de ce même bouclier
qui forme un plan incliné, sur lequel on remarque de chaque côté une petite ca