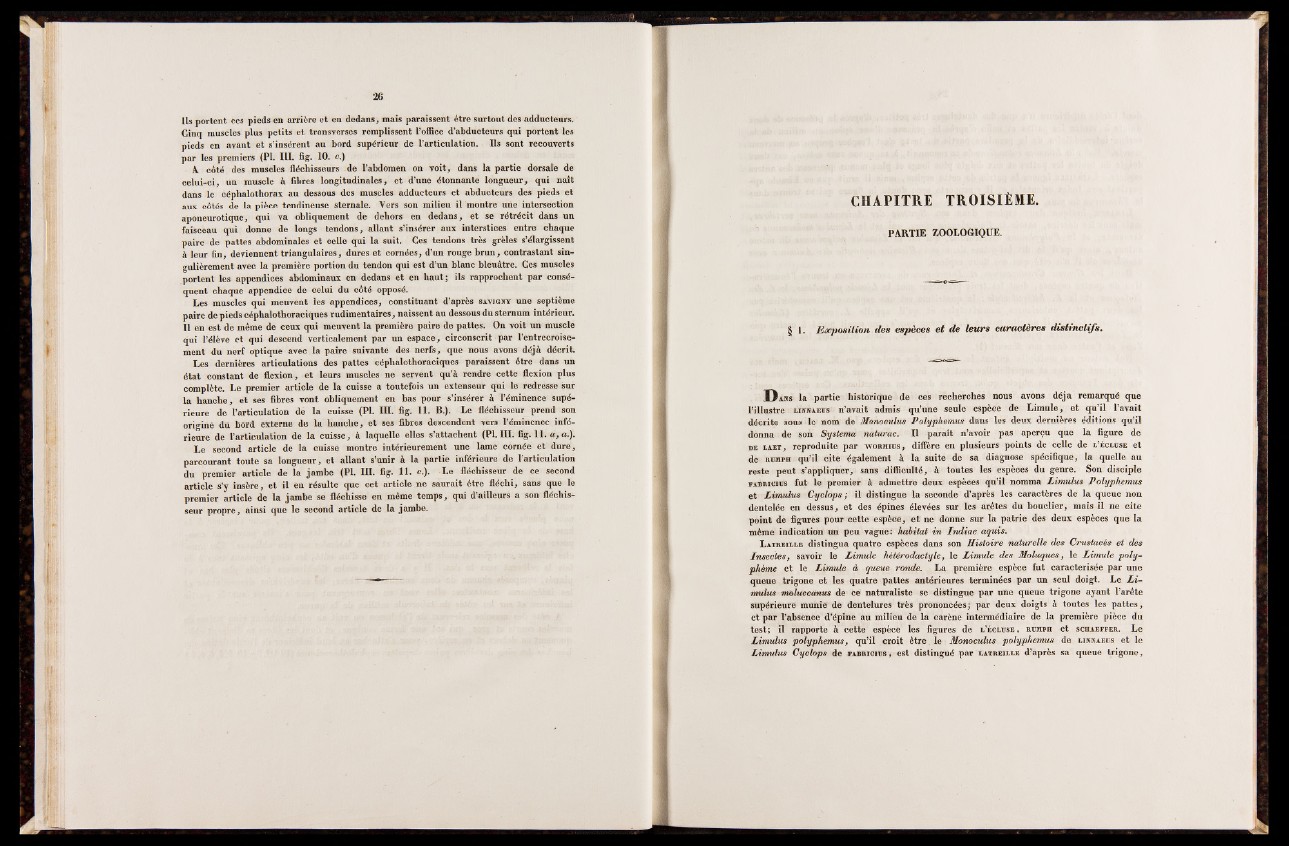
Us portent ces pieds en arrière et en dedans, mais paraissent être surtout des adducteurs.
Cinq muscles plus petits et transverses remplissent l’office d’abducteurs qui portent les
pieds en avant et s’insèrent au bord supérieur de l’articulation. Ils sont recouverts
par les premiers (PI. IlL fig. 10. c.)
A côté des muscles fléchisseurs de l’abdomen on voit, dans la partie dorsale de
celui-ci, un muscle à fibres longitudinales, et d’une étonnante longueur, qui nait
dans le céphalothorax au dessous des muscles adducteurs et abducteurs des pieds et
aux côtés de la pièce tendineuse sternale. Vers son milieu il montre une intersection
aponeurotique, qui va obliquement de dehors en dedans, et se rétrécit dans un
faisceau qui donne de longs tendons, allant s’insérer aux interstices entre chaque
paire de pattes abdominales et celle qui la suit. Ces tendons très grêles s’élargissent
à leur fin, deviennent triangulaires, dures et cornées, d’un rouge brun, contrastant singulièrement
avec la première portion du tendon qui est d’un blanc bleuâtre. Ces muscles
portent les appendices abdominaux en dedans et en haut; ils rapprochent par conséquent
chaque appendice de celui du côté opposé.
Les muscles qui meuvent les appendices, constituant d’après savigut une septième
paire de pieds céphalothoraciques rudimentaires, naissent au dessous du sternum intérieur.
Il en est de même de ceux qui meuvent la première paire de pattes. On voit un muscle
qui l’élève et qui descend verticalement par un espace, circonscrit par l’entrecroisement
du nerf optiqne avec la paire suivante des nerfs, que nous avons déjà décrit.
Les dernières articulations des pattes céphalothoraciques paraissent être dans un
état constant de flexion, et leurs muscles ne servent qu’à rendre cette flexion plus
complète. Le premier article de la cuisse a toutefois un extenseur qui le redresse sur
la hanche, et ses fibres vont obliquement en bas pour s’insérer à l’éminence supérieure
de l’articulation de la cuisse (PI. HL fig. 11. B.). Le fléchisseur prend son
origine du bord externe de la hanche, et ses fibres descendent vers l’éminence inférieure
de l’articulation de la cuisse, à laquelle elles s’attachent (PI. III. fig. 11. a, a.).
Le second article de la cuisse montre intérieurement une lame cornée et dure,
parcourant toute sa longueur, et allant s’unir à la partie inférieure de l’articulation
du premier article de la jambe (PI. HI. fig. 11. c.). -Le fléchisseur de ce second
article s’y insère, et il en résulte que cet article ne saurait être fléchi, sans que le
premier article de la jambe se fléchisse en même temps, qui d’ailleurs a son fléchisseur
propre, ainsi que le second article de la jambe.
CHAPITRE TROISIÈME.
PARTIE ZOOLOGIQUE.
§ 1. Exposition des espèces e t de leurs caractères distinctifs.
D ans la partie historique de ces recherches nous avons déjà remarqué que
l’illustre linnàeus n’avait admis qu’une seule espèce de Limule, et qu’il l’avait
décrite sous le nom de Monoculus Polyphemus dans les deux dernières éditions qu’il
donna de son Systema naturae. Il parait n’avoir pas aperçu que la figure de
de l a e t , reproduite par w o rm iu s , diffère en plusieurs points de celle de l ’écluse et
de rumph qu’il cite également à la suite de sa diagnose spécifique, la quelle au
reste peut s’appliquer, sans difficulté, à toutes les espèces du genre. Son disciple
fab ricius fut le premier à admettre deux espèces qu’il nomma Limulus Polyphemus
et Limulus Cyclops ; il distingue la seconde d’après les caractères de la queue non
dentelée en dessus, et des épines élevées sur les arêtes du bouclier, mais il ne cite
point de figures pour cette espèce, et ne donne sur la patrie des deux espèces que la
même indication un peu vague: habitat in Indiae aquis.
L a treille distingua quatre espèces dans son Histoire naturelle des Crustacés et des
Insectes, savoir le Limule hétérodactyle, le Limule des Moluques, le Limule poly-
phème et le Limule à queue ronde. La première espèce fut caractérisée par une
queue trigone et les quatre pattes antérieures terminées par un seul doigt. Le L imulus
moluccanus de ce naturaliste se distingue par une queue trigone ayant l’arête
supérieure munie de dentelures très prononcées; par deux doigts à toutes les pattes,
et par l’absence d’épine au milieu de la carène intermédiaire de la première pièce du
test; il rapporte à cette espèce les figures de l ’éc lu se , rumph et schaeffer. Le
Limulus polyphemus, qu’il croit être. le Monoculus polyphemus de linnàeus et le
Limulus Cyclops de fa b r ic iü s , est distingué par latr e il l e d’après sa queue trigone,