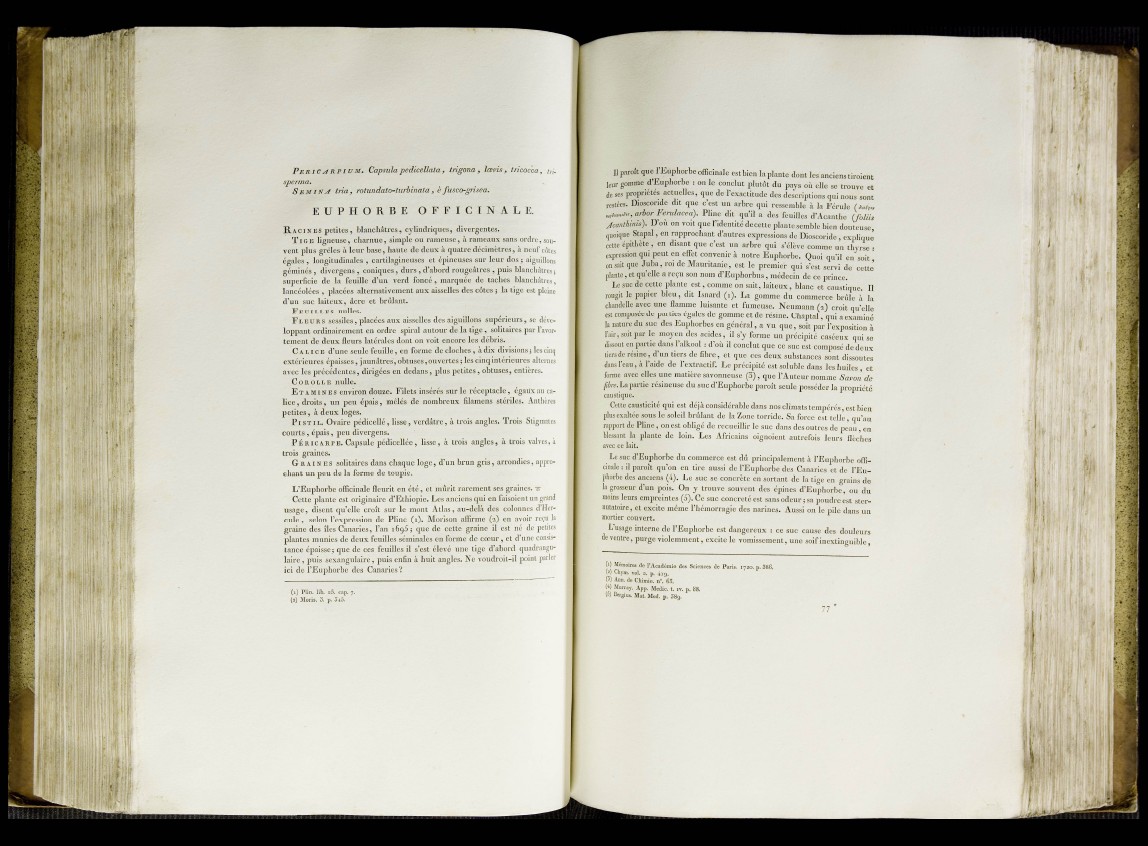
PéricyirpIuM. Capsulapedicellata, trigona, loevis, tricocca, trisperma.
SemiN-J tria, rotundato-turbinata, è fusco-grisea.
E U P H O R B E O F F I C I N A L E .
RACINES petites, blanchâtres, cylindriques, divergentes.
TIGE ligneuse, charnue, simple ou rameuse, à rameaux sans ordre, souvent
plus grêles à leur base, haute de deux à quatre décimètres, à neuf côtes
égales , longitudinales , cartilagineuses et épineuses sur leur dos ; aiguillons
géminés, divergens , coniques, durs, d'abord rougeâtres , puis blanchâtres ;
superficie de la feuille d'un verd foncé, marquée de taches blanchâtres,
lancéolées , placées alternativement aux aisselles des côtes ; la tige est pleine
d'un suc laiteux, âcre et brillant.
FEUILLES nulles.
FLEURS sessiles, placées aux aisselles des aiguillons supérieurs, se développant
ordinairement en ordre spiral autour de la tige, solitaires par l'avortement
de deux fleurs latérales dont on voit encore les débris.
CALICE d'une seule feuille, en forme de cloches, à dix divisions ; les cinq
extérieures épaisses, jaunâtres, obtuses, ouvertes ; les cinq intérieures alternes
avec les précédentes, dirigées en dedans, plus petites, obtuses, entières.
COROLLE nulle,
ETAMINES environ douze. Filets insérés sur le réceptacle, égaux au calice
, droits, un peu épais, mêlés de nombreux filamens stériles. Anthères
petites, à deux loges.
PISTIL. Ovaire pédicellé, lisse, verdâtre, à trois angles. Trois Stigmates
courts, épais, peu divergens.
PÉRICARPE. Capsule pédicellée, lisse, à trois angles, à trois valves, à
trois graines.
GRAINES solitaires dans chaque loge, d'un brun gris, arrondies, approchant
un peu de la forme de toupie.
L'Euphorbe officinale fleurit en été, et mûrit rarement ses graines, in
Cette plante est originaire d'Ethiopie. Les anciens qui en faisoient un grand
usage, ¿sent qu'elle croît sur le mont Atlas, au-delà des colonnes d'Hercule
, selon l'expression de Pline (1). Morison affirme (a) en avoir reçu la
graine des îles Canaries, l'an i6g5j que de cette graine il est né de petites
plantes munies de deux feuilles séminales en forme de coeur , et d'une consistance
épaisse j que de ces feuilles il s'est élevé une tige d'abord quadrangulaire,
puis sexangulaire, puis enfin à huit angles. Ne voudroit-il point parler
ici de l'Euphorbe des Canaries ?
(1) Plin. lib. a5. cap. 7.
(2) Moris. 3. p. 5-t5.
II paroit que 1 Euphorbe officinale est bien la plante dont les anciens tiroient
leur gomme d'Euphorbe : on le conclut plutôt du pays où elle se trouve et
de ses propriétés actuelles, que de l'exactitude des descriptions qui nous sont
restées. Dioscoride dit que c'est un arbre qui ressemble à la Férule fefg
*,arbor Ferulacea). Pline dit qu'il a des feuilles d'Acanthe (foliis
Jcanthinis). D'où on voit que l'identité decette plante semble bien douteuse,
quoique Stapal, en rapprochant d'autres expressions de Dioscoride, explique
cette 'épithète, en disant que c'est un arbre qui s'élève comme un thyrse :
expression qui peut en effet convenir à notre Euphorbe. Quoi qu'il en soit "
on sait que Juba, roi de Mauritanie, est le premier qui s'est servi de cette'
plante, et qu'elle a reçu son nom d'Euphorbus, médecin de ce prince
Le suc de cette plante est, comme on sait, laiteux, blanc et caustique. Il
rougit le papier bleu, dit Isnard (1). La gomme du commerce brûle à la
chandelle avec une flamme luisante et fumeuse. Neumann (2) croit qu'elle
est composée de parties égales de gomme et de résine. Chaptal, qui a examiné
la nature du suc des Euphorbes en général, a vu que, soit par l'exposition à
l'air, soit par le moyen des acides, il s'y forme un précipité caséeux qui se
dissout en partie dans l'alkool : d'où il conclut que ce suc est composé de deux
tiers de résine, d'un tiers de fibre, et que ces deux substances sont dissoutes
dans l'eau, à l'aide de l'extractif. Le précipité est soluble dans les huiles , et
forme avec elles une matière savonneuse (3), que l'Auteur nomme Savon de
fibre. La partie résineuse du suc d'Euphorbe paroît seule posséder la propriété
caustique.
Cette causticité qui est déjà considérable dans nos climats tempérés, est bien
plus exaltée sous le soleil brûlant de la Zone torride. Sa force est telle, qu'au
rapport de Pline, on est obligé de recueillir le suc dans des outres de peau, en
blessant la plante de loin. Les Africains oignoient autrefois leurs flèches
avec ce lait.
Le suc d'Euphorbe du commerce est dû principalement à l'Euphorbe officinale
: il paroît qu'on en tire aussi de l'Euphorbe des Canaries et de l'Euphorbe
des anciens (4). Le suc se concrète en sortant de la tige en grains de
la grosseur d'un pois. On y trouve souvent des épines d'Euphorbe, ou du
moins leurs empreintes (5). Ce suc concreté est sans odeur ; sa poudre est sternutatoire,
et excite même l'hémorragie des narines. Aussi on le pile dans un
mortier couvert.
L'usage interne de l'Euphorbe est dangereux : ce suc cause des douleurs
de ventre, purge violemment, excite le vomissement, une soif inextinguible,
W Mémoire» de l'Académie des Sciences de Paris. 1730. p, 586.
(2) Chym. Toi. a. p. 41g.
(5) Ami. de Chimie, a". 63.
(4) Mnrray. App. Medio, t. IV. p. 88.
(5) Bergins. Mal. Med. p. 38g.
77 I