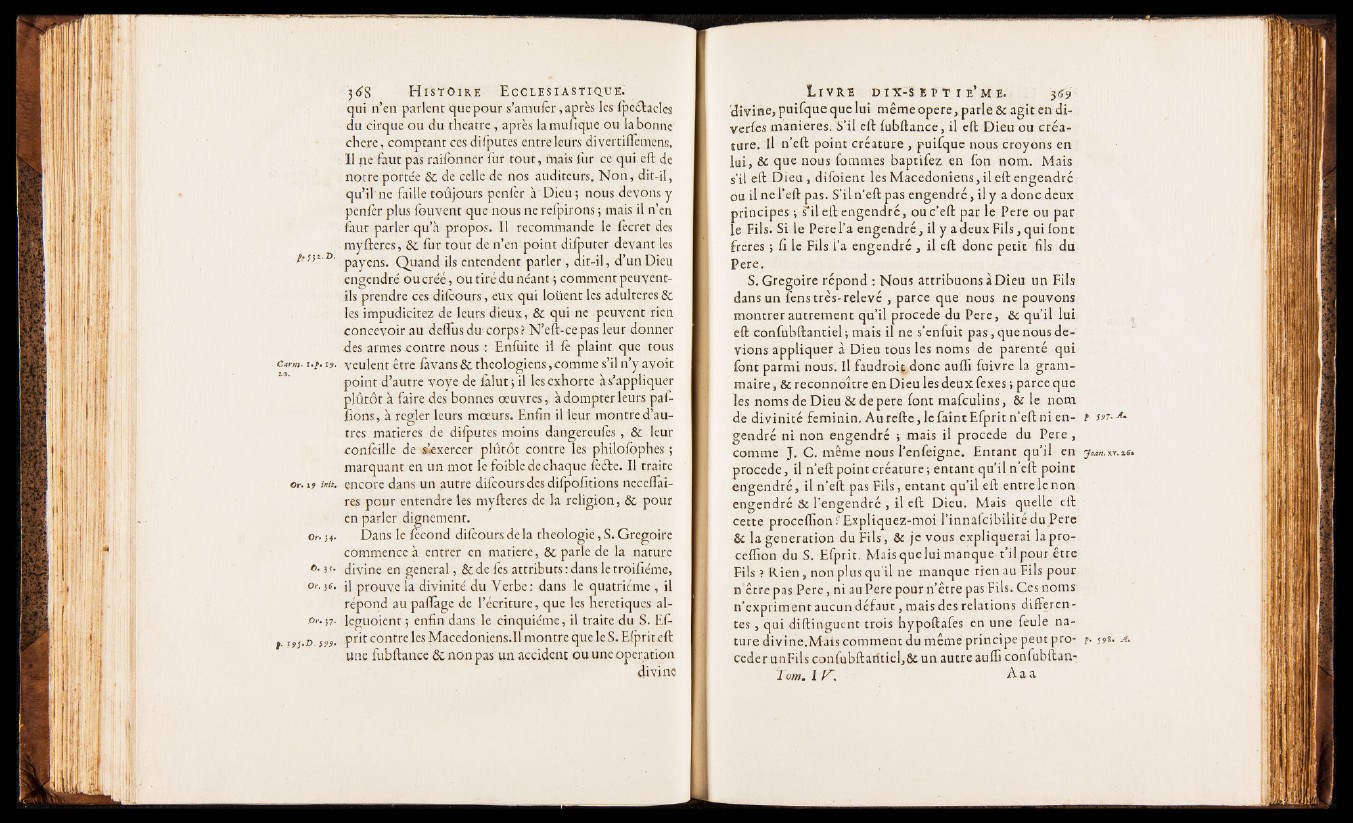
3 ¿ 8 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .'
qui n’en parlent que pour s’amuièr, après les ipe£tacles
du cirque ou du theatre, après lamufique ou la bonne
chere, comptant ces diiputes entre leurs divertiflêmens.
11 ne faut pas raifonner fur tout, mais fur ce qui eft de
notre portée & de celle de nos auditeurs. N on , dit-il,
qu’il ne faille toûjours penfer à'Dieu; nous devons y
penièr plus fouvent que nous ne refpirons ; mais il n’en
faut parler qu’à propos. Il recommande le fecret des
myiler.es, & fur tout de n’en point diiputer devant les
payens. Quand ils entendent parler , dit-il, d’un Dieu
engendré ou créé, ou tiré du néant; comment peuvent-
ils prendre ces diieours, eux qui loüent les adultérés &
les impudicitez de leurs dieux, & qui ne peuvent rien
concevoir au deffus du corps ? N ’eft-cë pas leur donner
des armes contre nous : Eniuite il le plaint que tous
c»rm- i-a o- veulent être làvans & théologiens, comme s’il n’y avoit
point d’autre voye de fàlut; il les exhorte à s’appliquer
plutôt à faire des bonnes oeuvres, à dompter leurs paf-
fjons, à regler leurs moeurs. Enfin il leur montre d’autres
matières de diiputes moins dangereufes, & leur
conlèille de Scxercer plutôt contre les philolbphes ;
marquant en un mot le foible de chaque fëéte. Il traite
er. 19 înit. encore dans un autre difeours des difpofitions neceflai-
res pour entendre les myitérés de la religion, & pour
en parler dignement.
or. h- Dans le iècond diieours de la théologie, S. Grégoire
commence à entrer en matière, & parle de la nature
m divine en général, & de les attributs : dans le troilîéme,
or.j6. H prouve la divinité du Verbe: dans le quatrième , il
répond au paiîage de l’écriture, que les heretiques al-
Or.37- leguoient ; enfin dans le cinquième, il traite du S. Efi-
jj.d w> prit contre les Macedoniens.il montre que le S. Efprit eft
une fubftance & non pas un accident ou une opération
divine
L i v r e d i x - s e î t i e ’ m e . 3 69
divine, puifque que lui même opere, parle 8t agit en di-
veries maniérés. S’il eft fubftance, il eft Dieu ou créature.
Il n’eft point créature , puifque nous croyons en
lui, 8e que nous fommes baptifez en fon nom. Mais
s’il eft Dieu, difoient les Macédoniens, il eft engendré
ou il ne l’eft pas. S’il n’eft pas engendré, il y a donc deux
principes ; s'il eft engendré, ouc’eft par le Pere ou par
le Fils. Si le Pere l’a engendré, il y a deux Fils, qui font
freres ; fi le Fils l’a engendré , il eft donc petit fils du
Pere,
S. Grégoire répond : Nous attribuons à Dieu un Fils
dans un fenstrês-relevé , parce que nous ne pouvons
montrer autrement qu’il procédé du Pere, 8t qu’il lui
eft confubftantiel ; mais il ne s’enfuit pas, que nous devions
appliquer à Dieu tous les noms de parenté qui
font parmi nous. Il faudroiç donc aufli fuivre la grammaire
, & reconnoître en Dieu les deux fexes ; parce que
les noms de Dieu 8c de pere font mafeulins, & le nom
de divinité féminin. Aurefte, le faint Efprit n’eft ni en- t
gendré ni non engendré ; mais il procédé du P e re ,
comme J. C. même nous l’enfeigne. Entant qu’il en jom.xr.ie*
procédé, il n’eft point créature ;entant qu’iln ’eft point
engendré, il n’eft pas Fils, entant qu’il eft entre le non
engendré & l’engendré , il eft Dieu. Mais quelle eft
cette proceffion i Expliquez-moi l’innafcibilité du Pere
& la génération du Fils, ôt je vous expliquerai lapro-
ceffion du S. Efprit. Maisquelui manque-t’il pour être
Fils ? Rien, non plus qu’il ne manque rien au Fils pour
n’être pas Pere, ni au Pere pour n’être pas Fils. Ces noms
n’expriment aucun d éfaut, mais des relations différentes
, qui diftinguent trois hypoftafes en une feule nature
divine.Mais comment du même principe peut procéder
unFils confubftaritieljôc un autre auffi confubftan-
Tom. I /V A a a
p. 558. A .