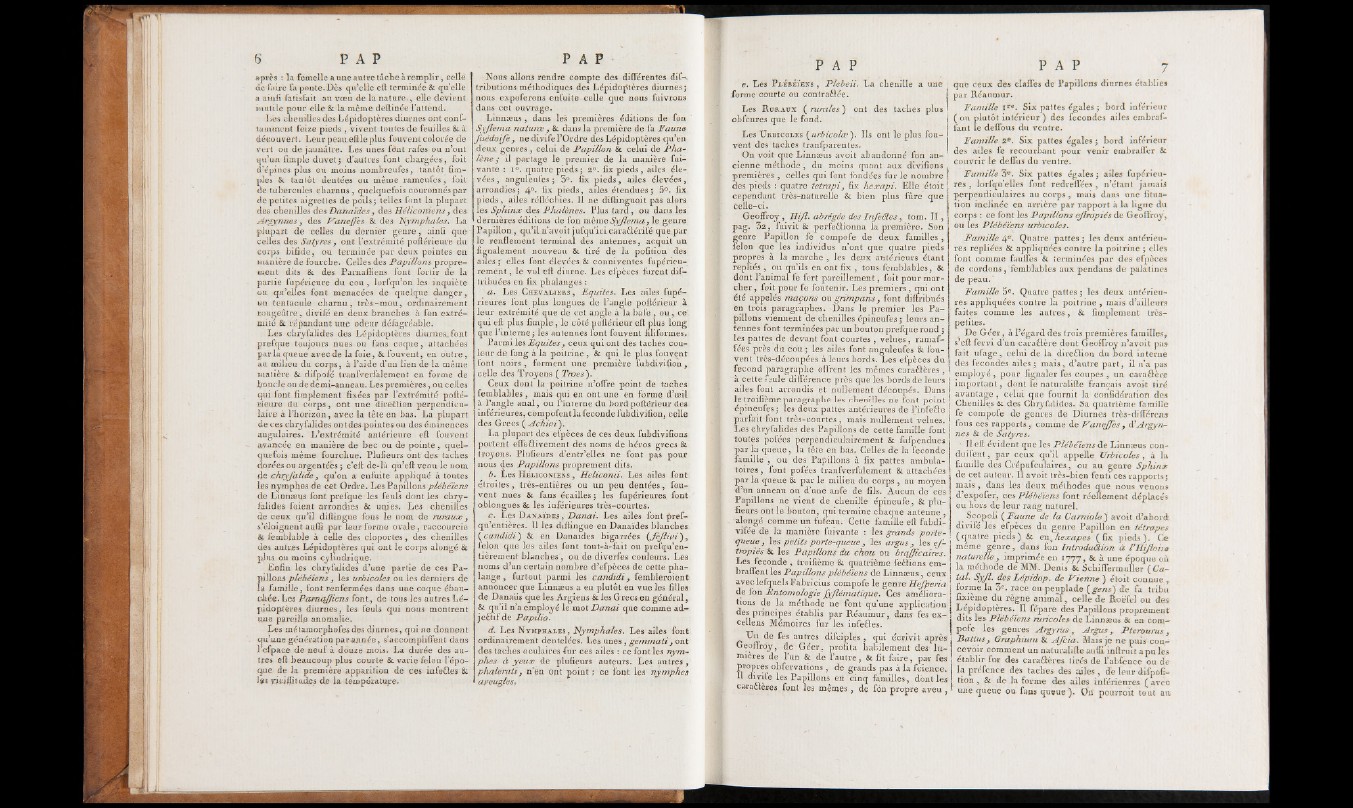
après : la femelle a une autre tâche à remplir, celle
de faire la ponte. Dès qu’elle eft terminée & quelle
a ainfi fatisfait au voeu de la nature., elle devient
inutile pour elle & la même deftinée l’attend..
Lés chenilles des Lépidoptères diurnes ont confia
ni axent feize pieds , vi vent toutes de feuilles & à
découvert. Leur peaneflleplus fouvenc colorée de
Vert ou de jaunâtre. Les unes font rafes ou n’ont
qu’un limple duvet ; d’autres font chargées, foit
d’épines plus ou moins nombreufes, tantôt {impies
& tantôt dentées ou même rameules, foit
de tubercules charnus, quelquefois couronnés par
de petites aigrettes de poils; telles font la plupart
des chenilles des Danaïdes } des Héliconiens9 des
Argyruzes y des VaneJJ'es &. des Nymphales. La
plupart de celles du dernier genre, ainfi que
celles des Satyres, ont l ’extrémité poftérieure du
corps bifide, ou terminée par deux pointes en
manière de fourche. Celles des Papillons, proprement
dits 8c des Parnalîiens font fortir de la
partie fupérieure du cou, lorfqu’on les inquiète
ou qu’elles font menacées de quelque danger,
un tentacule charnu, très-mou, ordinairement
rougeâtre, divifé en deux branches à fon extrémité
8c répandant une odeur délâgréable.
Les chryfalides des Lépidoptères diurnes,,font
prefque toujours nues ou fans coque, attachées
parla queue avec de la foie, 8c fouvent, en outre,
au milieu du corps, à î’aide d’un lien de la même
matière 8c difpof’é tranfverfalement en forme de
boucle ou de demi-anneau. Les premières, ou celles
qui font Amplement fixées par l’extrémité pofté-
rieure du corps, ont une direction perpendiculaire
à l’horizon, avec la tête en bas. La,plupart
de ces chryfalides ont des pointes ou des éminences
angulaires. L’extrémité antérieure eft fouvent
avancée en manière de bec ou de pointe, quelquefois
même fourchue. Plufieurs ont des taches
dorées ou argentées ; c’elt de-là qu’eft venu le nom
de chfy'Jalide, qn’on a enfuite appliqué à toutes
les nymphes de cet Ordre. Les Papillons plébéiens
de Linnæus font prefque les feuls dont les chry-
fiilid.es 1 oient arrondies 8c unies. Les chenilles
de ceux qu’il diftingue fous le nom de ruraux 3
s’éloignent auffi par leur forme ovale, raccourcie
& fembjable à celle des cloportes, des chenilles
des autres Lépidoptères qui ont le corps alongé 8c
plus ou moins cylindrique.
Enfin les chryfalides d’une partie de ces Papillons
plébéiens , les urbicoles ou les derniers de
la famille, font renfermées dans une coque ébauchée.
Les Pamaffiens font, de tous les autres Lépidoptères
diurnes, les feuls qui nous montrent
une pareille anomalie.
Les métamorphoses des diurnes, qui ne donnent
qu’une génération par année, s’ae compiiffent dans
P-efpace. de neuf à douze mois. La durée des autres
eft beaucoup plus courte 8c varie félon l’époque
de la première apparition dé ces infeètes 8c
les yicillituiles de la température.
Nous allons rendre compte des différentes dif-i.
tributions méthodiques des Lépidoptères diurnes ;
nous expoferons enfuite celle que nous fuivrons
dans cet ouvrage.
Linnæus , dans les premières éditions de fon
Syjlema natuixe y 8c dans la première de fa Faune
JüédoiJe y ne divife l ’Ordre des Lépidoptères qu’en
deux genres, celui de Papillon 8c celui de Phalène
y il partage le premier de la manière fui-
vante : i°. quatre pieds; a0, fix pieds, ailes élevées
, anguleufes ; 3°. fix pieds, ailes élevées,
arrondies; 4°* fi* pieds, ailes étendues; 5°. fix
pieds, ailes réfléchies. Il ne diftiiiguoit pas alors
les Sphinx des Phalènes. Plus tard, ou dans les
dernières éditions de fon même Syjlema9 le genre
Papillon, qu’il n’a voit jufqu’ici earaHérifé que_par
le renflement terminal des antennes, acquit un
fignalement nouveau 8c tiré de la pofition des
ailes f elles font élevées 8c. conniventes fupérieu-,
rement, le vol eft diurne. Les efpèces furent dif-
tribuées en fix phalanges :
a. Les Chevaliers , Equités. Les ailes fupé-
rieures font plus longues de l’angle poftérieur à
leur extrémité que de cet angle à la baie , ou, ce'
qui eft plus fimple, le "coté poftérieur eft plus long
que l ’interne; les antennes font fouvent filiformes..
Parmi 1 es Equités3 ceux qui ont des taches couleur
de fang à la poitrine , 8c qui le plus fouvent
font noirs , forment une première fubdivifion ,
celle des Troyens ( Troes).
Ceux dont la poitrine n’offre point de taches
femblables, mais qui en ont une en forme d’oeil
à.l’angle anal, ou l’interne du bord poftéi’ieur des
inférieures, eompofentla fécondé fubdivifion, celle
des Grecs ( A chiai).
La plupart des efpèces de ces deux fubdivifions
portent efïeôivement des noms de héros grecs 8c
troyens. Plufieui-s d’entr’elles ne font pas pour
nous des Papillons proprement dits.
b. Les Héliconiens , Heliconii. Les ailes font
étroites , très-entières ou un peu dentées, fouvent
nues 8c fans écailles ; les fupérieures font
oblongues 8c les inférieures très-courtes.
q. Les Danaïdes , Danai. Les ailes font pref-
qu’entièfes. Il les diftingue en Danaïdes blanches
( candidi} 8c en Danaïdes bigarrées (JèJliai ) ,
félon que les ailes font tout-à-fait ou prefqu’en-
tièrement blanches , ou de diverfes couleurs. Les
noms d’un certain nombre d’ efpèees de cette phalange
, furtout parmi les candidi 9 fembleroient
annoncer que Linnæus a eu plutôt en vue les filles
de Danaiis que les Argiens Scies Grecs en général,
8ç qu’il n’a employé le mot Danai que comme ad-
jeôlif de Papilio.
d. Les Nymphales, Nymphales. Les ailes font
ordinairement dentelées. Les unes, gèmmati 9 ont
des taches oculaires fur ces ailes : ce font les nymphes
à y eux de plufieurs auteurs. Les autres ,
phoflerati, n’en ont point ; ce font les nymphes
aveugles.
e. Les Plébéiens' , Plebeii. La chenille a une
forme courte ou contrariée.
Les Ruraux ( rurales ) ont dés taches plus
obfcures que le fond.
Les Urbicoles ( urbicoloe ). Ils ont le plus fou-
vent des taches tranfparentes.
On voit que Linnæus avoit abandonné fon ancienne
méthode, du moins quant.aux divifîons
premières , celles qui font fondées fur le nombre
des pieds : quatre tetrapi} fix hexapi. Elle étoit
cependant très-naturelle 8c bien plus fûre que
celle-ci.
Geoffroy, PLiJl. abrégée des Infeâtes, tom. I I ,
pag. 32, fuivit 8c perfeôlionna la première. Son
genre Papillon fe compofe de deux familles,
félon que les individus n’ont que quatre pieds
propres à la marche , les deux antérieurs étant
repliés , ou qu’ils en ont fix , tous femblables, 8c
dont l’animal fe fert pareillement, l’oit pour marcher
, foit pour fe foutenir. Les premiers, qui ont
été appelés maçons ou grimpans 9 font diftribués
'en trois paragraphes. Dans le premier les Papillons
viennent de chenilles épineufes ; leurs antennes
font terminées par un bouton prefque rond ;
les pattes de devant font courtes , velues, ramaf-
fées près du cou ; les ailes font anguleufes 8c fouvent
très-découpées à leurs bords. Les efpèces du
fécond paragraphe ofirent les mêmes caraGères,
à cette .• 3ule différence près que les bords de leurs
ailes font arrondis et nullement découpés. Dans
le troifième paragraphe les chenilles ne font point
épineufes ; les deux pattes antérieures de l’infeGe
parfait font très-courtes , mais nullement velues.
Les chryfalides des Papillons de cette famille font
toutes pofées perpendiculairement 8c fufpendues
parla queue, la tête en bas. Celles de la fécondé
famille ; ou des Papillons à fix pattes ambulatoires
, font pofées tranfverfalement 8c attachées
par la queue 8c par le milieu du corps , au moyen
d’un anneau ou d’une anfe de fils. Aucun de ces
Papillons ne vient de chenille épineufe, 8c piu-
fieurs ont le bouton, qui termine chaque antenne ,
alongé comme un fufèau. Cette famille eft fubdi-
vifée de la manière fuivante : les grands porte-
queue y les petits porte-queue 9 les argus 9 les ej-
tropiés 8c les Papillons du chou ou brajfîcaires.
Lés fécondé , troifième 8c quatrième feGions em-
braffent les Papillons plébéiens de Linnæus, ceux
aveclefquelsFabricius compofe le genre Hejperia
de fon Entomologie JyJlématique. Ces améliorations
de la méthode ne font qu’une application-
des principes établis par Réaumur, dans fes excellons
Mémoires fur les infeGes.
Un de fes autres difeiplés , qui écrivit après
Geoffroy, d eG é e r . profita habilement des lumières
de lun 8c de l’autre, 8c fit faire, par fes
propres obfervations , de grands pas à la fcience.
Il divife les Papillons en cinq familles, dont les
caraGèr-es font les mêmes, de fôn propre av eu,
que ceux des clafïes de Papillons diurnes établie»
par Réaumur.
Famille i re. Six pattes égales ; bord inférieur
( ou plutôt intérieur ) des fécondés ailes embraf-
fant le deffous du ventre.
Famille 2e. Six pattes égales ; bord inférieur
des ailes fe recourbant pour venir embralTer 8c
couvrir le defTus du ventre.
Famille 3e. Six pattes égales ; ailes fupérieures
, lorfqa’elles font redreffées , n’étant jamais
perpendiculaires au corps, mais dans une fitua-
tion inclinée en arrière par rapport à la ligne du
corps : ce font les Papillons ejlropiés de Geoffroy,
ou les Plébéiens urbicoles.
Famille 4e. Quatre pattes ; les deux antérieures
repliées 8c appliquées contre la poitrine ; elles
font comme fauftes 8c terminées par des efpèces
de cordons, femblables aux pendans de palatines
de peau.'
Famille 5e. Quatre pattes ; les deux antérieures
appliquées contre la poitrine , mais d’ailleur»
faites comme les autres, 8c fimplement très-
petites.
De Géer, à l’égard des trois premières familles,
s’eft fervi d’un caraGère dont Geoffroy n’avoit pas-
fait ufage, celui de la direction du bord interne
des fécondés ailes; mais, d’autre part, il n’a pas
employé , pour fignaler fes coupes , un caraGère
important, dont le naturalifte français avoit tiré
avantage , celui que fournit la conficlération des
Chenilles 8c des Chryfalides. Sa quatrième famille
fe compofe de genres de Diurnes très-diffèrent
fous ces rapports.,; comme de VaneJJes9 èlArgyn-
nes 81 de Satyres.
• Il eft évident que les Plébéiens -de Linnæus conduisent,
par ceux qu’il appelle Urbicoles, à la
famille des Cvépu-fculaires, ou au genre Sphinx
de cet auteur. Il avoit très-bien fenti ces rapports;
mais, dans les deux méthodes que nous venons
d’expofer, ces Plébéiens font réellement déplacés
ou hors de leur rang naturel.
Scopoli ( Faune de la Camiole ) avoit d’abord
divifé les efpèces du genre Papillon en tétrapes
(quatre pieds) 8c en.4hexapes (fix pieds). Ce
même genre, dans fon Introduction à l’D jlo iie
naturelle 9. imprimée en 1777, 8c à une époque on
la méthode de MM. Denis 8c Schifïèrmuller (C a -
tal. Syjl. des Lépidop. de Vienne ) étoit connue ,
forme la 3e. race ou peuplade (gens) de fa tribu
fixième du règne animal, celle de Roëfel ou des
Lepido'ptères. Il fëpare des Papillons proprement
dits les Plébéiens runcoles de Linnæus & en com—
pofe les genres Argyrus, Argus, Pterourus x
Battus y Graphium 8c AJcia. Mais je ne puis concevoir
comment un naturalifte auflà inftruit a pu les
établir fur des caraGères tirés de l’abfence ou de
la préfence des taches des ailes , de leur difpofi-
tion , 8c de la forme des ailes inférieures ( avec
une queue ou- fans queue ). On pourroit tout au