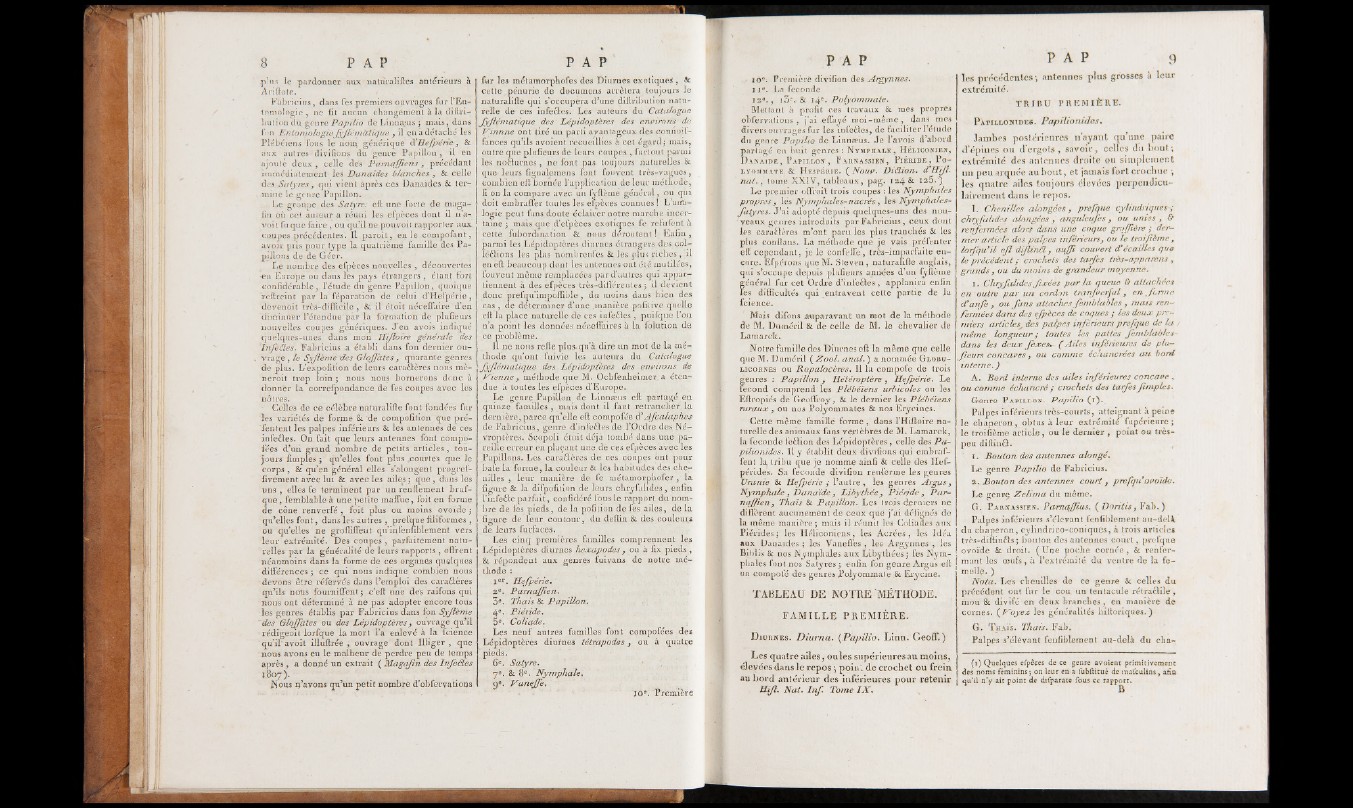
.plus le pardonner aux naturalises anterieurs à
Ariflote.
Fabricius, dans Tes .premiers ouvrages fur l’Entomologie
, ne fit aucun changement à la diflri-
Inilion du-genre Papilio de Linnæus j mais, dans
fin EntomologieJyJïëmàtique , il en. a détaché les
Plébéiens fous le nom générique d'Hefpérie , 8c
aux autres 'divifions du genre Papillon, il en
ajoute deux, celle des Parruiffièns , précédant
immédiatement les Danaïdes blanches , 8c celle
des Satyres y qui vient après ces Danaïdes & termine
le genre Papillon.
Le groupe des Satyre: eft une forte de maga-
lin où cet auteur a réuni les efpèees dont S M h
voit fu que faire , ou qu’il ne pouvoit rapporter aux,
coupes précédentes. Il paroit, en le .eômpofant,
avoir pris pour type la quatrième famille des Papillons
de de Géer.
Le nombre des efpèees nouvelles , découvertes
-en Europe ou dans les pays étrangers , étant fort
confidérable, l’élude du genre Papillon, quoique
r eft rein t par la féparalion de celui d’H efpérie,
devenoit très-difficile , & il éloit néceffaire'd’en
'diininuér l’étendue par la formation de plufieurs
nouvelles coupes génériques. J’en avois indiqué
quelqués-unes dans mon Hiftoire générale des
Infectes. Fabricius_a établi dans fon dernier ouvrage
, le Sy/lèmé des GloJJàtes 3 quarante genres
de plus. L-’expofition de leurs cai'aélères nous mè-
neroit trop loin ; nous nous bornerons donc à
donner la correfpondance de fes coupes avec les
nôtres.
Celles de ce célèbre naturalifle font fondées finies
variétés de forme 8c de compofition que pré-
'fentent les palpes inférieurs & les antennes de ces
infeftes. On fait que leurs antennes font compo-
fées d’un grand nombre de petits articles, toujours
Amples j qu’elles font plus .courtes que le
corps , 8c qu’en général elles s’alongent progref-
fivement avec lui & avec les ailes ; que, dans les
uns , elles fe terminent par un renflement bruf-
que, femblable-à une petite maffue, foit en forme
de cône renverfé , foit plus ou moins ovoïde|
qu’elles font, dans les autres , prefque filiformes ,
ou qu’elles ne groflifTent qu’infenfiblement vers
leur extrémité. Des coupes , parfaitement naturelles
p ar la généralité dé leurs-rapports , offrent
néanmoins dans la forme de ces organés quelques
différences ; ce qui nous indique combien nous
devons être réfervés dans l ’emploi des caraélères
qu’ils noiis fourniffentj c’eft une des raifons qui
nous ont déterminé à ne pas adopter encore tous
les genres établis par Fabricius dans fon Syftème
des Glojfptes ou des Lépidoptères , ouvrage qu’il
■ rédig.eoit lorfque la mort l’a enlevé à la lcience
' qu’il’ avoit illuflrée , ouvrage dont Iffiger , qüe
nous avons eu le malheur de perdre peu de temps
après , a donné un extrait ( Magafih des Infeéles
m S m
Nous n’avons qu’un petit nombre d obferyations
fur les métamorphofes des Diurnes exotiques , &
cette pénurie de documens arrêtera toujours le
naturalifle qui s’occupera d’une diftribution naturelle
de ces infecles. Lès auteurs du Catalogue
fyjlém a tique des Lépidoptères des environs de
V~innne ont tiré un parti avantageux des connoif-
fances qu’ils avoient recueillies à cet égard5 mais,
outre que plufieurs de leurs coupes., furtout parmi
les nocturnes, ne font pas toujours naturelles 8c
que' leurs fignalemens font fou vent très-vagues,
combien eft bornée l’application de leur méthode,
fi on la compare avec un fyflèmê général, ou qui
doit émbraffer toutes les efpèees connues ! L’aiïû-
logie peut fans doute éclairer notre marche incertaine
j mais que d’.efpèces exotiques fe réfutent à
cette fubordi nation 8c nous déroutent ! Enfin ,
parmi les Lépidoptères diurnes étrangers des col-
îêéhons les plus mombreules 8c les plus riches , 'il
en eft beaucoup dont les antennes ont été mu triées,
louvent même remplacées par d’autres qui appâr-
tiennent à des efpèees très-différentes 5 il devient
donc prefqu’impoflible , du moins dans bien des
| cas , de déterminer d’une .manière pofilive quellç
eft la place naturelle de ces infeâes , puifque l’on
n’a point les données néceffaires à la folution de
ce problème.
Il ne nous refte plus, qu’à dire un mot de la méthode
qu’ont fui vie les auteurs du Catalogue
JyJléma tique des -Lépidoptères des environs de
V ’ienne3 méthode que M. Ochfenheimer. a étendue
à toutes les efpèees d’Europe.
Le genre Papillon de Lionæus eft partagé en
quinze familles , mais dont il faut retrancher, la
dernière, parce qu’elle eft compofée ,dy Afcalaphes
de Fabricius, genre d’infieôtes de l’.Ordre des Né-
vroptères. Sçopoli éfoit déjà tombé clans une pareille
erreur en plaçant une dé ces efpèees avec les
Papillons. Les caraèlères de ces coupes ont pour
bàfe la forme, la couleur 8c les habitudes des chenilles
., leur manière de fe métamorphofer , la
figure 8c la difpofition de leurs chryfaiides, ;enfin
l’infeôle parfait, confidéré fous le rapport du nombre
de fes pieds., de la pofftion de les ailes, de la
figure de leur contour, du deflin 8c des couleui;s
de leurs fur faces.
Les cinq premières familles comprennent le.s
Lépidoptères diurnes hexapodes , ou à fix pieds ,
8c répondent aux genres fui vans de notre méthode
:
1 er. Hefpérie.
2e. PamaJJien. 3e. Thais 8c Papillon, 4e. Piérides 5e. Çolidde,
. Les neuf autres familles font compofées des
Lépidoptères diurnes tétrapodes, ou à quatre
pieds.
6e. Satyre.
7 e. 8c 8e. Nymphale,
9®. Vaneffe,
io®. Première
109. Première divifion des Argynnes.
il®. La fécondé
12° ., i3e.<8c 14®. Polyômmate.
Mettant à profit ces travaux 8c mes propres
obier va lions , j’ai eflàyé moi-même, dans mes
divers ouvrages fur les infecles, de faciliter l’étude
du genre Papilio de Linnæus. Je l’avois d’abord
partagé en Luit genres : Nymphale, Héliconien,
Danaide, Papillon , Parnassien, Piéride, Po-
lyommate, 8c Hespérie. ( Nouv. Diction. d’ JfiJl.
rtal. , tome XXIV, tableaux, pag. 124 & 125.')
Le premier offroit trois coupes : les Nymphales
propres, lés Nyinphales-nacrés, les Nympha/es-
Jaty/'es. J’ai adopté depuis quelques-uns des nouveaux
genres introduits par Fabricius, ceux dont
les caractères m’ont paru les plus tranchés 8c les
plus conftaus. La méthode que je vais préfenler
eft cependant, je le confefle,, très-imparfaite encore.
Efpérons que M. Steven , naturalifle anglais,
qui s’occupe depuis plufieurs années d’un fyflème
général fur cet Ordre d’infedes , appîanira enfin
les difficultés qui entravent celle partie de la
fcience.
Mais difons .auparavant un mot de la méthode
de M.. Dtunéril 8c de celle de M. le chevalier de
Lamarck.
Notre famille des Dihrnes eft la même que celle
que M. Duméril ( Z o o l. anal.') a nommée Globu-
licornes ou Ropalocères. Il la compofe de trois
genres : P a p illon} Hétéroptère , Hefpérie. Le
fécond comprend les Plébéiens urbicoles ou les
Eflropiés de Geoffroy, 8c le dernier les Plébéiens
ruraux 3 ou nos Polyommales 8c nos Erycines.
Cette-même famille forme , dans l’Hiftoire naturelle
des animaux fans vertèbres de M. Lamarck,
la fécondé fe&ion des Lépidoptères, celle des Pa-
pilionides. Il y établit deux divifions qui embraf-
fent la, tribu que je nomme ainfi 8c celle des Hef-
pérides. Sa fécondé divifion renferme Les genres
Uranie 8c Hefpérie , l’autre , les genres Argus3
Nymphale 3 Dan aide 3 Libythée , Piéride , Par-
miffien, Thaïs 8c Papillon. Les trois derniers ne
diffèrent aucunement de Ceux que j’ai défignés de
la même manière ; mais il réunit les Coliàdes aux
Piérides ; les Héliconiens, les Acrées, les Idéa
aux Danaides ; les Vaneffes , les Argynnes , les
Biblis & nos Nymphales aux Libylhéesj fes Nymphales
fout nos Satyres 5 enfin fon genre Argus eft j
un compoi’é des genres Polyoïnmale ,8c Erycine.
T A B L E A U D E N O T R E MÉ THOD E .
F A M IL L E P R EM IÈ R E .
Diurnes. Diurna. (P a p ilio . Linn. GeofT.)
Le s quatre ailes, ouïes supérieures au moins,
élevées dans le repos -, poinl de crochet ou frein
au bord antérieur des inférieures pour retenir
Hijl. Nat. Inf. Tome IX .
les précédentes *, antennes plus grosses a leur
extrémité.
T R IB U PR EM IÈ R E .
P àpillonides. Papilionides.
Jambes postérieures n’ayant qu’une paire
d’épines ou d’ergots, savoir , celles du b out;
extrémité des antennes droite ou simplement
un peu arquée au bout, et jamais fort crochue ;
les quatre ailes toujours élevées perpendiculairement
dans le repos.
I. Chenilles alongées, prefque cylindriques y
chry faiides alongées , anguleufes, ou unies , &
l'enfermées alors dans une coque grqffière ; dernier
article des palpes inférieurs, ou le troifième,
loifqii i l eft d ijlin à , auffi couvert d*écailles que
le précédent y crochets des tarfes très-apparens,
grands , ou du moins de grandeur moyenne.
l , Chryfaiides fix é e s par la queue & attachées
en outre p.ar un cordon tran/verfal, en forme
d*anfe , ou fa n s attaches femblabiés , mais renfermées
dans des efpèees de coques ; les deux premiers
articlesdes palpes inférieurs prefque de la .
même longueur ; toutes les pattes femb labiés-
dans les deux fe x e s ■*- ( Ailes inférieures de plu-
fîeurs concaves, ou comme échancrées au bord
interne.)
A. Bord interne des ailes inférieures concave,
ou comme échancré y crochets des tarfes/impies.
Genre P apillon. Papilio (1).
Palpes inférieurs très-courts, atteignant à peine
le chaperon, obtus à leur extrémité fupérieure ;
le troifième article, ou le dernier , point ou très-
peu diflinâ.
1, Bouton dés antennes alongé.
Le génre Papilio de Fabricius.
2. Bouton des antennes court , prefqu ovoïde.
Le genrç Zelima du même.
G. Parnassien. Pamqfjïus. (D on tis , Fab.)
Palpes inférieurs s’élevant fenfiblement au-delà
du chaperon, cylindnco-coniques, à trois articles
très-diftinfls j boulon des antennes court, prefque
ovoïdè 8c droit. (Une poche cornée, 8c renfev-
| mant les oeufs, à l’extrémité du ventre de la femelle.
)
Nota, Les chenilles de ce genre 8c celles du
précédent ont fur le cou, un tentacule rétraclile,
mou 8c divifé en deux branches, en manière de
cornes, { fo y x z les généralités hifloriques. )
G. T haïs. Thais. Fab.
Palpes s’élevant fenfiblement au-delà du cba-
(1) Quelques efpèees de ce genre avoient primitivement
des noms féminins; on leur en a fubftitué de mafeulins, aha
qu'il n’y ait point de difparatc fous ce rapport.