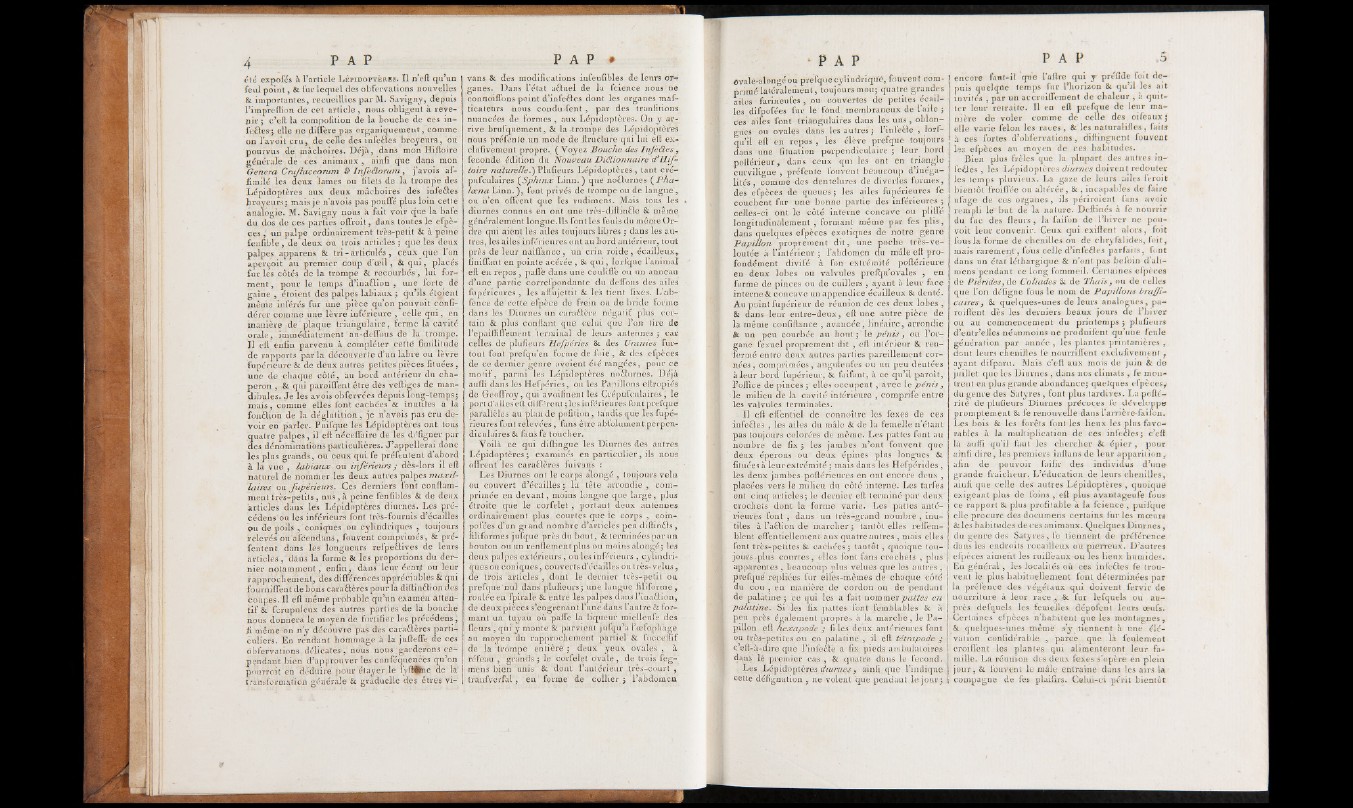
4 P A P
été expofés à l’article Lépidoptères. Il n’eft qu’un '
feul point, 8t fur lequel des obfervations nouvelles
& importantes, recueillies par M. Savigny, depuis
l’impreffion de cet article , nous obligent à revenir
j c’eft la compoûtion de la bouche de ces in-
fe&es-; elle ne diffère pas organiquement, comme
on l’avoit cru, de celle des infe&es broÿeuvs, ou
pourvus de mâchoires. Déjà, dans mon Hiftoire
générale de ces animaux , ainfi que dans mon
Genera Crujlaceorum & Infeâloruni , j’avois af-
fimilé les deux lames ou filets de la trompe des
Lépidoptères aux deux mâchoires' dés infeôtes
broyeurs; mais je n’avois pas pouffé plus loin cette
analogie. M. Savigny nous a fait voir que la baie
du dos de ces parties oflroit, dans toutes le efpè-
ces ,' un palpé ordinairement très-petit & à peine
fenfible, de deux ou trois articles ; que les deux
palpes apparens & tri - articulés, ceux que l ’on
aperçoit au premier coup d’oe il, & qui, placés
fur les côtés de la trompe & recourbés , lui forment
, pour le temps d’inaôlion , une forte de
gaine , étoient des palpés labiaux ; qu’ils étaient
même inférés fur une pièce qu’on pouvoit cônfi-
dérer comme .une. lèvre inférieure , celle qui, en
manière de plaque triangulaire, ferme la cavité
orale, immédiatement au-deffous de la trompe.
Il eft enfin parvenu à compléter ceftë fimilitude
de rapports parla découverte d’un labre ou lèvre
fupériëure & de deux autres petites pièces fituées,
une de chaque côté, au bord antérieur dû chaperon
, & qui paroiffent être des vertiges de mandibules.
Je lés avois obfervéès depuis long-temps 5
mais, comme elles font cachées & inutiles à la
fondlion de la déglutition, je n avois pais Cru devoir
en parler. Puifque les Lépidoptères ont.tous
quatre palpes,'il''.eft nécëffaire de les defigner par
des dénominations particulières. J’appellerai donc
les plus grands, ou ceux qui fé préfentent d’abord
à la vue , labiaux ou inférieurs y dès-lors il eft
naturel de riomrfier les deux autres palpes maxillaires
ou Jupérieurs. Ces derniers font conftani-
ment très-petits , nus , à peine fenfiblés & de deux
'articles dans les Lépidoptères diurnes. Les pré-
cédens'ôii les inférieurs font très-fournis d’écailles
ou de poils , conlqiies ou cylindriques , toujours
relevés ou afeendans, fou vent comprimés, & préfentent
dans les longueurs refpectives de leurs
articles, ' dans la forme & les proportions du dernier
notamment, enfin, 'dans0 leur ééarj; ou leur
rapprochement, dès différences appréciables & qui
fourniffent de bóns caractères pôurla difh’nCtion des
coupes. Il eft même probable qu’un examen attentif
81 fcrupuleux des autres parties de la bouche
nous donnera le moyén de fortifier les précédens,
fi même-on n’y décou vre pas des caradlèfes particuliers.
En rendant hommage à la jufteffe de ces
ôbfervations délicates, nous nous;garderons cependant
bien d’approuver les çonféquencès qu’on
pourroit en déduire pour étayer.le fyfflitne de làJ
transformation générale & graduelle des etres vip
a p »
vans. & des modifications infenfibles de leurs organes.
Dans l’état adtuèl de la fcience nous ne
conüoiffons point d’infedtes dont les organes maf-
ticateurs .nous conduifent , par des tranfitions
nuancées de formes , aux Lépidoptères. On y arrive
brufquement, & la .trompe des Lépidoptères
nous préfènle un mode de ftructure qui lui eft ex*
clufivement propre.. ( Voyez Bouche des Injeéles,
fécondé édition du Nouveau Dictionnaire d’Hif-
toire naturelle.') Plufieurs Lépidoptères , tant cré-
pufculaires {Sphinx Linn. ) que noOurnes ( Pha-
loena Linn. ), font privés de trompe ou de langue,
ou h’en offrent que lès rudimens. Mais tous les
diurnes connus eu ont une très-diftinéle & même
généralement longue.Ils font les feuls du même Ordre
qui aient les ailes toujours libres ; dans les autres,
les ailes inférieures ont au bord antérieur, tout
près de leur naifîance , un crin roide, écailleux,.
Unifiant en pointe acérée , & qui, lorfque l’animal
eft en repos , paffe dans unè coulifïè ou un anneau
d’ uné partie côrrefpondante du deffoûs des ailes
fupérieurés , les affujettit &. lès tient fixes. L’ab-
fènee de cette efpèce de frein ou de bride forme
dans lés'Diurnes un caractère négatif plus certain
& plus confiant que celui que l’on tire de
l’epaiffiffement terminal de leurs antennes 5 car
celles de plufieurs Hefpéries & des Uranies - fur-
tout font prefqu’en forme de foie , & dés efpèces
de ce dernier genre avoient été rangées, pour ce
motif, parmi les Lépidoptères noâurnes. Déjà
aufti dans les Hefpéries, ou les Papillons eftropiés
dè Geoffroy, qui avoifinent lès Çrépufculaires, le
port d’ailes eft différent ; les inférieures font prefqué
parallèles au plan de pofition, tandis que les fupé-
rièurés font relevées, fans être absolument perpendiculaires
& fans fë toucher.
Voilà éè qui diftingue les Diurnes des autres
Lépidoptères ; examinés en particulier, ils nous
offrent' les caraClères fùivans :
Les Diurnes ont le Corps aïongë , toujours velu
ou couvert d’écaillès; la tête arrondie, comprimée
en devant, moins longue que large, plus"
étroite que lé corfelet , portant, deux antennes
ordinairement plus .courtes que le corps , coin-
pofées d’un grand nombre d’articles peu diftindls,
filiformes ju'fque près du bout, 81 terminées par un
bouton .ou un renflement plus ou moins alongë; les
deux palpes extérieurs , ou les inférieurs , cylindriques
ou coniques, couverts d’ecailles ou très-velus,
de trois articles , dont le dernier très-petit ou
prefqué nul dans plufieurs; une langue filiforme ,
roulée en fpirâlè & ëiitré les palpes dans l’inadtion,
de deuxpièces' s’ërigrenànt l’une dans l’autre 81 formant
un tuyau ou paffe la liqueur miellëufe des
f le u r s qui y monte & parvient jufqü’à I’oefdphàge
au moyen du rapprochement partiel & fuccellif
de la trompe entière ; deux yeux ovales , à
réfeau , grands ; le corfelet ovale, de trois' fèg-'
mens bien unis’ & dont l’anlêrïéur très-court,
tranfverfal, en forme d,e collier 5 l ’abdomeu
‘ P A P
Ovale-alongé ou prefqué cylindrique, fouverit comprimé
latéralement, toujours mou; quatre grandes
ailes farineufes , ou couvertes de petites écailles
difpofées fur le fond membraneux de l’aile ;
ces ailes font triangulaires dans les uns , oblon-
gues ou ovales dans les autres; l’infedle , lorf-
qu’il eft en repos , les élève prefqué toujours
dans une fifuation perpendiculaire ; leur bord
poltérieur, dans ceux qui les ont en triangle
curviligne , pvéfente foulent beaucoup d’inégalités,
comme des dentelures de diverfes formes,
des efpèces de queues ; les ailes fupérieures fe
couchent fur une bonne partie des inférieures ;
celles-ci ont le côté interne concave ou pliflé
longitudinalement , formant même par fes plis,
dans quelques efpèces exotiques de notre genre
Papillon proprement dit, une poche très-ve-
lqulée à l’intérieur ; l’abdomen du mâle eft profondément
divifé à fon extrémité poftérieure
en deux lobes ou valvules prefqu’ovales , en
forriie de, pinces ou de cuillers , ayant à leur face
interne & concave un appendice écailleux & denté.
Au point fupérieur de réunion de ces deux lobes ,
& dans-leur entre-deux, eft une autre pièce de
la même confiftance , avancée, linéaire, arrondie
8c un peu courbée au b ou t;1 le pénis , ou l ’or-
ganè fexuel proprement dit , eft intérieur & renfermé
entre deux autres parties pareillement cornées,
comprimées , angüieufes ou un peu dentées
à leur bord fupérieur, & faifant, à ce qu’il pavoît,
l’office de pinces ; elles occupent, avec le pénis,
le milieu de la cavité intérieure , comprife entre
les valvules terminales.
Il eft effentiel de eonnoître les fexès de ces
infecles , les ailes du mâle &' de là femelle n’étant
pas toujours colorées de même. Les pattes font au
nombre de fix ; les jambes n’ont fouvent que j
deux éperons ou deux épines plus longues & |
fil liées à leur extrémité ; mais dans les Hefpéndes, ’
lès deux jambes poftérieures en ont encore deux ,
placées vers le milieu du côté interne. Les tarfes
ont cinq articles; le dernier eft tevminé par deux
crochets dont la forme varie. Les pattes antérieures
font , dans un très-grand nombre , inu- !
tiles à l’aôlion de marcher ; tantôt elles reffem-
blent eflènliellemênt aux quatre autres , mais elles
font très-petites &. cachées ; tantôt, quoique toujours
.plus, courtes, elles font fans crochets , plus
apparentes , beaucoup plus velues que les autres ,
pvefque repliées fur elles-mêmes de chaque côté
du cou , en manière de1 cordon ou dé pendant
de palatine ; ce qui les a fait nommer pattes en
palatine. Sr les fix pattes font femblables & à
peu près également propres à la marche, le Papillon.
eft hexapode y fi les: deux antérieures font
ou très-petites ou en palatine , il eft tétrapode y
ç.eft-,à-.dire que l’infecté a fix pieds ambulatoires dans lé premier cas , & quatre dans le fécond.
Les .Lépidoptères diurnes, ainfi que l’indique
cette défignation , ne volent que pendant le jour;
P A P .5
encore faut-il que l’aftre qui y préfide foi t depuis
quelqüe temps fur l’horizon & qu’il les ait
invités , par un accroiflement de chaleur , à quitter
leur retraite. Il en eft prefque de leur manière
de voler comme de celle des oifeaux ^
elle varie félon les races , & les naluraliftes , faits
à ces fortes d’ob fer valions, diftinguent fouvent
lés efpèces au moyen de ces habitudes.
Bien plus frêles que la plupart des autres in-
feôles , les Lépidoptères diurnes doivent redouter
les temps pluvieux. La gaze de leurs ailes fcroit
bientôt froiffée ou altérée, & , incapables de faire
ufage de ces organes, ils périroient fans avoir
rempli lé but de la nature. Deftinés à fe nourrir
du lue des fleurs, la faifon de l’hiver ne pouvoit
leur convenir. Ceux qui.exiftent alors, foit
fous la forme de chenilles ou de cliry falides, foit,
mais rarement', fous celle d’infeâes parfaits, font
dans un état léthargique & n’ont pas beloin d’ali-
mens pendant ce long fommeil. Certaines efpèces
de Piérides, de Çoliades & de Thaïs, ou de celles
que l’on défigne fous le nom de Papillons braficaire
s , & quelques-unes de leurs analogues, parodient
dès'les derniers beaux jours de l’hiver
ou au commencement du printemps ; plufieurs
d’entr’elles néanmoins ne produifent qu’une feule
génération par année , les plantes printanières ,
dont leurs chenilles fe nourriffent exclufivement ,
ayant difparu. Mais c’eft aux mois de juin & de
juillet que les Diurnes , dans nos climats , fe montrent
en plus grande abondance; quelques efpècesy
du genre des Satyres, font plus tardives. La porte—
rité de plufieurs Diurnes précoces fe développe
promptement Si fe renouvelle dans l’arnère-faifon.
Les bois Si les forêts font les lieux les plus favorables
à la multiplication de ces infeâes; c’eft
là aufîi qu’il faut les chercher 81 épier , pour
ainfi dire, les premiers inftans de leur apparition,
afin de pouvoir faifir des individus d’une'
grande fraîcheur. L’éducation de leurs chenilles,
ainfi que celle des autres Lépidoptères, quoique
exigeant plus de foins , eft plus avantageufe fous
ce rapport 81 plus profitable à la fcience , puifque
elle procure des documens certains fur les moeurs
Siles habitudes de ces animaux. Quelques Diurnes,
du genre des Satyres, le tiennent, de préférence
dans les endroits rocailleux ou pierreux. D’autres
efpèces aiment les ruifï’eauX ou les lieux humides.
1 Eu général , les localités où' ces infeêbes fe trouvent
le plus habituellement font déterminées par
la préfence des végétaux qui doivent fervir de
nourriture à leur race., 81 fur lefquels ou auprès
defquels les femelles dépofent leurs oeufs.
Certaines efpèces n’habitent que les montagnes,
81 ■ quelques-unes même s’y tiennent à une élévation
confidérable , parce que là feulement
I
croiffent les plantes, qui alimenteront leur famille.
La réunion des deux fexes s’opère en plein
jou r, Se fouvent le mâle entraîne dans les airs la
l compagne de fes plaifirs. Celui-ci périt bientôt