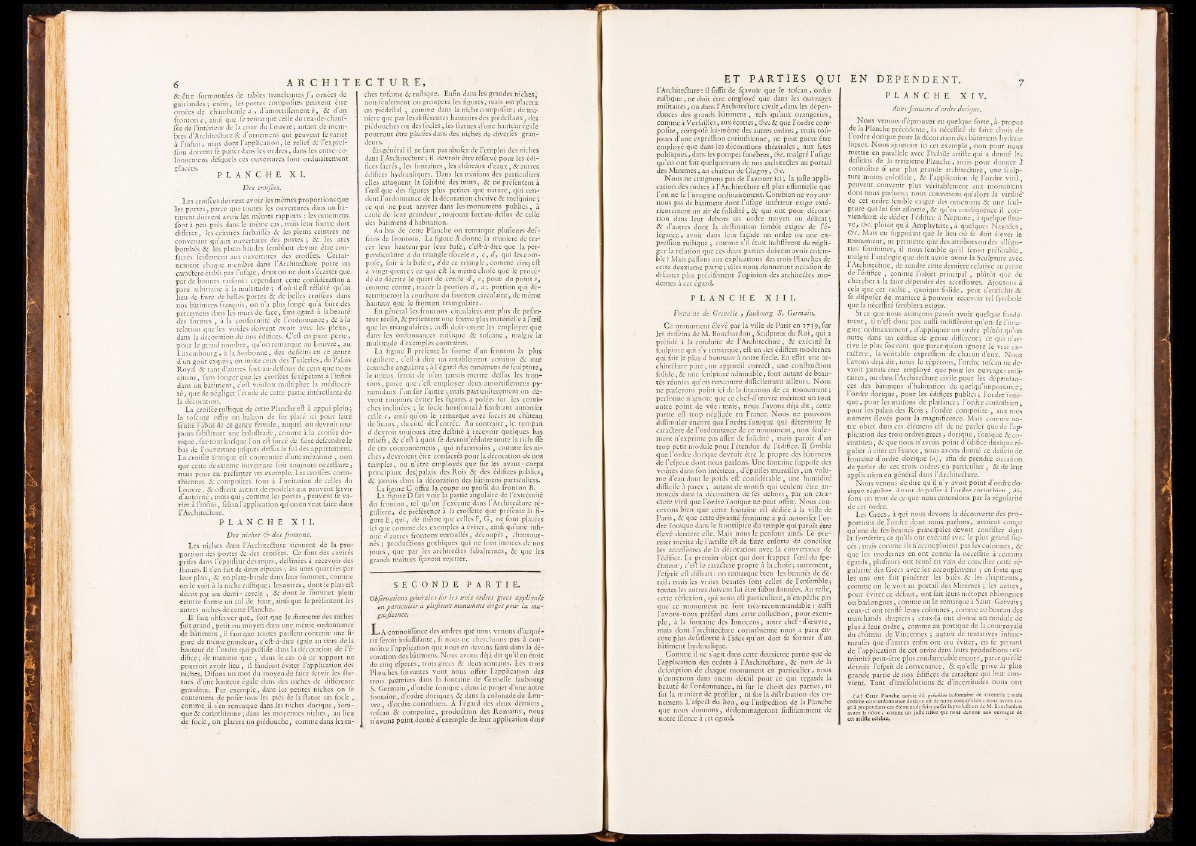
§
m
6 A R C H I T ]
Sc être fin-montées 3c tables tranchantes ƒ , ornées^ de
guirlandes-, enfin, les portes compofites peuvent être
ornées de chambranles, d’amoçtilfement b , & d’un
fronton c , ainfi que fe remarque celle du rez-de-chauf-
fée de l’intérieur de la cour du Louvre ; autant de membres
cf Architecture ôc d’ornemens qui peuvent fe varier
à l’infini, mais dont l’application, le relie f & l’expref-
'îion doivent fe puiferdans les ordres, dans les entre-co-
lonnèmens defquels ces ouvertures font ordinairement
'placées.
P L A N C H E X I .
Des croifées»
Les croifées doivent avoir les mêmes proportions que
les portes-, parce que toutes les ouvertures dans un ba-
'timent doivent avoir les mêmes rapports : les ornemens
font à-peu-près dans le même cas, mais leur forme doit
-différer, les ceintrèsJurbaiffés ôc les pleins ceintres ne
•convenant qu’aux ouvertures des portes ; ôc les arcs
•bombés & les plates-bandes femblant devoir êtrecon-
facrés feulement aux ouvertures des croifées. Certainement
chaque membre dans l’Archïteéfcure^ porte un
‘caraétere établi par f ufàge, dont on ne doit s ecarter que
par de bonnes raifons : cependant cette considération a
paru arbitraire à la multitude ; d’où il eft réfulté qu’au-
lieu de faire de belles portes ôc de belles croifées dans
nos bâtimens françois, on n’a plus fongé qua faire des
percemens dans les murs de face , fans égard a la beau te
des formes , à la conformité de l’ordonnance, & à la
relation que'les vuides doivent avoir avec les pleins,!
dans la décoration de nos édifices. G’eft en pure perte,
pour le grand nombre, qu’on remarque au Louvre , au
Luxembourg, à la. Sorbonne, des defïèins en ce genre
d ’un goût exquis-, on imite ceux des Tuileries, du Palais-
Royal ôc tant d’aùtres fort au-deffous de ceux que nous
citons, fans fonger que les croifées fe répétant à l’infini'
dans un bâtiment, c’eft vouloir multiplier la médiocrit
é , que de négliger l’étude de cette partie intéreffante de
la décoration.
La croifée ruftique de cette Planche eft à appui plein ;
la tofeane offre un balcon de fer placé ici pour faire
fentir l’abus de ce genre frivo le , auquel on devroit toujours
fubftituer une baluftrade, comme à la croifée dorique
, fur-tout lorfque l’on eft forcé de faire defeendre le
bas de l’ouverture jufques deffus le fol des appartemens.
La croifée ionique eft couronnée' d’une mézanine , -non
que cette deuxieme ouverture foit toujours néceflàire,
mais pour en préfenter un exemple. Les croifées corinthiennes
ôc compofites font à Limitation de celles du
Lou vre , ôc offrent autant de modèles qui peuvent fèrvir
d’autorité, mais qu i, comme les po rtes, peuvent fe varier
à l’infini, félon l’application qu’on en veut faire dans
l ’Architeélure.
P L A N C H E X I I .
Des niches & des frontons.
Les niches dans l’Architeâure tiennent de la proportion
des portes ôc des croifées. Ce font dés cavités
prifes dans l’épaiffeur des murs, deftimées à recevoir des
ftatues. Il s’en fait de deux efpeces -, les unes quarrées par
leur plan, & en plate-bande dans leur fommet, comme
on le voit à la niche ruftique ; les autres, dont le plan eft
décrit par un demi - cercle , & dont le fommet plein
ceintre forme un cul de four,ainfi que lepréfentertt les
autres niches de cette Planche.
Il faut obferver que, foit que le diamètre des-niches
fpit grand, petit ou moyen dans une même ordonnance
3e bâtiment, il faut que toutes puiffent contenir une figure
de même grandeur, c’eft-à-dire égale au tiers delà
hauteur de l’ordre qui préfide dans la décoration de 1 e-
difice j de maniéré que , dans le cas ’ou ce rapport ne
pourroit avoir lieu , il faudroit éviter l’application des
niches. Difons un mot du moyen de faire fèrvir les ftatues
d’une hauteur égale dans des niches de différente
grandeur. Par exemple, dans les petites niches on fè
contentera de pofèr fous les piés de la ftatue un fo'cle ,
comme, il s’en remarque dans les niches dorique, 'ionique
ôc corinthienne -, dans les moyennes niches, au lieu
de fo d e , on placera un piédouche, comme dans les ni-
C T U R E ,
ches tofeane & -ruftique. Enfin dans les grandes niches,’
non-feulement on groupera les figures,-mais on placera
un piédeftal , comme dans la niche compofite; de maniéré
que par les différentes hauteurs des piédeftaùx, des
piédouches ou des focles, les ftatues d’une hauteur égale
pourront être placées dans des niches de diverfes'-grandeurs.
En général il ne faut pas abufer de l’emploi des niches
dans l’Archireéture ; il devroit êtreréfèrvé pour les édi-3
fices faciès, les fontaines, les châteaux d’eaux, & autres
édifices hydrauliques. Dans les maifons des particuliers
elles attaquent là folidité des murs, ôc ne préfèntent à
l’oeil que des figures plus petites que nature , qui rendent
l’ordonnance de la décoration chétive ôc mefquine ;
ce qui ne peut arriver dans les monumens publics, à
caufe de leur grandeur, toujours fort au-deffus de celle
des bâtimens d’habitatiom
Au bas de cette Planche on, remarque plufîcurs deC-
feins de frontons. La figure A donne la maniéré de tracer
leur hauteur par leur bafe, c’eft-à-dire que la perpendiculaire
ci du triangle ifocele a , c , d , qui lescom-
pofe, foit à la b a fe c , d de ce triangle * comme cinq eft
à vingt-quatre’, ce qui eft la même chofè que le procédé
de décrire le quart de cercle d , e , pour du point e ,
comme centre, tracer la portion d , a\ portion qui dé-
termineroit la courbure du fronton circulaire, de même
hauteur que le fronton triangulaire.
En général les frontons circulaires-Ont plus de pëfân-
teur réelle, ôc préfentent une forme plus matérielle à l’oeil
que les triangulaires ; aufli doit-on ne les employer que
dans les ordonnances ruftique ôc tofeane., malgré la
multitude d’exemples contraires. •
La figure B préfènte la forme d’un fronton la plus
régulière, c’eft-à-dire un entablement continu ôc une
corniche angulaire ; à l’égard des ornemens de fculpture,
le mieux feroit de n’en jamais mettre defliis les frontons
, parce que c’eft employer deux amortiflemens pyramidaux
l’un fur l’autre ; mais particulièrement on devroit
toujours éviter les figures a pofées fur les corni*
ches inclinées ; le focle horifontal b femblant autorifer
celle c , ainfi qu’on le remarque avec fuccès au château
de Seaux, du côté de l’entrée. Au contraire, le tympan
d devroit toujours être deftiné à recevoir quelques bas
reliefs, Ôc c’eft à quoi fè devroit\éduire toute la richeffè
de ces couronnemens , qui néanmoins , comme les niches,
devroient être confàcrés pour la décoration de nos
temples, ou n’ être employés que fur les avant-corps
principaux des]palais des Rois ôc des édifices publics,
ôc jamais dans la décoration des bâtimens particuliers.
La figure C offre Ja coupe ou profil du fronton B.
La figure D fait voir la partie-angulaire de l’extrémité
du fronton, tel qu’on l’exécute dans l’Architeéture régulière,
de préférence à la croffette que préfènte la figure
E , q u i, de même que celles F, G , ne font placées
ici que comme des exemples à éviter, ainfi qu’une infi-i
nité d’autres frontons enroullés, découpés , chantournés
•, productions gothiques qui ne font imitées de nos
jo u rs , que par les architectes fubalternes, ôc que les
grands maîtres fçavent rejetter.
S E C O N D E P A R T I E .
Obferv ations generales fur les trois ordres grecs appliqués
en particulier à plujieurs monumens érigés pour la ma
gnificence.
L a connoiflànce des ordres que nous venons d’acquérir
feroit infuffifante, fi nous ne cherchions pas à con-
noître l’application que nous en devons faire dans la décoration
des bâtimens. Nous avons déjà dit qu’il en étoic
de cinq efpeces , trois grecs ôc deux romains. Les trois
Planches fuivantes voiit nous offrir l ’application des
trois premiers dans la fontaine de Grenelle faubourg
S. Germain, d’ordre ionique ; dans le projet d’une autre
fontaine, d’ordre dorique; ôc dans la colonadedu Louvre
, d’ordre corinthien. A l’égard des deux derniers ,
tofean ôc compofite, production des Romains, noup
n’avons point donné d’exemple de leur application dans'
7 ET P A R T I E S QU
l ’ArchiteCture: il fuffir de fçavoir que le tofean, ordre
ruftique , ne doit être employé que dans les Ouvrages
militaires, ou dans l’ArchiteCture civ ile , dans les dépendances
des grands bâtimens, tels -qu’aux orangeries,
comme à Verfailles, aux écuries, & c. ôc que l’ordre compofite,
compofé lui-même des autres ordres,' maistoû-
jours d’une exprelfion corinthienne, ne fieut guere être
employé que dans les décorations théâtrales, aux fêtes
publiques, dans les pompes funèbres, & c. malgré l’ufage
qu’en ont fait quelques-uns de nos architectes au portail
des Minimes, au château de G lagny, &c.
Noiis ne craignons pas de l’avouer ici; la jufte application
des ordres à l’ArchiteCture eft plus eflèrttielle que
l’on ne fe l’imagine ordinairement. Combien ne voyons-
nous pas de bâtimens dont l’ufage intérieur exige extérieurement
un air de folidité, Ôc qui ont pour décoration
dans leur dehors un ordre moyen ou délicat ;
Ôc d’autres dont la deftination fèmble exiger de l’ élégance,
avoir dans leiir façade un ordre ou une ex-,
prelïion ruftique, comme s’il étoit indifférent de négliger
la relation que ces deux parties doivent avoir enfèm-
ble ? Mais paffons aux explications des trois Planches de
cette deuxieme partie ; elles nous donneront occafiôii'de
difeuter plus précifément l’opinion des architectes modernes
à cet égard.
P L A N C H E XI I I .
Fontaine de Grenelle , faubourg S. Germain.
C e monument élevé par la ville de Paris en 1739, fur
les deffeins de M. Bouchardon, Sculpteur du R o i , qui a
préfidé à Ja conduite de l’ArchiteCture , ôc exécuté la
fculpture qui s’y remarque, eft un des édifices modernes
qui fait le plus d’honneur à notre fiecle. En effet une-architecture
pure, un appareil correCt, unc conftruCtion
folide, & une fculpture admirable, font autant de beautés
réunies qu’on rencontre difficilement ailleurs. Nous
ne parlerons point ici de la fjtuatio^n de-ce. monument ;
perfonne n’ignore que ce chef-d’oeuvre méritoit un tout
autre point de vue: mais, nous, l’avons déjà d it, cette
partie eft trop négligée en France. Nous ne pouvons,
diffimuler encore que l’ordre ionique qui détermine le
caraCtere de l’ordonnance de ce monument -, non-feulement
n’exprime pas aflèz de folidité , mais paroît d’un
trop petit module pour l’étendue de l’édifice. Il fèmble
que l’ordre dorique devroit être le propre des bâtimens
de l’efpece dont nous parlons. Une fontaine fuppofe des
voûtes dans fon intérieur, d’épaiftès murailles,un volume
d’eau dont le poids eft confidérable , une humidité
difficile à parer ; autant de motifs qui veulent être annoncés
dans la décoration de fès dehors, par un caraCtere
viril que l’ordre ïonique ne peut offrir. Nous concevons
bien que cette fontaine eft dédiée à la ville de
Paris, ôc que cette divinité féminine a,pu autorifèr l’ordre
ïonique dans le frontifpice du rempic qui paroît être
élevé derrière elle. Mais nous le penfbns ainfi. Le premier
mérite de l’artifte eft de faire enforte de concilier
les acceffoires de la décoration avec la convenance de
l’édifice. Le premier objet qui doit frapper l’oeil du fpe-
Ctateur, c’eft le caraétere propre à la chofè; autrement,
l’éfprit eft diftrait : on remarque bien les beautés de détail
; mais les vraies beautés font celles de l’enfèmble ;
toutes les autres doivent lui être fubordonnées. Au refte,
cette réflexioii, qui'noiis eft particulière, n’empêche pas
que" ce monument ne foit ttès-recommandable : aiiffi
l’avons-nous préféré dans cette colle&ion, pour exemple
, à la fontaine des Innocens, autre chef - d’oe uvre,
mais dont l’architeélure corinthienne nous a paru encore
plus defaffortie à l’idée qu’on doit fe former d’un
bâtiment hydraulique.
Comme il ne s’agit dans cette deuxieme partie que de
l’application des ordres à l’Architeéfcure, ôc non de la
defeription de chaque monument en particulier, nous
n’entrerons dans aucun détail pour ce qui regarde la
beauté de l’ordonnance, ni fur le choix des parties, ni
fur la maniéré de profiler, ni fur la diftribution des ornemens.
L’afpeéfc du lieu, ou l'infpeétion de la Planche
que nous donnons, dédommageront fuffifâmment de
notre filence à cet égard.
EN DEP ENDENT .
P L A N C H E XI V.
Autre fontaine dé ordre dorique.
Nous venons d’éprouver en quelque forte, à-propos
de la Planche précédente, la néceffité de faire choix de
1 ordre dorique pour la décoration des bâtimens hydrauliques.
Nous ajoutons ici cet exemple, non pour nous
mettre en parallèle avec l’habile artifte qui a donné les
defïèins de la treizième Planche, mais pour donner à
connoitre fi une plus grande architecture, une fculpture
moins coloflàle, ôc l’application de l’ordre v ir il,
peuvent convenir plus véritablement aux monumens
dont nous parlons; nous convenons qu’âlors la virilité*
de cet ordre fèmble exiger des ornemens & une fculpture
qui lui foit aflbrtie, ôc qu’en conféquence il con-
viendroit de dédier l’édifice à Neptune, à quelque fleuv
e , &c. plutôt qua Amphÿtrite, à quelques Nayades,
& c . Mais en fuppofànt que le lieu où fè doit élever le
monument, ne permette que des attributs ou des allégories
féminines, il nous fèmble qu’il fèroit préférable,
malgré l’analogie que doit avoir avoir la Sculpture avec
1 Architecture, de rendre cette derniere relative au genre
de 1 édifice , comme l’objet principal , plutôt que de
chercher à la faire dépendre des acceffoires. Ajoutons à
cela que cet ordre, quoique folide, peut s’enrichir ôc
fe difpofer de maniéré à pouvoir recevoir tel fymbolc
que la néceffité femblera exiger.
Si ce que nous avançons; paroît avoir quelque fondement
, il n’eft donc pas aüffi indifférent qu’on fe l’imagine
ordinairement, d’appliquer un ordre plutôt qu’un
autre dans un édifice de genre différent; ce qui n’arrive
le plus foiivent que parce qu’on ignore le vrai caraCtere
, la véritable exprelfion de chacun d’eux. Nous
l’avons déjà d it, nous le répétons, l’ordre tofean ne devroit
jamais être employé que pour les ouvrages mili*
taircs, ou dans l ’ArchiteCture civile pour les dépendaoe-
ces des bâtimens d’habitation de quelqu’importance;
l’ordre dorique, pour les édifices publics; Lordre ioniq
u e , pour les maifons deplaifànce; l ’ordre corinthien,
pour les palais des Rois ; l’ordre compofite , aux moi
numens élevés pour la magnificence. Mais comme notre
objet dans ces élémens eft de ne parler que de l’application
des trois ordres grecs , dorique, ïonique ôc corinthien
, ôc que nous n’avons point d’édifice dorique régulier
à citer en France, nous avons donné ce deffèin dé
fontaine d’ordre dorique (a) , afin de prendre occafion
de parler de ces trois ordres en p a r t ic u li e r& de leur
application en général dans l’ArchiteCture.
Nous venons de dire qu’il n’y avoit point d’ordre dorique
régulier. Avant depaffèr à l’ordre corinthien , difons
un mot de ce que nous entendons par la régularité
de cet ordre.
Les Grecs, à qui nous devons la découverte des proportions
de l’ordre dont nous parlons, avoient conçu
qu’une de fès beautés principales deveit confifter dans
la fymécrie ; ce qu’ils ont exécuté avec le plus grand fuccès
; mais comme ils n’àccouploient pas les colonnes, ôc
que les modernes en ont connu la néceffité à certains
égards, plufieurs ont tenté en vain de concilier cette régularité
des Grecs avec les accouplemens ; en forte que
les uns ont fait pénétrer les bafes ôc les chapiteaux,
comme on le voit au portail des Minimes ; les autres,
pour éviter ce défaut, ont fait leurs métopes oblongues
ou barlongues, comme on le remarque à Saint-Gervais 3
ceux-ci ont renflé leurs colonnes , .comme au bureau des
marchands drapiers ; ceux-là ont donné un module de
plus à leur .ordre, comme au portique de la cour royale
du château de Vinçennes ; autant de tentatives infruc-
tueufès que d’autres enfin ont cru éviter, en fe privant
de l’application de cet ordre dans leurs produirions : extrémité,
peut-être plus condamnable encore, parce qu’elle
détruit l’efprit de convenance, ôc qu’elle prive la plus
grande partie de nos édifices du caraétere qui leur convient.
Tant d’irréfblutions ôc d’incertitudes nous ont
(a) Cette Planche auroic dû précéder la fontaine de Grenelle ; mais
comme ceitc ordonnance dorique eft de notre compofition > nous avons jugé
à propos dans ces élémens de faire palier Ja production de M. Bouchardon
avant la nôtre, comme un juite tribut que nous devons aux ouvrages de
cet auifte célébré»