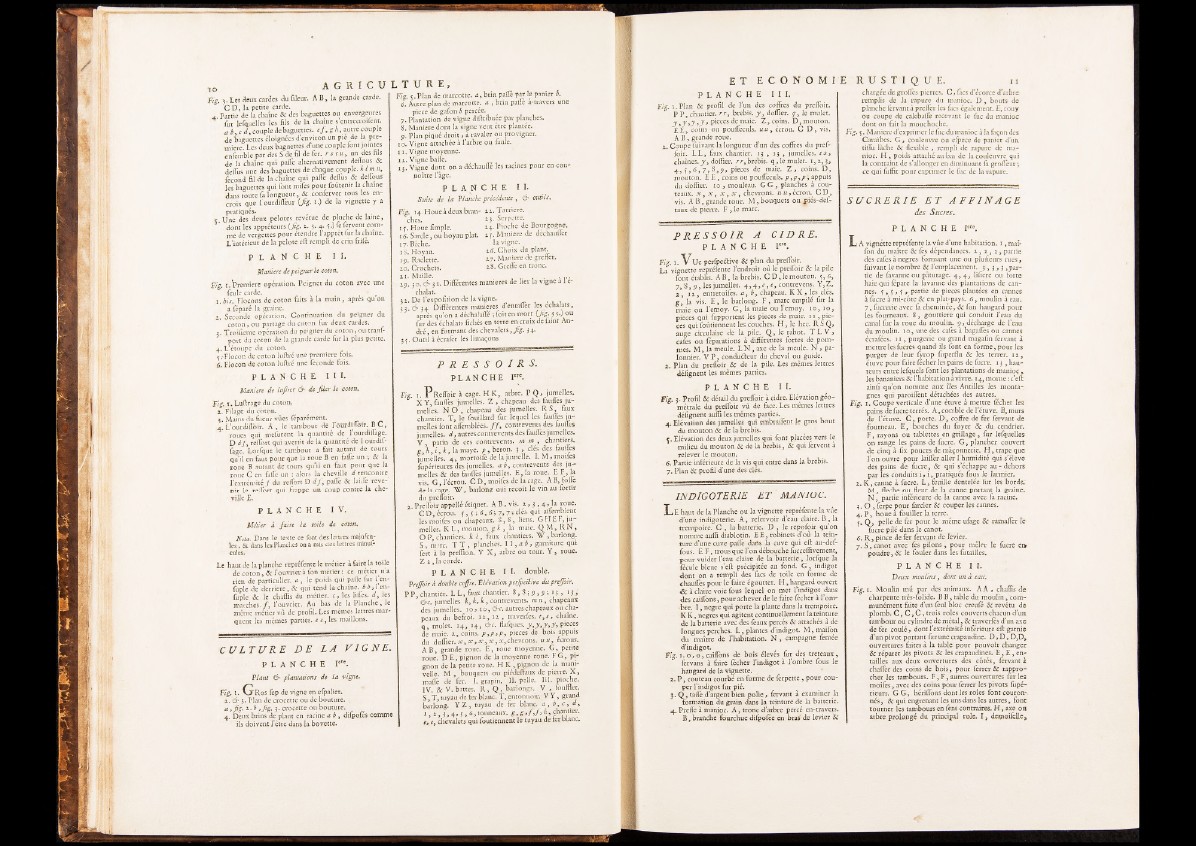
Fig. 5.Les deux cardes du fileur. À B , la grande carde.
C D , l a petite carde.
, Partie de la chaîne & des baguettes ou envergeures
fur lefq.uelles les fils de la chaîne s’entrecroifent.
a b , c d , couple de baguettes, e f , g h »autre couple
de baguettes éloignées d’environ un pie de la première.
Les deux baguettes d’une couple font jointes
cnfemble par des S de fil de fer. r s t u , un des fils
de la chaîne qui paffe alternativement deflous 8c
deflus une des baguettes de chaque couple, k lm n,
fécond fil de la chaîne qui palfe deffus & deflous
les baguettes qui font miles pour foutenir la chaîne
dans toute fa longueur, & .conferver tous les en-
croix que 1 ourdiffeur {fig. 1.) de la yignette y a
pratiqués. I I H 1 . .
«.U n e des deux pelotes revetue de pluche de laine,
dont les apprêteurs {fig. x. 3. 4- f .) fe fervent comme
de vergettes pour étendre l’apprêt fur la chaîne.
L ’intérieur de la pelote eft rempli de crin frifé.
p l a n c h e I I .
Manière de peigner le coton.
Fig. 1. Première opération. Peigner du coton avec une
feule carde. x ■ ,
1. bis. Flocons de coton faits a la main, apres qu on
a féparé la graine.
а. Seconde opération. Continuation du peigner du
coton, ou partage du coton fur deux cardes.
3. Troifieme opération du peigner du coton, ou transport'du
coton de la grande carde fur la plus petite.
4. L ’étoupe du coton.
ç.-Flocon de coton luftré une première fois.
б. Flocon de coton luftré une fécondé fois.
Fig. f . Plan de marcotte. Æ,brin paffé par le panier b.
6. Autre plan de marcotte, a , brin palfé à-travers une
pièce de gafon b percée.
7. Plantation de vigne diftribuée par planches.
8. Maniéré dont la vigne veut être plantée.
9. Plan piqué-droit, a ravaler ou provigner.
10. Vigne attachée à l’arbre ou foule.
1 1. Vigne moyenne,
i z . Vigne baffe.
13. Vigne dont on a déchaufTé les racines pour en con-
noître f âge.
P L A N C H E I I .
Suite de la Planche precedente , & outils.
Fig. 14. Houe à deux bran- 22. Tarriere,
23. Serpette.
24. Pioche de Bourgogne.
. 5. Maniéré de déchauffer
ches..
1 f . Houe fimple.
16. Sarcle, ou hoyau plat.
17. Bêche.
la vigne.
18. Hoyau.
16. Choix du plant.
ip. Raclette.
x j . Maniéré de greffer,
20. Crochets.
z 8. Greffe en tronc.
z i . Maille. _ I v ,,,
zp. 30. & 31. Différentes maniérés de lier la vigne ale*
chalat.
3 z. De l’expofition de la vigne. , , .
33. d* 34 Différentes maniérés dentafler les echalats,
après qu’on a déchalafTé -, foit en mort {fig. 3 3 •) ou
fur des échalats fichés en terre en croix de feint André,
en formant des chevalets,./?#. 34.
3 f. Outil à écrafer les limaçons
P L A N C H E I I I .
Maniéré de lufirer & de filer le coton.
Fig. ï . Luftrage du coton.
z . Filage du coton. t
3. Mains du fileur vues féparément. _
4. L ’ourdiffoir. A , le tambour de l’ourdiffoir. B C ,
roues qui mefurent la quantité de ^ l’ourdiflage.
D d j , reflbrt qui avertit de la quantité de 1 ourdif-
fage. Lorfque le tambour a fait autant de tours
qu’ il en faut pour que la roue B en fafle un ; & la
roue B autant de tours qu’ il en faut pour que la
roue C en faffe un : alors la cheville d rencontre
l’extrémité ƒ du reffort D d j , paffe 8c laiife revenir
le relfort qui .frappe un coup contre la cheville
E.
P L A N C H E I V.
Métier a faire la toile de coton.
Nota. Dans le texte ce font des lettres majufeu-
les, & dans les Planches on a mis des lettres minuf-
cules.
Le haut de la planche repréfente le métier à faire la toile
de coton, & l’ouvrier à fon métier : ce métier n’a
rien de particulier, a , le poids qui patïe fur 1 en-
fuple de derrière, & qui tend la chaîne, b b , 1 en-
fuple & le chaffis du métier, c , les liiles. d , les
marches, ƒ , l’ouvrier. Au bas de la Planche, le
même métier vû de profil. Les mêmes lettres marquent
les mêmes parties, e c , les maillons. ,
C U L T U R E D E L A V IGNE .
P L A N C H E I ' " .
Plant & plantations de la vigne.
Fig. 1. ( j R o s fep de vigne en efpalicr.
z . & 3. Plan de crocette ou de bouture. ,
a , fig. x. b ,fig. 3. crocette ou bouture.
4. Deux brins de plant en racine a b , difpofés comme
ils doivent l’être dans la bovette.
P L A N C H E Iere.
Fig. 1. P R c f lb i r à cage. H K , atbre. P Q , jumelles.
X Y s feu lfe 'jum e lle s . ZW hape au des fiiiffes ju-
melles. N O , chapeau des jumelles. R S , faux
chantier. T , le fouillard fur lequel les faillies jumelles
font affemblées. f f , contrevents des fouffes
jumelles, d , autres contrevents des fauffes jumelles.
V patin de ces contrevents, m m , chantiers.
g \ , i , k , U maye. p , beron. 3 , clés des fauffes
jumelles. 4 , mortoife de la jumelle. L M , moifes
fupérieures des jumelles, a b , contrevents des jumelles
& des fauffes jumelles. E , la roue. E F , la
vis. G , l’écrou. C D , moifes de la cage. A B, fofle
de la cage. W , barlong qüi reçoit le vin au fortir
du prefloir.
z . Preffoir appellé étiquet. A B , vis. z , 3 i 4 ».la roue.
C D , écrou. f , ï 3 6; 6 -, 7 , 7 5 clés qui affemblent
les moifes ou chapeaux.-8 ,8 , liens. G H EF, jumelles.
K L , mouton, g k , la maie. Q M , R N ,
O P, chantiers, k t , faux chantiers. W , barlong.
S , marc. T T , planches. 1 1 , a b , garniture qui
fort à la preffion. V X , arbre ou tour. Y , roue.
Z z , la corde.
P L A N C H E I I . double.
Prejfoir a double coffre. Élévation perfpective du preffoir.
P P chantier. L L , faux chantier. 8 , 8 3 9 , 9-, 13 , 15,'
9 & c. jumelles k , k , k , contrevents, m n , chapeaux
des jumelles. 10» 10, &c. autres chapeaux ou chapeaux
du befroi. i z , i z , traverfes. t , s , chaîne,
q , mulet. 14 , 1 4 , & c- flafques. y , y , y ,y , pièces
de maie, z , coins. p ,p » p 9 pièces de bois appuis
du doffier. x , x , x , x , je,chevrons, u u , écrous.
A B , grande roue. E , roue moyenne. G , petite
roue. D E , pignon de la moyenne roue. F G , pignon
de la petite roue. H K , pignon de la manivelle.
M , bouquets ou piédeftaux de pierre. X ,
maffe de fer. I. grapin. II. pelle. III. pioche.
IV. & V. battes. R , Q , bal-longs. V , foufnet.
S T , tuyau de fer blanc. T , entonnoir. V Y , grand
barlong. Y Z , tuyau de fer blanc, a , b , c , d ,
i , z , 3 , 4 > f , 6 , tonneaux, g ,g > j9f> h , chantier.
e, e, chevalets qui foutiennent le tuyau de fer blanc.
P L A N C H E I I I .
Fig. i.P la n & profil de l’un des coffres du preffoir.
P P chantier, r r , brebis, y , doffier. j , le mulet.
y , y , y , y > pièces de maie. Z , coins. D , mouton.
E E , coins ou pouffeculs. u u , écrou, C D , vis.
A B , grande roue.
z . Coupe fuivant-la longueur d’un des coffres du preffoir.
L L , faux chantier. 13 , 13 , jumelles, t s ,
cha îne s.y, doffier. rr,brebis, q , le mulet. i , z , 3,
4 , f > 6»7, 8 ,9 , pièces de maie. Z , coins. D ,
mouton. E E , coins ou pouffeculs. p 9p 9p 9 appuis
du doffier. 10 , mouleau. G G , planches à couteaux.
x , x , x , x , chevrons, u u , écrou. C D ,
vis. A B , grande roue. M , bouquets ou jpies-defr
taux de pierre. F , le marc.
P R E S S O I R A C I D R E .
P L A N C H E Iere.
Fig. 1. V Ue perfpeéHve & plan du preffoir.
La vignette repréfente l’endroit où le prefloir & la pile
font établis. A B , la brebis. C D , le mouton, f , 6,
les jumelles. 4 , 4 , * , e , contrevens. Y ,Z ,
z 1 z , entretoifes. a , b , chapeau. K X , les clés.
gl la vis. E, le barlong. F , marc empilé fur la
maie ou l’emoy. G , la maie ou l’emoy. 10 , 10,
pièces qui fupportent les pièces de maie. 1 1 , pièces
qui foutiennent les couches. H , le hec. R S Q ,
auge circulaire de la pile, Q , le rabot. T L V ,
cafes ou féparations à différentes fortes de pommes.
M , la meule. ,L N , axe de la meule. N , pa-
lonnier. V P , condii&eur du cheval ou guide.
z . Plan du prefloir & de la pile. Les mêmes lettres
défignent les mêmes parties.
P L A N C H E I î .
Fig. J- Profil & détail du preffoir à cidre. Elévation géo-
métrale du prefloir vû de face. Les mêmes lettres
défignent auffi les mêmes parties.
4. Elévation des jumelles qui embraflènt le gros bout
du mouton & de la brebis.
f . Elévation des deux jumelles qui font placées vers le.
milieu du mouton & de la brebis, & qui fervent a
relever le mouton.
6. Partie inférieure de la vis qui entre dans la brebis.
7. Plan & profil d’une des clés.
INDIGOTERIE ET MANIOC.
L e haut de la Planche ou la vignette repréfente la vue
d’une indigoterie. A , refervoir d’eau claire. B , la
trempoire. C , la batterie. D , le repofoir qu’on
nomme auffi diablotin. E E , robinets d’où la teinture
d’une cuve paffe dails la cuve qui eft au-def-
fous. E F , trous que l’on débouche fucceffivemenr,
pour vuider l’eau claire de la batterie, lorfque la
fécule bleue s’eft précipitée au fond. G , indigo t
dont on a rempli des focs de toile en forme de
chauffes pour le faire égoutter. H , hangard ouvert
<8c à claire voie fous lequel on met l’indigot dans
des caiffons, pour achever de le faire fécher à l’om-
■ bre. I , negre qui porte la plante dans la trempoire.
K K , negres qui agitent continuellement la teinture
de la batterie avec des féaux percés & attachés à de
longues perches. L , plantes d’indigot. M ,maifon
du maître de l’habitation. N , campagne femée
d’indigot.
Fig. 1. o , o j caiflons de bois élevés fur des tréteaux ,
fervans à foire fécher l’indigot à l’ombre fous le
hangard de la vignette. .
z . P , couteau courbé en forme de ferpette , pour couper
l’indigot fur pié.
3. Q , taflè d’argent bien po lie , fervant à examiner la
formation du grain dans la teinture de la batterie.
4. Prefle à manioc. A , tronc d’arbre percé en-travers.
B , branche fourchue difpofée en bras* de levier 8c
chargée de grofles pierres. C , focs d’écorce d’arbre
remplis de la rapure du manioc. D , bouts de
planche fervant à preffer les focs également. E, couy
; ou coupe de calebafle recevant le fuc du manioc
dont on fait la mouchoche.
Fig. 5. Maniéré d’exprimer le fuc du manioc à la foçon des
Caraïbes. G , couleuvre ou efpece de panier d’un
tiflu lâche & flexible , rempli de rapure de manioc.
H , poids attaché au bas de la couleuvre qui
la contraint de s’allonger en diminuant fa groflèur-,
ce qui fuffit pour exprimer le fuc de la rapure.
S U C R E R I E E T A F F I N A G E
des Sucres.
P L A N C H E Iere.
L a vignette repréfente la vue d’une habitation. 1 , maî-
fon du maître & fes dépendances, z , z , 2 , partie
des cafes à negres formant une ou plufieurs rues ,
fuivant le nombre & l’emplacement. 3 , 3 , 3 , partie
de favanne ou pâturage. 4 , 4 , lifiere ou forte
haie qui fépare la fevanne des plantations de cannes.
r , 5 , f , partie de pièces plantées en cannes
à fucre à mi-côte 8c en plat-pays. 6 , moulin à eau.
7 , fucrerie avec fe cheminée, & fon hangard pour
les fourneaux. 8 , gouttière qui conduit l’eau du
canal fur la roue du moulin. 5), décharge de l ’eau
du moulin. 10, une des cafes à bagafles ou cannes
écrafées. 1 1 , purgerie ou grand magafin fervant à
mettre les fucres quand ils font en forme, pour les
purger de leur fyrop fuperflu & les terrer. 1 z ,
étuve pour faire fécher les pains de fucre. 13 , hauteurs
entre lefquels font les plantations de manioc,
les bananiers & l’habitation à vivre. 14, morne : c’eft
ainfi qu’on nomme aux îles Antilles les montagnes
qui paroiflènt détachées des autres.
Fig. 1. Coupe verticale d’une étuve à mettre fécher les
pains de fucre terrés. A , comble de l’étuve. B, murs
de l’étuve. C , porte. D , coffre de fer fervant de
fourneau. E , bouches du foyer & du cendrier.
F , rayons o u tablettes en grillage, fur lefquelles
on range les pains de fucre. G , plancher couvert
de cinq à fix pouces de maçonnerie. H , trape que
l ’on ouvre pour laiffer aller 1 humidité qui s’élève
des pains de fucre, & qui s’échappe au - dehors
par les conduits!, i , pratiqués fous le larmier.
z . K , canne à fucre. L , feuille dentelée fur les bords,'
M , fléché ou fleur de la canne portant la graine.
N , partie inférieure de la canne avec fe racine.
3 . O , ferpe pour farder & couper les cannes.
4. P , houe à fouiller la terre.
F* Q > pdfe de fer pour le même ufoge & ramaflèr le
fucre pilé dans le canot.
6. R , pince de fer fervant de levier.
7. S , canot avec fes pilons, pour mêler le fucre e»
poudre, & le fouler dans les futailles.
P L A N C H E I I .
Deux moulins, dont un à eau.
Fig. 1. Moulin mû par des animaux. A A , chaffis de
charpente très-folide. B B , table du moulin, communément
faite d’un feul bloc creufé Ôc revêtu de
plomb. C , C , C , trois rôles couverts chacun d’un
tambour ©u cylindre de métal, & traverfés d’un axe
de fer coulé, dont l’extrémité inférieure eft garnie
d’un pivot portant fur une crapaudinc. D , D , D,D,
ouvertures faites à la table pour pouvoir changer
& réparer les pivots & les crapaudines. E , E , entailles
aux deux ouvertures des côtés, fervant à
chafler des coins de bo is, pour ferrer & rapprocher
les tambours. F , F , autres ouvertures fur les
moifes, avec des coins pour ferrer les pivots fupé-
rieurs. G G , hériffons dont les rôles font couron-.
nés, & qui engrenant les uns dans les autres, font
tourner les tambours en fens contraires. H , axe ou
arbre prolongé du principal rôle. I , demoifelje,