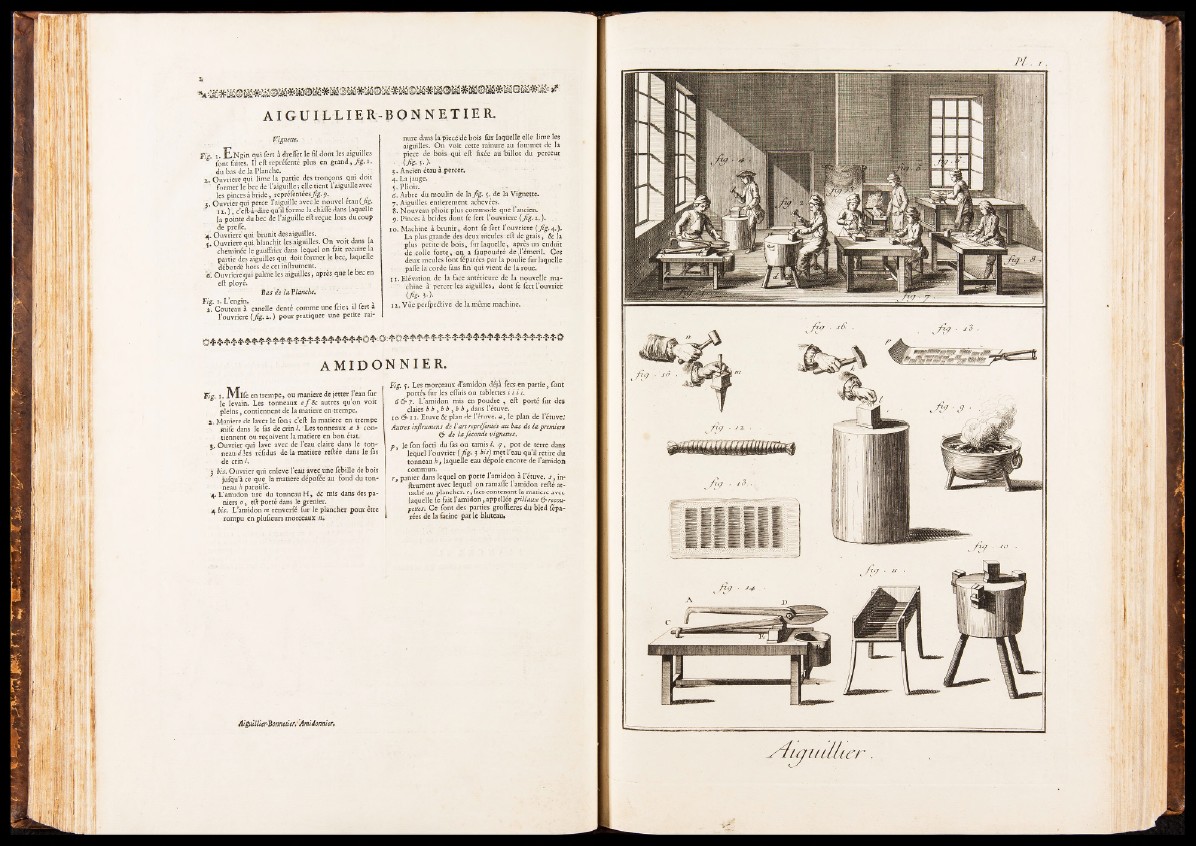
AI GUI LLI ER -BONNETIER.
Vignette. •
fig . i . E N g in qui fert à drefler le fil dont les aiguilles
font faites. Il eft repréfenté plus en grand , fig. i.
, du bas de Ja Planche.
а. Ouvrière qui lime la partie des tronçons qui doit
' former le bec de l’aiguille -, elle tient l’aiguille avec
les pinces à bride, repréfentées^g. p, f .
3. Ouvrier qui perce l’aiguille avec le nouvel etau {fig.
1 1. ) S c’eft-à-dire qu il forme la châfle dans laquelle
la pointe du bec de l’aiguille eft reçue lors du coup
. de prelfe.
4 . Ouvrière qui brunit des aiguilles.
ç. Ouvrière qui blanchit les aiguilles. O n voit dans la
cheminée le gauffrier dans lequel on fait recuire la
partie des aiguilles qui doit former le bec, laquelle
débordé hors de cet inftrument. . ^
б. Ouvrière qui palme les aiguilles , apres que le bec en
eft ployé.
Bas de la. Planché.
Fig. 1. L’engin. . ,
%. Couteau à canelle denté comme une icie, il lert a
l ’ouvriere {fig. 1. ) pour pratiquer une petite rainure
dans lâ plecé de bois fûr laqüelte elle lime les
aiguilles. On voit cette rainure au fommet de la
• pièce de bois, qui eft fixée au billot du perceur
‘ . i f i s - y "
3. Ancien étau à percer;
4. La jauge.
5. Plioir.
<5. Arbre du moulin de la fig. y. de la Vignette-
7. Aiguilles entièrement achevées.
8. Nouveau plioir plus commode que l’ancien.
9. Pinces à brides dont fe fert l’ouvriere {fig. 1, ). .
10. Machine à brunir, dont fe fert l’ouvriere { fig .4.).
La plus grande des deux meules eft de grais, & la
plus petite de bois t fur laquelle, apres un enduit
dé collé fo rte, on a fàupoudré de [l’émeril. Ces
deux meules font féparées par la poulie fur laquelle
pafle là corde fans fin' qui vient de la roue.
1 1..Elévation de la face antérieure de la nouvelle ma-
chine à percer les aigüilles, dont fe fert l’ouvriel:
(fis- }'•)■ '}
1 1. Vue perfpedive de la même machine.
AMIDONNIER.
fig . 1. jV l l f e en trempe, ou manière de jetter l’eau fur
le le vain. Les tonneaux e f & autres qu’on voit
pleins, contiennent de la matière en trempe.
X. Maniéré de laver le fon; c eft la matière en trempe
mife dans le (as de crin l. Les tonneaux a b contiennent
ou reçoivent la matière en bon état.
^.„Ouvrier qui lave avec de l’eau claire dans lé ton-
neaud les réfidus de la matière reftée dans le fas
de crin l.
3 bis. Ouvrier qui enleve 1 eaii avec une febille de bois
" * jufqu’à ce que la matieré dépofée au fond du tonneau
A pareille.
4 .L ’amidon tiré du tonneau H , & mis dans des paniers
0, eft porté dans le grenier.
'4 bis. L’amidon m renverfé fur le plancher pour être
rompu en plufieurs morceaux ni
Fig. ƒ. Les morceaux d’amidon déjà fées en partie, font
portés fur les efluis ou tablettes i i i i.
6 & 7 . L’amidon mis en poudre , eft porté fer des
claies b b ,b b >b b , dans l’étuve.
10 & 1 1. Etuve & plan de l’é t u v e . l e plan de l’étuve.’
Autres infirumens de C art reprêfentès au bas de la premier*
& de la fecotide vignettes.
p t le fon forti du fas ou tamis l. <7, pot de terre dans
lequel l’ouvrier {fig. 3 bis) met l’eau qu’il retire du
tonneau h , laquelle eau dépofe encore de l’amidon
commun.
r , panier dans lequel on porte l’amidon à l’étuve, s , in*
tournent avec lequel on ramaflè l ’amidon refté attaché
au plancher. r,(àcs contenant la matière avec
laquelle fe fait l’amidon , appellée grillaux & recou-
pettes. Ce font des parties groffieres du bled fépa-
rces de la krine parle bluteau*
Aiguillier-Bonnetier. • Amidonnier,