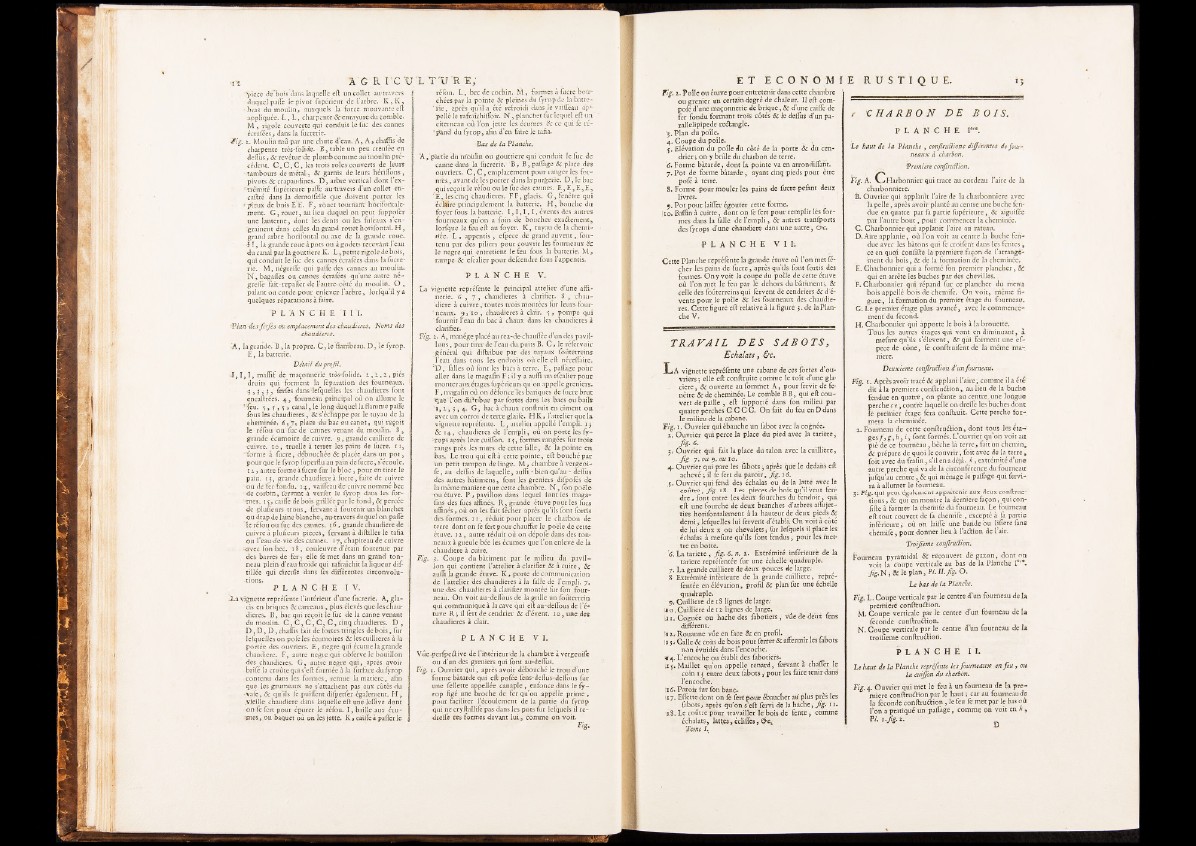
'’pièce dc'bois clans laquelle eft un collet au-travers
duquel paflè le pivot’ fupérieur de -l'arbre. K , K ,
•bras d um ou lin, auxquels la force mouvante eft
appliquée. L , L , charpente &enrayure du comble.
M , rigole couverte qui conduit le lue des cannes
écrafées, dans la fucrerie.
f ig . i . Moulin mû par une chute d’eau. A , A , chaffis de
charpente très-folide. B , table un peu creufée en
delTus, & revêtue de plomb comme au 'moulin precedent.
C , C , C , les trois rolescouverts de leurs
tambours de métal, Sc garnis de leurs héritions,
pivots & crapaudines. D , arbre vertical dont l’extrém
ité fupérieure paflè àu-tràvers d’un collet encadré
dans la demoifelle que doivent porter les
'pieux de bois E E. F , rouet tournant1 hôrifofitale-
ment. G , rouet, au lieu duquel on peut fuppoler
une lanterne, dont les dents ou les fufeaux s’engrainent
dans celles du grand rouet horifontal. H ,
grand arbre horifontal ou axe de la grande roue.
& I , là grande roue à pots ou à godets recevant l’eau
du canal par la gouttière K. L , petite rigole de bois,
qui conduit le fuc des cannes écrafées dans la fucrerie.
M,négreiTe qui paiTedes cannes au moulin.
N , bagaflès ou. cannes écrafées qu’une autre né-
greilè fait-repaflèr de l’autre-côté du moulin. O ,
palant ou corde- pour enlever l’arbre, -lorfqu’il y a
quelques réparations à foire.
P L 'A N C f i E I H
-Plan-des-firfès ôu emplacement des-chaudières. Noms des
chundieros.
A , la grande. B , la propre. C , le flambeau. D , le fyrop.
E , la batterie.
Detail du profil.
- I , I , I , maffif de maçonnerie très-folide. a , i , 2 , pies
droits qui forment la féparation des fourneaux.
3 , 3 , 3 , ' ferfes dans'lefquelles les1 chaudières font
encaftrées. 4 , fourneau principal où on allume le
' feu. f , f , f , canal, le long duquel la flamme paflè
fous les chaudières, & s’échappe par le tuyau de la
cheminée. 6 , '7 , plate du bac ou canot, qui reçoit
le réfou :ou’ fuc de caUnes venant du moulin. 8 ,
grande écumoire de cuivre. 9 , grande cuilliere de
•cuivre. 10 , truelle à terrer les pains de fucre. 11,
'forme a fucré, débouchée & placée dans un p o t ,
poür que le fyrop fuperflu au pain de fucre, s’écoule.
1 1 , autre forme à fucre fur le b lo c , pour en tirer le
pain. 13, grande chaudière à fucre, faite de cuivre
"ou de fer-fondu. 1-4, vaiflèau de cuivre nommé bec
• de cotbin, fètvant à verfer le fyrop dans les forâmes.
1 f , caiflè dé bois grillée par le fond, Sc percée
de pluneurs trous, fervant à foutenir un blanchet
ou drap de laine blanche, au-travers duquel on paflè
le réfou ou fuc des cannes. ï6 , grande chaudière de
cuivre à plufieurs pièces, fervant à diftiller le tafia
ou l’eau-de- vie des cannes. 17, chapiteau de cuivre
^âvec fon bec. 18 , couleuvre d’étain fbutenue par
des barres de fer ; elle fe met dans un grand tonneau
plein d’eau froide qui rafraîchit la liqueur d if
tillée qui circule dans fes différentes circonvolu-
-tions.
P L A N C H E I V.
-La vignette rcprélènte l’intérieur d ’une fucrerie. A, glacis
en briques Sc carreaux-, plus élevés que-les chaudières.
B , bac qui reçoit le fuc de la canne venant
du moulin. C , C , C , C , C , Cinq chaudières. D ,
D , D , D , chaffis fait de fortes tringles de bois, fur
lefquelles on pofeles écumoires Sc lescuillieres à la
portée des ouvriers. E , negre qui écume la grande
chaudière. F., autre negre qui obferve le bouillon
des chaudières. G , autre negre qu i, après avoir
brifé la croûte qui s’eft formée à la furface du fyrop
contenu dans les Formes, remue la matière, afin ;
que les grumeaux ne s’attachent pas . aux côtes du
• vafe, Sc qu’ils fe puiflènt difperfer egalement. H ,
.vieille chaudière dans laquelle eft une-leffive dont
on fe fert pour épurer le-réfou. I , baille aux écu-
~*ne$., ou baquet où on les jette. K , caiflèàpaflèrle ,
réfou. L , bec de corbin. M , formes à fucre bofléchées
par la pointe Sc pleines du fyrop de la batte-
'r ie , après qu’il a été refroidi dans le vaiflèau àp^
pelle le raffaîchifloir. N , plancher fur lequel eft un
citerneau où l’on jette les écumes & ce qui'fe ré-
cpand du fyrop, afin d en faire le tafia.
• Bas de la Flanche.
'A, partie du m'oülin ou gouttière qui 'conduit le fuc de
cahne dans la fücrerie. B , B , paflage & place des
ouvriers. C , C , emplacement pour ranger les formes
, avant de les porter dans la'purgerie. D , le bac
qui reçoit le réfoù ou le fuc des cannes. E , E , E , E ,
'E , lescihq"chaudières. F F , glacis. G , fenêtre qui
éclâSre principalement la batterie. H , bouche du
foyer fous la batterie. I , I , I , I , évents des autres
fourneaux qu’on a foin de boucher exactement,,
lorfque le feu eft au foyer. K , tuyau de la chemi-
■ rtée. L , appentis , efpece de grand auvent,. fou-
tenu par des piliers pour couvrir les fourneaux Sc
le negre qui entretient le feu fous la batterie. M ,
rampe-& efealier pour defeendre fous l’appentis.
P L A N C H E V .
La Vignette repréfente le principal attelier d’une affi-
nerie. t> , 7 , chaudières à clarifier. 8 , ‘chau-
"dierc à cuivre,'toutes trois montées fur leurs four-
' neaux. «>,10, chaudières à clair. f > pompe qui
' fournit l’eau du bac à chaux dans les chaudières à
clarifier.
Fig. 2. A, manège placé au rez-de-chauflee d’un des pavillons
, pour tirer de l’eau du.puits B. C , le réfervoir
• général qui diftribue par des tuyaux fouterreins
l ’eau dans tous les endroits où elle eft neceflaire.
‘D , folles où font les bâts à terre. E , paflage pour
aller dans le magafin F ; il y a auffi un efealier pour
monter aux étages fupérieurs qu’on appelle greniers.
F ,magafin où on défonce‘les bariques de fucre brut
<$u’e T o n diftribue par fortes dans les bacs ou bai lis
1 , 1 , 3 , 4 . G , bac à chaux conftruit en ciment ou
avec un corroi de terre glaife. H K , l’attelier que la
vignette repréfente. L , attelier appellé l’empli. 13
& 14 , chaudières de l’empli, où on porte les fy -
to p s après leur cuiflon. 1 f , formes rangées fur trois
rangs près les mifirs de cette falle, 5c la pointe en
bas, Le trou qui eft à cette pointe, eft bouché par
un petit- tampon de linge. M , chambre à vergeoi-
fe , au deflîis de laquelle, auffi - bien qu’au - deflus
, des autres bâtimens, font les greniers difpofês de
la même maniéré que cette chambre. N , fon poèîe
;ou étuve. P-, pavillon dans lequel font les maga-
fins des fucs affinés. R , grande étuve pour les fucs
affinés, où on les fait fécher après qu’ils font fortis
‘ desfqrmes.11-, réduit pour placer le charbon de
-terre dont on fe fert pour chauffer le poêle de cette
étuve. 1 1 , autre réduit où on dépofe dans des tonneaux
à gueule bée les écumes que l’on enleve de la
chaudière à cuire.
Fig. -3. Coupe du bâtiment par le milieu du pavillon
qui contient l’attelier-à clarifier & à cuire, Sc
aufli la-grande étuve. K , porte de communication
de l’attelier des chaudières à la falle de l’empli. 7.
une des chaudières à clarifier montée fur fon fourneau.
On voit au-deflous de la grille un foûterrein
qui communique à la cave qui eft au-deflous de l’étuve
R y il fert de cendrier & d’évent, 10, une des
-chaudières à clair.
P L A N C H E VI .
Vûe.perfpeélive de l’intérieur de la chambre â vergeoife
ou d’un des greniers qui font au-dcfliis.
Fig. 1. Ouvrier qu i, après avoir débouché le trou d’une
forme bâtarde qui eft pofée fens-deflus-deflous fur
une fellette appellée canaple, enfonce dans le fyrop
figé une broche de fer qu’on appelle prime,
pour faciliter l’écoulement de la . partie du fyrop
qui ne cryftallife pas dans les pots fur lefquels il re-
dreflè ces formes devant lu i, comme on voit.
Fig. 2. P oîle ou étuve pour entretenir dans cette chambre
ou grenier un certain degré de chaleur. II eft com-
poféd’une maçonnerie de brique, & d’une caiflè de
fer fondu formant trois côtés & le deflus d’un pa-
rallelipipede rectangle.
’3. Plan du poîle.
4. Coupe du poîle»
j . Elévation du poîle du côté de la porté 6c dit cendrier
; on y brûle du charbon de terre.
6. Forme bâtarde, dont la pointe va en arrondiflànt.
7 . Pot de forme bâtarde, ayant cinq pieds pour être
pofé à terre.
8. Forme pour mouler les pains de fucre -pelant deux
livres.
j>. Pot pour, laiffèr égouter cette Forme. . •, .
Ho. Baffin à cuitte, dont on fe fert pour remplir lès formes
dans la folle de l’empli, & autres tranfports
des fyrops d’une chaudière dans une autre ; &c.
P L A N C H E V I I .
Cette Planche repréfente la grande étuve où l’on met fécher
les pains de fucre, après qu’ils font fortis des
formes. On y voit la coupe du poîle de cette étuve
où l’on met le feu pàr lé dehors du bâtiment ; ÔC
celle dés foûterreins 'quî fervent dé cendriers 8c d e-
vents pour le poîle Sc les fourneaux des chaudières.
Cette figuré eft relative à la figuré 3 . de la Planche
V ,
T R A V A I L D E S S A B O T S ,
Echaiats 9 &c.
L a vignette tepréfente line cabane de ces fortes d’oii-
vriers 5 elle eft conftruite comme le toît d’une glacière
, & ouverte au fbmrhet A , pour fervir de fenêtre
5c de chemihéei Le comble B B , qui eft couvert
de paille , eft fupporté dans fon milieii par
quatre perches G C C G . On fait du feu en D dans
le milieu de la cabane.
'Fig. 1. Ouvrier qui ébauche un fobot avec la cognée.
z . Ouvrier qui perce la place du pied avec la tarière y
fig. 6.
3» Ouvrier qui fait la place du talon avec la cuillière,
f ig y. ou *>. ou 10. .
4. Ouvrier qui pare les fobots ; après qiié le dedans eft
achevé ; il fe fert du pareil*, fig. i 6.
ƒ. Ouvrier qui fend des échalaS ou de la latte avéc le
coûtre, fig. 18. Les pièces de bois qu’il veut fen:
d re , font entre les deux fourches du fendoir, qui
eft une fourché de deux branches d’arbres aflùjet-
ties horifontalement à la hauteur de deux pieds 5c
demi,- lefquelles lui fervent d’établi: On voit à côté
de lui deux x oü chevalets $ fur lefquels il placé les
échalas â mefure qu’ils font fendus ; poür lés mettre
en botté.
C. La tariere,- fig. 6. n. 2. Extrémité inférieure de la
tarière représentée fur uné échelle quadruplé;
7. La grande cuilliere de deux pouces de large.
8 Extrémité inférieure de la grande cuilliere, repré-
fentée en élévation, profil & plan fur une échelle
quadruple.
5», Cuilliere de 18 lignés deîâtge/
Ito.Cuillierè de 12-lignes de large.
[n . Cognée ou hache des febotiers, Vûé dé deux fens
differens.-
1« 21 Rouanne vûe en faée 5c en profil. . t . . .
|ï 31 Galle & coin de bois pour ferrer Sc affermir les fobots
non évuidés dans l’encoche.
•4 . L’encoche ou établi des fobotiërs.
U j. Maillet qu’on appelle renard,- fefvaftf à chaflèr le
coin i 3 entre deux fobots ,■ pour les faire tenir dans'
l’enGoehe.-
Il 6. Paroir fur fon banc.
117. Eflètte dont on fe ferf pour ébaucher au plus près les
fobots, après qu’ôn s’eft fervi de la hache, fig. i x.
118. Le coûtre pour travailler le bois de fente, comme
echaiats, lattes, édifies, &c.
iTome L
/ C H A R B O N D E B O I S .
P L A N C H E Icre.
'Le haut de la Flanche , confiruclions différentes de four-,
neaux à charbon.
Vremiere conflruclion.
Fig. A . C^Harbonnier qui trace au cordeau l’aire de la
■ . charbonnière.
B. Ouvrier qui àpplàmt l’aire de la charbonnière avec
la pelle, après avoi'r planté au centre une bûche fendue
en quatre par fa partie fupérieure,. Sc aiguifée
par l ’autre b o u t, pour commencer la cheminée.
C . Charbonnier qui applanit l’aire au rateau.
D. Aire applanie, où l’on voit au centre la bûche fendue
avec les bâtons qui fe croifent dans les fentes,
ce èn quqi Çoüfifté là première façon de l’arrangè-
ment du bo is, 5c de la formation de la cheminée.
E. Charbonnier qui a formé fon premier plancher, Sc
qui en arrête les bûches par des chevilles.,
F. Charbonnier qui répand fur ce plancher du menü
bois appellé bois de chemife. On v o it, même figure
, la formation du premier étage du fourneau.
G. Le premier étage plus avancé, avec le commencement'du
fécond.
H. Charbonnier qui apporte le bois à la brouette.
Tous les autres étages qui vont en diminuant y à
mefure qu’ ils s’élèvent, 8c qui forment une éf-
pece de cône, fe conftruifent de la même maniéré.
Deuxieme coiifiruclioh d’un fourneau•
Fig. 1. Après avoir tracé Sc applani l’aire; comme il à étc
dit à la première conftrudion,.au lieu de la bûche
fendue en quatre, on plante au centre, une loxigue
perche c t ; contré laquelle on dreflè lés bûches dont
lè premier étage fera conftruit. Cette perché formera
la cheminée.
2. Fourneau de cette conftruétion , dont tous lés éta-*
ges ƒ , g , /i i i ; font formés. L’ouvrier qu’on Voit ait
pié de ce fourneau, bêche là terre, Fait Un.chemin,
& prépare de quoi le couvrir ; foit avec de la terre,
foit avec du firafin . s’il en a déjà, k , extrémité d’une
autre perche qui va de la circonférence du fourneau:
jufqu'au centre, & q u i ménage le paflage qui fervi-
ra à allumer le fourneau.
}'• F%. qui peut également apparténir aux deux conftrtic-
tions, & qui en montre la derniere feçon, qui con-
fifte à former la cheihifé du fourneau. Le foürneau
eft tout couvert de fa chemife , excepté à fa partie
inférieure,' où on laiflè une bande bu lifiere fans
chémife ; pour donner lieu à l’aétion de 1 air.
Troifieme conflrùâion.
fourneau pyramidal 8c récouvert dé gazon, dont on
voit là Coupe verticale au bas de la Planche 1er*.
fig. N y 8c lè plan, Fl. 11. fig. O .
Le bas de la Planche.
Fig. L . Coupe verticale par le centre d’un fourneau de la
première confttuétion. ^ .
M. Coupe verticale par le centre d’un foürneau de la
féconde conftruétion. > , •.
N . Coupe verticale par le centre d’Un fourneau de la
troifiemè eonftruaion.
P L A N C H E I I .
Le haut de la Planche repréfente les fourneaux en feu , ou
la ciùffon du charbon.
Fig. 4. Ouvrier qui met le feu à un fourneau de la première
conftru&ion par le haut ; car au fourneau de
la féconde conftru&ion, le feu fe met par le bas où
Fôn a pratiqué un paflage, comme Oü voit e n * ,
Fl. i . f ig . i .
D